En effet, quinze jours plus tôt, l’empereur Charles-Quint avait battu à Pavie le roi de France, François Ier. Le roi-chevalier était prisonnier de son ennemi. C’étaient là des nouvelles que le vice-roi de Naples, qui avait pris une part vigoureuse à la bataille, se devait de fêter convenablement. Maria n’eut guère de peine à faire comprendre à son époux que l’on devrait regagner Naples. N’ayant pas pris part à la bataille, il entendait qu’on le vît à la cour féliciter Avalos…
Les fêtes du vice-roi, qui pourtant rompaient agréablement la monotonie de la vie, passèrent presque inaperçues de Maria. Elle était bien trop prise par la merveilleuse aventure qui lui arrivait : elle aimait et elle était aimée. Le doute n’était plus possible.
Désormais, chaque matin, quand elle se rendait à l’église pour entendre la messe, suivie de Felicia, une ombre vêtue d’un grand manteau s’embusquait derrière un pilier et cette ombre, c’était le beau Filippo. Jamais Maria n’avait suivi le service divin avec autant de distraction. Sous son voile, elle tournait continuellement les yeux vers le bienheureux pilier… On échangeait quelques mots à la sortie, quand l’eau bénite permettait aux doigts tremblants de se joindre et Filippo employait ces brefs instants de façon fort éloquente. Il implorait, il suppliait Maria de lui accorder une entrevue dans un lieu un peu moins public, mais la jeune femme n’osait pas lui dire de venir chez elle. Son mari ne l’aimait pas, mais cela ne l’empêchait pas d’être jaloux… S’il allait se douter qu’elle aimait ailleurs ?…
Filippo changea alors de tactique et s’arrangea pour rencontrer Felicia. La vieille nourrice n’avait aucun scrupule concernant don Gesualdo. Tout ce qu’elle voulait, c’était que Maria fût heureuse et nul ne lui semblait remplir les conditions requises pour assurer ce bonheur plus que le jeune comte. Un matin, elle vint seule à l’église. Filippo, quittant aussitôt son coin, vint s’agenouiller près d’elle.
— Elle est malade ?
— Légèrement souffrante. Des vapeurs… rien, autant dire. J’ai voulu venir seule.
— Qu’avez-vous à me dire ?
— Que le seigneur don Gesualdo part tout à l’heure pour aller chasser dans ses terres des monts Albains… et qu’il y a au palais une petite porte de côté dont j’ai la clef dans mon aumônière.
Le cœur de Filippo s’arrêta de battre, mais ses yeux brillèrent dans l’ombre fraîche du sanctuaire.
— Est-ce que… dona Maria n’accompagne point son époux ?
— Je vous ai dit qu’elle était souffrante, fit la nourrice avec un sourire. Le voyage ne lui vaudrait rien. Et puis, quand il s’en va dans ses domaines romains, monseigneur n’aime guère l’emmener. Que pensez-vous de tout ce que je viens de vous dire ?
— Que cette nuit, quand l’ombre sera totale, j’irai ouvrir cette petite porte… où vous m’attendrez.
La nuit venue, en effet, Filippo d’Andria se glissa dans le palais Venosa. Felicia l’attendait derrière la petite porte et, vivement, le fit monter jusqu’à la chambre où Maria, le cœur battant, l’attendait. Quand elle eut introduit le jeune homme, la vieille nourrice referma soigneusement la porte derrière lui et alla s’installer sur un banc, dans l’antichambre, pour égrener plus commodément son chapelet.
Lorsque, peu avant l’aube, Filippo quitta le palais, il laissait derrière lui une jeune femme aussi transportée de bonheur qu’il l’était lui-même. Durant toute cette nuit, Maria avait découvert que l’amour et les pénibles expériences vécues aux mains de son époux n’avaient absolument rien de commun.
Dès lors, chaque fois que don Gesualdo partait pour la chasse, ce qui lui arrivait toujours aussi fréquemment, Felicia courait prévenir le jeune comte et les deux amants passaient l’un auprès de l’autre des heures fort douces dont ni l’un ni l’autre ne se lassait. Jamais Filippo n’avait aimé comme il aimait Maria. Pour la jeune femme, c’était une passion folle qu’elle éprouvait. Quand le mari s’absentait pour plusieurs jours, et ce n’était pas rare tant était grande son ardeur cynégétique, les deux jeunes gens demeuraient jours et nuits enfermés ensemble, tandis que Felicia faisait le guet. Ces jours-là, pour la valetaille du palais, Maria était réputée souffrante et nul ne devait s’aventurer aux alentours de la chambre où elle reposait. C’était Felicia et Felicia seule qui s’occupait d’elle, lui montait ses repas et lui donnait les soins que nécessitait « son état ».
Cela dura six mois. Six mois de bonheur absolu, de passion folle, au cours desquels les deux amants ne respirèrent que l’un par l’autre. Mais Naples, comme toutes les autres villes du monde, était peuplée d’yeux qui savaient voir et de langues agiles. Bientôt, don Gesualdo fut à peu près le seul dans la vice-royauté à ignorer son infortune. Quand il partait à la chasse, les voisins souriaient. On chuchotait que, du chasseur ou du gibier, nul ne savait lequel était le mieux encorné. On chuchotait même tellement, qu’un matin, la princesse reçut la visite de son jeune oncle, Alfonso d’Avalos, marquis del Vasto. C’était un fort beau jeune homme, fort élégant, et l’arbitre incontesté des élégances napolitaines. Maria l’aimait beaucoup et Alfonso le lui rendait bien.
Il commença par l’embrasser à plusieurs reprises, lui fit compliment de sa mine et de sa toilette, puis s’installa dans un vaste fauteuil couvert de tapisserie, en prenant bien soin de ne pas froisser son merveilleux pourpoint de soie feuille morte brodée d’or.
— Or çà, ma mie, fit-il avec un grand sourire, je viens vers vous en ambassadeur extraordinaire. Le vice-roi m’envoie mettre quelques grains de sagesse dans votre tête folle.
— Son Altesse est bien bonne, répondit Maria en riant, mais je me porte à merveille.
— Vous m’en voyez charmé, ma chère nièce, mais il se pourrait que cette belle mine qui vous va si bien et cet air de bonheur qui vous fait encore plus jolie ne durent pas aussi longtemps que vous le voudriez.
En dépit du beau soleil qui réchauffait la pièce, Maria ne put retenir un frisson. Sous les paroles aimables de son jeune oncle, elle avait senti poindre une menace.
— Que voulez-vous dire ?
— Que don Gesualdo est un imbécile, ce dont personne ici ne saurait douter, mais qu’il ne l’est pas au point que vous imaginez. Il n’est bruit, dans Naples, que de vos amours avec le comte d’Andria… et si ce bruit venait aux grandes oreilles de votre époux…
— Pourquoi voulez-vous qu’il sache ? Je prends toutes les précautions possibles et je me garde bien.
— On ne se garde jamais assez. Je sais que les époux sont en général les derniers informés, mais songez, Maria, que si votre époux, qui est vindicatif et cruel, apprenait son infortune, ni moi, ni votre père, ni même le vice-roi ne pourrions rien pour vous. Vous êtes sa femme et il a sur vous tous les droits.
Le ton sérieux d’Alfonso impressionnait Maria, mais quand il ajouta :
— Ne pourriez-vous… rompre ?
— Jamais ! s’écria-t-elle. J’aime Filippo, il m’aime, et rien ni personne ne pourra nous séparer. Sans lui, je n’ai plus de raisons de vivre.
— Tâchez qu’il ne vous donne pas de raisons de mourir. Soyez prudente, Maria, je vous en conjure.
— Je le serai, je vous promets. D’ailleurs, Filippo ne vient ici que lorsque don Gesualdo est à la chasse. Et vous savez que même le siège de Naples ne saurait détourner le prince de Venosa quand il traque le gibier. Je n’ai donc rien à craindre.
— Dieu vous entende, soupira Alfonso. Quant à moi, j’ai transmis le message. Votre tante Vittoria se soucie de vous et serait au désespoir qu’il vous arrivât malheur.
— Dites à ma belle tante que je l’aime… et que je me garderai.
Mais le soir même, dans les bras de Filippo, Maria oublia toutes ses belles résolutions de prudence. Gesualdo était parti chasser sur le Vésuve et la vie est si belle quand on s’aime ! À dix-sept ans, le danger paraît toujours illusoire.
Un mois plus tard, quand les lourdes chaleurs de l’été se firent plus supportables, don Gesualdo décida d’aller chasser dans ses terres romaines.
— Venez-vous avec moi ? demanda-t-il à sa femme.
— Souhaiteriez-vous ma présence ? s’étonna la jeune femme. Vous n’aimez guère m’emmener quand vous allez à Rome, cependant.
— En effet. Je crains pour vous la fatigue du voyage, mais si par hasard, cela vous tentait…
— Oh non, fit Maria en riant. Je n’y tiens vraiment pas. Il fait encore trop chaud et il y a trop de poussière sur les grands chemins.
— Restez donc, fît le prince en haussant les épaules. Je suis certain que vous saurez m’attendre sans impatience.
L’étrange tournure de cette phrase ne frappa pas Maria. La jeune femme n’avait qu’une hâte : voir son époux tourner les talons pour expédier Felicia chez Filippo. Quand don Gesualdo s’en allait à Rome, les deux amants avaient de longues journées et de belles nuits devant eux.
Le prince de Venosa et ses hommes n’avaient pas encore franchi les portes de Naples que la vieille nourrice galopait déjà sur le chemin du palais d’Andria. Une heure après, le jeune homme arrivait chez son amie.
La nuit de septembre était belle et douce. Dans la chambre de Maria, ouverte sur les parfums du jardin, aucun bruit ne se faisait entendre. La veilleuse d’huile parfumée, dans sa lampe dorée, éclairait le lit en désordre sur lequel reposaient les deux amants, épuisés de bonheur. Sur une petite table, des fruits, des flacons n’avaient pas été touchés… Au-dehors, sur la branche d’un grand pin, un rossignol chantait… Alentour, Naples dormait en attendant que le soleil lui rendît sa vie exubérante.
Nul n’entendit ouvrir une porte qui donnait directement sur le jardin. Nul ne vit une troupe de dix hommes, armés jusqu’aux dents et masqués, s’y glisser. Sur le sable des allées, les hommes ne faisaient aucun bruit. On eût dit un cortège d’ombres qui volaient, d’un massif à une statue… Ils atteignirent le palais. Aucun grincement de porte ne signala leur entrée.

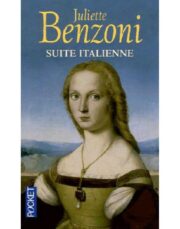
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.