Venosa (NAPLES)
Les amants de Naples
Les appels de trompe, les aboiements des chiens, le claquement sonore et impatient des sabots des chevaux, tout le tintamarre d’une troupe prête à partir pour la chasse éveillèrent les échos de la via Monte Oliveto, à Naples, à l’aurore d’un beau jour de février 1523. La cour du palais du prince de Venosa était pleine de cavaliers, chasseurs, écuyers, pages retenant à plein poing les molosses de chasse, fauconniers et autouriers, dont les mains gantées de cuir épais portaient d’arrogants oiseaux encapuchonnés de brocart pourpre. Tous attendaient que parût le maître pour sauter en selle.
Il ne se fit pas attendre. La première flèche du soleil levant n’avait pas encore frappé le sommet du Vésuve que Carlo-Gesualdo, prince de Venosa, apparaissait et enfourchait aussitôt son cheval qu’un valet d’écurie lui amenait. Il jeta à ses compagnons un rapide coup d’œil et s’écria :
— En chasse, Messieurs !
Et piquant des deux, il prit la tête du brillant cortège, dont le furieux galop ébranla les voûtes de pierre du vieux palais. Bientôt, il n’y eut plus dans la cour que les valets et les servantes qui vaquaient déjà à leurs occupations matinales. Alors, la vieille femme dont la tête coiffée d’une haute cornette empesée était apparue à une fenêtre du premier étage quand le prince avait bondi dans la cour, poussa un profond soupir et rentra.
— Ce n’est pas possible, murmura la vieille Felicia pour elle-même. Ce n’est pas possible que monseigneur chasse dès ce matin. Il faut que je voie ce qu’il en est.
Et avec décision, elle se dirigea vers la chambre nuptiale. Car l’homme qui venait de partir en chasse avec tant d’ardeur avait pris femme la veille même et il était étrange de le voir déserter si tôt la chambre conjugale. Pour la vieille Felicia, nourrice de la jeune épousée, c’était un acte à la fois injurieux et proprement impensable.
— Il a beau être prince et riche, ce rustre, marmonnait-elle en enfilant rageusement galeries et couloirs, il devrait remercier le Ciel à genoux de lui avoir donné pour femme ma petite Maria. Et le voilà qui va chasser.
Tout en soliloquant, elle était arrivée devant une haute porte peinte et dorée qu’elle ouvrit sans même prendre la peine de frapper. La grande chambre était encore plongée dans l’obscurité, mais un bruit de sanglots se faisait entendre. Felicia courut tirer les épais rideaux, pousser les volets de bois plein. Le soleil pénétra à flots, glissa sur les carrelages multicolores, atteignit les murs tendus de soie brodée, le grand lit couvert de draps d’argent dans lequel une toute jeune femme, ses longs cheveux noirs croulant sur ses épaules nues, sanglotait éperdument, la tête dans les oreillers.
— Oh ! s’écria Felicia, indignée. Et voilà que tu pleures, maintenant ?
Elle escalada les marches du lit, s’assit auprès de la jeune femme, qu’elle prit dans ses bras et se mit à bercer comme une enfant :
— Là… là… ma belle. Ne pleure plus. Raconte à ta vieille Felicia ce qui s’est passé. J’espérais te trouver ce matin toute gaie et toute souriante, un peu émue peut-être, et voilà que je te trouve en larmes ? Ce n’est pas raisonnable.
Felicia ne disait pas toute la vérité. Au fond, depuis le jour où Maria d’Avalos, fille de don Carlos d’Avalos, et nièce du vice-roi de Naples, avait été fiancée à Carlo-Gesualdo, Felicia s’était inquiétée.
Maria n’avait que quinze ans et sortait tout juste de son couvent, tandis que le prince, la quarantaine passée, n’avait rien du prince charmant. Petit, trapu, mais doté d’une force dangereuse, il était noir de peau, noir de poil, et peut-être bien assez noir d’âme si l’on en croyait les bruits qui couraient sur lui dans les ruelles de Naples. Les gens de la Basilicate, dont faisait partie son fief de Venosa, avaient la réputation d’être de caractère sombre, hargneux et implacables dans leur vengeance. Ils faisaient de bons soldats, mais leur brutalité était proverbiale. À considérer le visage plat et rude de Carlo-Gesualdo, ses yeux durs et l’obstination de son menton, on pouvait déduire sans peine qu’il ne faisait pas exception.
Bercée par les mots et les bras tendres de sa nourrice, Maria expliqua les raisons de ses larmes. Raisons bien simples et même assez banales. Bien sûr, elle n’était pas amoureuse de son époux, comment l’aurait-elle pu ? Mais on lui avait tant répété qu’il en allait ainsi pour presque toutes les filles de bonnes maisons, mariées pour la plupart sans avoir même jamais vu leur fiancé, que l’amour venait après, qu’elle avait naïvement espéré parvenir à ce résultat. Elle était arrivée au seuil de sa nuit de noces toute prête à rendre au centuple l’amour qu’on lui donnerait.
Hélas ! Gesualdo n’était demeuré auprès d’elle que le temps de lui faire subir la plus brutale et la plus déplaisante des expériences. Il l’avait traitée comme une servante ou comme l’une de ces filles que dans les villes prises d’assaut, les hommes d’armes soumettent à leur loi. Et de cette expérience, Maria sortait profondément humiliée, blessée au plus profond de sa sensibilité. Elle ne pourrait jamais oublier ces instants affreux…
Vers minuit, le mari était sorti de la chambre pour regagner ses appartements privés et y dormir « plus à son aise ». Depuis, elle n’avait cessé de pleurer.
— Hier, hoqueta-t-elle en achevant son récit, tout était si beau !
C’était dans la chapelle du Castel Nuovo, le château royal, qu’on l’avait mariée, en présence du vice-roi, son oncle, et de la belle vice-reine, Vittoria Colonna. Toute la cour, tout ce que la province comptait de richesse, de beauté et de noblesse, avait assisté à ces noces fastueuses qui unissaient un vieux nom du royaume de Naples à un autre vieux nom, venu d’Espagne comme cette dynastie d’Aragon qui avait si longtemps régné sur le pays. Les Avalos étaient Grands d’Espagne et régnaient sur Naples au nom de l’empereur Charles-Quint. Maria, vêtue d’or et couverte de pierreries, avait cru vivre un rêve merveilleux. Tout était si splendide que même le peu gracieux époux en avait reçu un reflet romantique. Certes, elle était vraiment prête à l’aimer… si seulement il l’avait voulu…
Felicia haussa les épaules. Don Gesualdo était selon elle un parfait imbécile. Maria était ravissante : longs cheveux noirs et bouclés, prunelles de velours sombre, teint de pêche, silhouette exquise… et il préférait galoper bêtement à la suite de cerfs, de loups ou de sangliers.
— Tu n’as pas eu de chance, ma colombe, lui dit-elle, mais il ne faut pas te désespérer. Tu n’es pas la première qui se retrouve mal mariée. Mais un jour, tu verras, tu rencontreras un vrai, un grand amour, qui te donnera tout le bonheur dont tu rêves.
Ces belles paroles d’espoir, Felicia devait les répéter bien souvent à Maria, durant les deux mortelles années qui suivirent. La jeune princesse commençait à désespérer de connaître un jour ce merveilleux amour… Sa vie était tellement ennuyeuse.
Que ce fût à Naples, ou bien dans ses terres de Basilicate qu’il visitait souvent, le prince passait son temps à la chasse. Tout le jour, il galopait derrière ses chiens, en compagnie de ses piqueurs et de ses gentilshommes, à moins qu’il ne parcourût, faucon au poing, quelque marais. Parfois, il s’absentait plusieurs jours, afin d’aller chasser dans les terres qu’il possédait aux environs de Rome ou dans l’une des îles du golfe de Naples. Quant à sa femme, il s’en occupait aussi peu que possible. Elle tenait sa maison, elle était belle et parfois, la nuit, il allait la rejoindre quand l’envie lui en prenait. Mais en dehors de cela, il la considérait comme un bel objet, une chose précieuse, certes, mais guère plus qu’un cheval de grande race ou un chien bien dressé.
Quand on était à Venosa, Maria sentait le désespoir s’emparer d’elle. Elle n’avait d’autre distraction que regarder l’immense paysage ou se rendre à l’abbaye de la Trinité pour entendre les offices. Le fait que le poète Horace eût vu le jour à Venosa lui était tout à fait indifférent, alors qu’il transportait d’admiration sa tante, la vice-reine Vittoria, éprise de poésie.
À Naples, évidemment, la vie de cour lui permettait quelques distractions mais assez peu et presque toutes d’origine religieuse. L’étiquette sévère de la cour espagnole et les longs bras de l’Inquisition y entretenaient une atmosphère assez peu réjouissante. Et Maria trouvait sa vie si dépourvue de joie qu’elle en était venue à accompagner de temps en temps son époux à la chasse. Du moins, au milieu des bois, n’était-on pas contraint à d’interminables prières et était-il possible d’échanger parfois quelques mots avec des hommes plus jeunes que son époux.
C’est à l’une de ces chasses que la jolie princesse devait rencontrer son destin.
Il avait vingt-cinq ans, il se nommait Filippo, comte d’Andria, et ses terres des Pouilles n’étaient pas très éloignées de celles de Venosa. Invité par ce dernier, il vint participer à une chasse au loup… et tomba amoureux de Maria dès le premier coup d’œil. Ce soir-là, après avoir suivi la chasse toute la journée, la jeune femme, vêtue de satin rose, faisait les honneurs du sévère château. Dans les hautes salles dont les murs de pierre s’habillaient d’antiques tapisseries, sa silhouette fine et claire évoquait une fleur et le jeune comte ne résista pas à tant de grâce. Quand vint le moment de se quitter, il laissa ses lèvres se poser plus longtemps qu’il n’aurait fallu sur la main qu’on lui tendait.
— J’ai regret, Madame, de devoir repartir dès demain.
— Quoi ? si tôt ? Ne deviez-vous pas demeurer encore quelque temps parmi nous ?
— J’aurais dû, en effet, mais mon seigneur le vice-roi me rappelle et je dois regagner Naples au plus tôt. Cependant, peut-être y viendrez-vous bientôt. Les fêtes de la victoire…

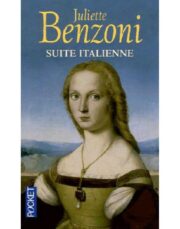
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.