Un affreux juron, bien regrettable chez un ancien cardinal, échappa à Borgia. Cette femme avait raison, une fois de plus. Tant qu’il ne pourrait pas éteindre complètement la race des maîtres légitimes de Forli, il risquerait de faire figure d’usurpateur. Était-il donc écrit qu’elle le narguerait toujours ? Fou de rage, il s’avança vers elle, le meurtre dans les yeux.
Dédaigneuse, un sourire railleur sur les lèvres, elle le regardait approcher. Un éblouissement passa, comme un voile rouge, devant les yeux de l’homme et sa main se porta machinalement vers la poignée de sa dague. La comtesse suivit le geste du regard.
— Vous voulez me tuer ? C’est là une excellente idée qui me rendra grand service.
Ce dernier défi arrêta Borgia. Il laissa retomber sa main tandis qu’un sourire mauvais passait sur son visage encore boursouflé.
— Vous tuer ? Ce serait trop facile ! Je préfère vous punir d’une autre façon.
Lentement, sans la quitter des yeux, il reprit sa marche vers elle. Il y avait tant de haine dans ce visage nu, encore ravagé par le mal, que la comtesse frémit malgré son courage. Elle venait de comprendre quelle était la nature exacte de la punition qu’il entendait lui infliger.
Quand il posa la main sur son épaule, elle se tordit comme la vipère de ses armes célèbres, le mordit sauvagement au poignet comme n’importe quelle fille des ruisseaux de Rome. Alors il frappa, brutalement, aveuglément, sans autre souci que faire mal et réduire enfin l’orgueil et la résistance de cette femme qui le narguait encore. Elle résista cependant, luttant contre lui avec ses seules mains nues aussi courageusement qu’elle l’avait fait avec ses armes.
— C’est bien la première fois que je te vois combattre, Borgia ! lui jeta-t-elle. Il est vrai que, pour un brave de ta sorte, une femme est un ennemi convenable.
— Vous n’êtes pas une femme, vous êtes un démon !
Malheureusement, elle était épuisée par le combat livré dans la journée, par l’angoisse et des nuits entières passées sans sommeil. Lui était pleinement dispos et beaucoup plus vigoureux qu’elle. La lutte se fit moins âpre. La comtesse, désespérée, sentit qu’elle était à bout. D’un dernier coup de poing, il la jeta à terre à demi assommée… Elle y resta immobile…
Alors il bondit sur elle pour en triompher de la plus ignoble façon, car le viol était aussi l’une de ses spécialités.
Quand Yves d’Allègre revint, le lendemain, elle n’osa pas lui avouer le traitement qu’elle avait subi. Elle était en effet de ces femmes qui savent lire sans peine dans le regard et le cœur d’un homme, et il ne lui avait fallu qu’un instant pour comprendre que celui-là l’aimait. D’ailleurs il avait été l’un des signataires des nombreuses lettres que les flèches lui avaient apportées durant le siège.
Par contre, elle frémit en apprenant que le roi Louis XII le rappelait à Milan avec ses soldats, car il était impossible qu’il l’emmenât avec lui.
— Nous avons passé un accord avec monseigneur Borgia, lui dit-il. Vous serez, Madame, conduite à Rome, où vous serez traitée avec honneur et où vous résiderez en attendant que le roi mon maître ait pris une décision pour votre avenir.
— Croyez-vous vraiment à la parole d’un Borgia, demanda-t-elle tristement, même pape ?
— Je n’ai pas de raison d’en douter, Madame. J’ajoute que si vous-même n’y croyez pas, je vous supplie au moins de croire à la mienne, que je vous engage, et à celle du roi Louis. C’est un dépôt sacré qu’en votre personne il remet au pape. Un dépôt dont il demandera compte.
— En êtes-vous bien sûr ?
— Comme de moi-même. D’ailleurs, l’oublierait-il que je serais là et moi, Madame, je ne vous oublierai jamais à moins que je ne sois mort ! Mais tant que je vivrai, je serai votre défenseur et votre serviteur fidèle.
Elle lui sourit, émue par cet amour qui s’avouait aussi franchement puis, spontanément, lui tendit les deux mains.
— À cause de vous, j’essaierai d’avoir confiance. Mais ne m’oubliez pas.
Malheureusement, les pressentiments de la comtesse n’étaient que trop fondés. À Rome, elle devait expérimenter ce que valaient les paroles des Borgia, même celles d’un pape. D’abord traitée avec quelques égards et logée au Vatican dans le palais du Belvédère, elle dut bientôt faire face à une invraisemblable accusation de tentative de meurtre contre le Souverain Pontife. L’accusation, bien entendu, n’avait aucun fondement sérieux, mais on s’en servit pour l’arrêter et la jeter dans l’un des cachots de château Saint-Ange.
On l’en tira pour la faire figurer dans le triomphe que César Borgia voulait s’offrir à la manière des anciens empereurs. Et le peuple romain, qu’elle avait jadis ébloui de son faste et de sa beauté, vit passer, traînée au char du vainqueur, une femme enchaînée vêtue d’une robe de bure brune. Les chaînes étaient pesantes… mais elles étaient d’or massif. Et pas un cri ne s’éleva sur son passage, car cette femme en qui chacun devinait une victime était plus noble et plus imposante que le principal acteur de ce triomphe grotesque.
La représentation terminée, on la rejeta dans son cachot, l’un des plus noirs et des plus malsains du château fort. Elle allait y rester un an… jusqu’à ce qu’Yves d’Allègre revînt en Italie.
La mauvaise chance de Catherine avait voulu que de Milan, il fût envoyé en France, où rien n’était venu lui apprendre ce qui s’était passé à Rome, mais à peine fut-il revenu, conduisant de nouvelles troupes, que la rumeur publique lui apprit comment les Borgia entendaient l’expression « traiter avec honneur ». Il n’hésita pas une seconde.
Sautant à cheval avec une petite escorte, il gagna Rome et fit irruption plutôt qu’il ne se présenta devant Alexandre VI.
Stupéfait, celui-ci s’entendit signifier d’une voix impérieuse l’ordre de remettre en liberté immédiate la comtesse de Forli, prisonnière du roi de France et indûment détenue par l’Église. Le pape n’eut même pas la possibilité de discuter.
— Au cas où Votre Sainteté n’accepterait pas, ajouta le capitaine, qu’elle sache bien que mes troupes se trouvent actuellement à Viterbe et qu’avant une semaine, si j’en donne l’ordre, mes canons seront braqués sur Rome !
Peu désireux de s’attirer une aussi mauvaise affaire, le pape accorda la libération de la captive, qu’Yves d’Allègre alla lui-même chercher dans sa prison. Mais ce fut une femme aux cheveux blancs, complètement épuisée, qu’il ramena à la lumière du jour. Alors, lui qui avait rêvé de la ramener en France, il écouta sa prière et la fit conduire auprès de ses enfants, à Florence.
Elle y vécut huit années encore, dans la belle villa di Castello, se consacrant tout entière à l’éducation du petit Jean, son dernier fils qu’elle aimait plus que les autres parce qu’elle se reconnaissait en lui, jusqu’à ce 28 mai 1509 où s’éteignit enfin, pour entrer dans la légende, celle qui avait été la glorieuse dame de Forli.
Carafa (NAPLES)
Le drame de Soriano
Au soir du 1er janvier 1559, Rome apprit une nouvelle incroyable : le pape Paul IV exilait ses trois neveux, ses favoris, ceux qui avaient pu jusque-là mettre la ville en coupe réglée sans craindre la moindre représaille. Tout d’abord, personne ne voulut croire à l’événement, mais il fallut bien se rendre à l’évidence : trois jours plus tard, les trois frères : Juan Carafa, duc de Soriano et de Palliano, Carlos, cardinal Carafa, légat de Bologne et chef du Sacré Collège, et Antonio, marquis de Montebello, quittaient Rome avec armes et bagages pour se retirer dans leurs terres.
Que s’était-il donc passé ? Comment ces hommes, hier tout-puissants, en étaient-ils venus là ? En vérité, il avait fallu peu de chose : un souper, une bagarre, une courtisane et enfin, le rapport d’un moine franciscain, Fra Bartolomeo, confesseur du Saint-Père.
Ces Carafa avaient apporté de Naples, leur pays d’origine, un sang bouillant, fortement mâtiné d’espagnol, et qui les portait aux pires excès. Mais le Saint-Père, dont la vie austère et les mœurs rigides n’étaient un secret pour personne, ne pouvait même concevoir que des hommes de sa famille pussent avoir une conduite différente de la sienne. Aussi sa surprise n’avait-elle eu d’égal que son chagrin, lorsque le père Bartolomeo, son confesseur, lui avait appris la scène du palais Lanfranchi.
Quelques jours plus tôt, le secrétaire du duc de Soriano, Lanfranchi, avait donné un grand festin où étaient conviés les principaux seigneurs de Rome, et les plus belles courtisanes.
C’est à cause de l’une d’elles, la Martuccia, qu’une violente querelle avait éclaté entre le cardinal Carlos et l’un des officiers de son frère le duc. On avait vu le prélat, en habit séculier, mettre l’épée à la main pour arracher la fille au jeune homme, un certain Marcello Capecci, Napolitain lui aussi et de sang non moins bouillant que l’impétueux cardinal. On avait pu séparer les furieux, mais le scandale avait été énorme en dépit des efforts du duc de Soriano pour l’étouffer.
En effet, cruel et violent, mais tenant particulièrement à la dignité de son entourage, le duc avait fait arrêter Lanfranchi et Capecci, mais avait dû les relâcher à cause du bruit énorme que cela faisait au palais de son frère. Un bruit tel qu’il était parvenu jusqu’aux oreilles de Fra Bartolomeo.
— Très Saint-Père, dit celui-ci à Paul IV, la mesure est comble. Si Votre Sainteté n’agit pas contre ses neveux, on dira dans toute l’Europe qu’elle leur montre vraiment trop d’indulgence. Passe encore pour les soupers, les chasses, le luxe écrasant, mais qu’un cardinal se batte pour une courtisane, cela ne se peut concevoir !
— Je ne le sais que trop, mon frère ! Et si je n’ai pas sévi sur l’heure c’est parce qu’il m’en coûte de frapper ceux qui, jusqu’ici, avaient toute mon affection. Mais vous avez raison : il faut un exemple.

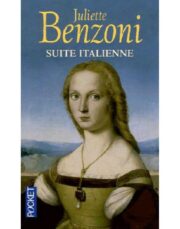
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.