— Je vois ! (Elle voyait même très bien.) Et je te remercie, Basilio, de ton conseil ! Avant de te retirer dis-moi si j’ai quelque chance d’y arriver ?
Il eut l’amusant sourire qui lui remontait les coins de la bouche jusqu’aux oreilles :
— On dit : « Ce que femme veut, Dieu le veut ! » Basilio, lui, verrait plutôt le Diable dans ce rôle-là ! Quoi qu’il en soit, tu es plus femme que toutes les autres réunies. Prends seulement garde à ne pas en abuser !
Il salua puis disparut si vite que le courant d’air de la porte faillit éteindre la bougie. Après son départ Elen, armée d’une brosse, acheva son ouvrage, tressant les cheveux de Marie en une épaisse natte, puis l’aida à se mettre au lit. Durant ce temps elles n’échangèrent pas une parole mais quand – Marie une fois installée dans ses oreillers –leurs regards se rencontrèrent, elles se sourirent :
— Monseigneur de Chevreuse ! émit la jeune fille. C’est le seul seigneur assez puissant…
— C’est surtout le seul que nous ayons sous la main… enfin je l’espère ! Demain matin nous rentrons à Paris ! Tu donneras les ordres.
Restée seule dans le lit où la veilleuse allumait sous les courtines de velours une tendre lueur rose, Marie se mit à retourner dans sa tête l’idée d’épouser Chevreuse. Ce serait à la fois un coup de maître et une agréable solution : depuis quelques mois en effet, Claude de Chevreuse était son amant et un amant digne de ce nom : ses nombreuses conquêtes antérieures lui avaient donné des femmes une large expérience. En outre, il se disait fou d’elle. La question des nuits – importante puisque dans la vie humaine il y en a autant que de jours ! – se trouverait donc avec lui réglée à l’entière satisfaction de la jeune femme. Mais restaient justement les jours !
Ceux à venir pouvaient être glorieux car, prince lorrain, Chevreuse n’était pas sujet du roi de France. Titré duc d’Aumale puis prince de Joinville et enfin duc de Chevreuse, c’était une altesse indépendante à qui l’on donnait du « Monseigneur » et que le roi de France comme celui d’Angleterre appelaient « mon cousin ».
Son père était ce fameux duc de Guise, Henri le Balafré, qui sous les derniers rois Valois avait tant fait parler de lui et de sa « Sainte Ligue » qu’il avait bien failli coiffer la couronne d’Henri III après l’avoir effacé de la surface de la terre. Moins privé de soutiens que l’on aurait pu le croire, le Roi l’avait pris de vitesse à ce jeu mortel en le faisant exécuter au château de Blois par ses « Quarante-Cinq », ce qui ne lui avait valu qu’un assez bref répit : un an plus tard, la sœur de Guise, la redoutable duchesse de Montpensier, séduisait le jeune moine Jacques Clément au point de le convaincre d’assassiner Henri qui mourut d’un coup de poignard dans le ventre. Cependant, si la couronne changea de dynastie ce ne fut pas au bénéfice de la maison de Guise-Lorraine, mais à celle de Bourbon : le dernier Valois avait légué le royaume à son beau-frère, le huguenot Henri de Navarre, qui allait devenir Henri IV après une spectaculaire conversion. Paris ne valait-il pas une messe ?
Le Balafré laissait cinq enfants de son mariage avec Catherine de Clèves : Claude de Chevreuse était le dernier. Avant lui on trouvait Charles, l’aîné, duc de Guise, personnage de peu d’envergure, Louis, cardinal de Guise et archevêque de Reims, ami des arts mais de moralité douteuse, Louise-Marguerite, devenue par mariage princesse de Conti et de réputation telle que l’austère Louis XIII l’avait surnommée « le péché » ! Le quatrième, c’était le chevalier François, duelliste impénitent qui vivait pratiquement l’épée à la main, ne rêvant que ferrailler avec quiconque s’aventurait dans son champ de vision. A la limite Claude était le meilleur de la bande. De caractère mou et indéterminé dans la vie quotidienne, c’était au combat la vaillance en personne. Il s’était distingué à maintes occasions jusques et y compris chez les Turcs quand, par hasard, on ne se battait pas en France. Et comme son frère François, il avait à son actif quelques duels retentissants.
Passionnément attaché à la personne d’Henri IV – et ensuite à celle de son fils ! –, Claude poussait l’affection jusqu’à être tombé amoureux des différentes maîtresses du Béarnais : d’abord la belle comtesse de Moret qui lui avait valu un « séjour » en Angleterre puis chez son aîné au château de Marchais, ensuite l’infernale Henriette d’Entragues, marquise de Verneuil dont le Roi était si féru qu’il avait parlé de « couper le cou » à l’imprudent, d’autres encore jusqu’à ce qu’enfin, il tombe sous le charme de Marie. Leur liaison, favorisée par l’industrieuse princesse de Conti, avait fait scandale – tout le monde était au courant sauf le mari comme d’habitude ! – au point que le duc Hercule de Montbazon, père de la jeune femme, était allé prier Louis XIII de faire cesser des ébats amoureux qu’il condamnait sévèrement. On en était là quand l’accident de la salle du trône avait jeté Marie dans les limbes d’une disgrâce si soudaine que le temps avait manqué pour savoir ce qu’en pensait un amant dont elle avait tout lieu de croire qu’il embrasserait sa cause avec fougue…
Arrivée à ce point de son raisonnement et de sa nuit sans sommeil, la jeune femme s’avoua qu’elle venait de mettre le doigt sur le côté incertain de la question : Chevreuse l’aimait-il assez pour braver la colère – inévitable ! – d’un maître qu’il révérait en faisant d’elle une altesse de Lorraine ? Il importait de s’en assurer au plus tôt ! Aussi, à peine un premier coq eut-il fait entendre sa voix enrouée qu’elle sonnait le branle-bas de combat en réclamant à la fois sa toilette, son déjeuner et son carrosse : le tout dans l’ordre annoncé. Une heure plus tard, Peran, toujours, flanqué de son laquais terrifié, lançait derechef ses quatre coursiers sur le chemin de Paris.
On mit deux heures à atteindre l’enceinte fortifiée de la ville mais il en fallut une de plus pour aller de la porte Saint-Antoine à la rue Saint-Thomas-du-Louvre où, dans l’ombre du vieux palais, s’érigeait l’hôtel de Luynes tant il y avait d’encombrements aux alentours de la place Royale d’abord, des Halles ensuite et enfin de la Croix-du-Trahoir où il y avait exécution. Résultat : la Duchesse était à peu près hors d’elle quand elle put mettre pied à terre dans la cour de sa demeure juste au moment où son écuyer, Gabriel de Malleville, se faisait amener un cheval harnaché. En la voyant paraître il y renonça et courut à sa rencontre :
— Dieu soit loué, Madame la Duchesse, vous voilà ! Je me disposais à vous aller chercher.
— Vous saviez où je me trouvais ? Vous étiez absent lors de mon départ et je n’avais pas ordonné de vous le dire…
— Ce n’était pas difficile à deviner : dès qu’un souci vous tourmente vous vous précipitez à Lésigny.
— Et qu’aviez-vous à me confier de si urgent ?
— Ceci ! M. de Brantes est arrivé il y a un quart d’heure… avec des bagages !
En effet, au milieu de l’agitation normale d’un hôtel ducal – écurie, ravitaillement, etc. –, deux valets déchargeaient un coffre de l’arrière d’un carrosse trop poussiéreux pour une lecture facile des armoiries. Marie fronça le sourcil :
— Mon beau-frère ? Que vient-il faire ?
— S’installer. Du moins cela y ressemble.
— Et vous l’avez laissé faire ?
Le nez du gentilhomme normand se plissa légèrement tandis que, dans ses yeux noisette, une flamme amusée s’allumait. Bien que n’appartenant à la maison de Mme de Luynes que depuis une année, il s’était attaché à elle juste ce qu’il fallait pour en faire un garde du corps attentif et dévoué. Par bonheur une blessure d’amour déjà ancienne l’avait gardé de sa séduction et, ayant toujours pris plaisir à l’étude de ses contemporains, il en avait trouvé un plus vif encore à « délabyrinther » les méandres de cette petite âme frivole, un rien friponne, avide de rencontrer enfin celui qui saurait enflammer à la fois ses sens exigeants et un cœur dont il était facile de deviner qu’il ignorait tout des affres de la passion, n’ayant pas encore battu réellement. En revanche, Marie l’amusait beaucoup et s’il avait conçu une inquiétude en voyant débarquer l’ineffable beau-frère, il supputait avec un brin de gourmandise la réception dont la belle Marie allait le régaler.
Au physique, Gabriel de Malleville n’empruntait pas grand-chose à son archangélique patron sinon une épée qui, pour n’être pas flamboyante, n’en avait pas moins prouvé à maintes reprises sa redoutable efficacité. Né dans le Cotentin, il avait néanmoins le cheveu noir, le teint brun et l’un de ces profils aquilins peu répandus sur sa terre natale laissant supposer qu’une de ses aïeules pouvait avoir eu quelques bontés pour un Sarrasin migrateur. Tout en longueur avec des bras et des jambes interminables, c’était un faux maigre dont l’ossature solide se couvrait d’une mince couche de muscles durs comme fer. Entre la moustache conquérante et la « royale » agressive, sa grande bouche abritait des dents carnassières dont il entretenait la blancheur à l’aide d’une poudre que lui procurait un apothicaire de ses amis. Toujours tiré à quatre épingles, il croyait aux vertus de l’eau et du savon, détail qu’appréciaient les dames de la maison. Comme l’avait fait remarquer Elen, ce n’était pas si courant à une époque où les parfums servaient souvent à masquer de déplaisantes odeurs corporelles.
Il s’apprêtait donc à suivre la Duchesse à la rencontre de son beau-frère, mais elle le pria de n’en rien faire et de s’occuper plutôt à ce que les coffres déjà déposés réintégrassent le carrosse.
— Dans un quart d’heure, M. de Brantes les aura rejoints, prédit-elle. Peut-être même avant…
Ayant dit, elle rentra chez elle et, suivie d’Elen, gagna à pas rapides son appartement où le prédateur entendait s’installer. Elle le trouva en effet dans son cabinet particulier tendu de précieuses tapisseries des Flandres à personnages dont les vives couleurs se relevaient de fils d’or. Vautré au coin de la cheminée dans un vaste fauteuil de velours vert, ses pieds bottés posés sur les chenets, il sirotait un verre de vin dont le laquais planté auprès de lui tenait une bouteille à sa disposition.

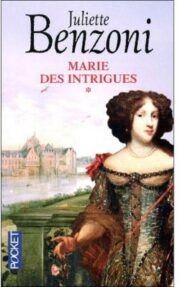
"Marie des intrigues" отзывы
Отзывы читателей о книге "Marie des intrigues". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Marie des intrigues" друзьям в соцсетях.