En sa cinquantième année – elle avait eu quarante-neuf ans onze jours plus tôt –, la princesse apparaissait comme une grande femme maigre et lourde aux yeux bleus délavés cernés de paupières rougies. Dans son visage on ne voyait guère que son grand nez agressif, un véritable nez Bourbon celui-là. Le teint était médiocre, l’élégance nulle car elle avait un talent particulier pour rendre à peu près informes les créations les plus réussies des meilleurs modistes. Qu’elle eût grand air était incontestable mais contrairement à celui de Marie-Antoinette, fait de dignité souriante, le grand air de la Dauphine se nuançait de dédain et d’une éternelle mauvaise humeur entretenue d’ailleurs par les foucades incessantes de sa belle-sœur, la jeune et turbulente duchesse de Berry.
Ce n’était jamais un grand plaisir que se trouver en sa présence. Pour Hortense cette entrevue représentait une dure épreuve en un tel jour, car, après les trois révérences, Madame la Dauphine se mit à examiner avec attention et en silence la fille d’Henri Granier. Un silence que nul ne pouvait se permettre de rompre mais qui ne tarda pas à devenir si pénible que Mère Madeleine-Sophie prit sur elle de le briser.
— Madame, dit-elle doucement, si Votre Altesse Royale veut bien me pardonner, je me permettrai de lui rappeler que cette enfant a subi aujourd’hui une épreuve capable d’abattre les plus braves et les plus solides. Elle n’a que dix-sept ans…
— Elle est grande, pour son âge, et semble vigoureuse, remarqua la princesse de sa voix rauque due à une ancienne laryngite mal soignée. Nous avons voulu vous voir, Mademoiselle, pour vous dire toute la part que nous prenons à votre deuil et examiner, avec vous, ce qu’il convient de décider pour votre avenir. Vos études sont dans leur dernière année, paraît-il ?
— En effet, Madame, et s’il plaît à Votre Altesse Royale, si notre Mère générale le veut bien, mon avenir immédiat se situe ici jusqu’à la fin de l’année scolaire.
— C’est la sagesse, dit Mère Madeleine-Sophie avec un sourire encourageant. Hortense est une excellente élève, très douée en toutes sortes de matières… Et nous souhaitons vivement la garder. Plus longtemps même que cette année si elle le désire. Notre maison est, je crois, un bon refuge pour ceux qui souffrent.
— Sans doute, sans doute, fit la princesse d’un ton agacé en agitant sa tête chapeautée de plumes noires qui lui donnaient assez l’aspect d’un cheval de corbillard, mais il n’entre pas dans les vues du Roi que Mademoiselle demeure ici plus longtemps. Et vous ne devriez pas le souhaiter, ma Révérende Mère. Ce qui vient de se passer ne peut que créer une atmosphère de trouble et d’agitation au sein de votre communauté. Les bruits qui courent sur les derniers instants de son père…
Le mince visage de la Mère Barat s’empourpra.
— Puis-je rappeler à Votre Altesse Royale que cette maison, placée sous le vocable et sous la protection du Cœur Sacré de Jésus, ne connaît pas les bruits et qu’il ne saurait être question d’agitation ou de troubles là où mes sœurs et moi nous trouvons. Toutes ici nous aimons et nous plaignons Hortense !
— Votre générosité nous est connue, Mère Barat, mais vous ignorez à la fois ce qu’est le monde et ce que veut la loi. Mlle Granier n’est pas seule au monde. Elle a de la famille et, Dieu merci, une famille autrement convenable…
Instantanément Hortense plongeait dans une nouvelle révérence :
— Daigne Votre Altesse Royale me permettre de me retirer. Mon père vient à peine d’être déposé dans sa tombe et il m’est impossible de supporter sur lui la moindre parole critique.
— Vous resterez ici tant que nous le souhaiterons, Mademoiselle ! Mais quelle humeur est la vôtre ? Vous oubliez à qui vous parlez !
— Non, Madame. Votre Altesse Royale voudra bien accueillir mon respect et mes adieux. Puisqu’elle désire me voir quitter cette maison, il me reste à rentrer chez mes parents…
— Il ne peut en être question ! Votre oncle, le marquis de Lauzargues, sera vraisemblablement nommé tuteur. Ou tout au moins chargé de vous garder par-devers lui jusqu’à ce que vous vous trouviez en puissance de mari. Le désir du Roi est que vous le rejoigniez sur ses terres afin d’y vivre en famille comme il convient à une fille de votre âge… et de votre condition.
— Mais je ne veux pas aller chez lui ! Le marquis a jadis renié ma mère, sa propre sœur. Je n’ai que faire de lui !
— Hortense ! s’écria la Mère de Gramont, vous vous oubliez.
— Laissez, ma chère ! Nous connaissons ces sortes de filles. Les temps barbares que la France vient de vivre n’en ont produit que trop. Celle-ci obéira… comme les autres. Allez, Mademoiselle ! Vous recevrez bientôt nos volontés !
— Madame ! plaida la Mère générale, Votre Altesse Royale est trop dure…
— Et vous trop bonne ! Vous pouvez vous retirer, Mademoiselle !
La révolte au cœur, Hortense fit une dernière révérence, mais une seule. Les jambes lui manquaient pour les deux autres. Elle recula vers la porte suivie des yeux par le regard navré de Mère Madeleine-Sophie, puis se jeta hors de la pièce comme on se sauve. Elle sentait monter les larmes et ne voulait pas donner à cette affreuse femme le plaisir de la voir pleurer. Elle courut d’une traite jusqu’à la chapelle et là s’abattit sur les marches de l’autel, secouée de sanglots désespérés…
Huit jours plus tard, elle recevait l’ordre de partir pour le château de Lauzargues, en Auvergne, où le marquis attendait sa nièce. Il ne pouvait être question de discuter un ordre royal, moins encore d’y résister. La rage au cœur, Hortense Granier de Berny fit ses préparatifs de départ. Quant à Félicia Orsini, elle n’avait pas reparu.
CHAPITRE II
VOYAGE VERS LA TERRE INCONNUE…
La voiture quitta la petite ville dans les dernières heures de l’après-midi, ce qui laissait supposer que l’on pourrait arriver au jour. Pourtant, la nuit s’annonçait déjà. Elle n’avait guère de peine à remplacer les lourds nuages fuligineux qui fuyaient avec le vent d’un bout à l’autre du paysage mais, pour Hortense, qu’il fasse jour ou nuit était de peu d’importance. Elle se sentait si lasse, si moulue que tout s’abolissait qui n’était pas sa fatigue et l’angoisse qui ne la quittait plus depuis Paris.
Six jours ! Six jours depuis Paris. Quatre jusqu’à Clermont-Ferrand, enfermée dans le coupé de la grosse diligence noire et jaune en compagnie d’un curé auvergnat qui sentait l’ail et le fromage, d’un notaire de Rodez et de la riche gantière de Millau, sœur d’une des religieuses du Sacré-Cœur, à qui Mère Madeleine-Sophie l’avait confiée avec toutes sortes de recommandations. Superflues d’ailleurs. Mme Chauvet était une femme à la fois solide et rassurante. Pleine de bon sens et douée d’un cœur généreux, elle était de celles avec qui l’on irait volontiers au bout de la terre tant elles montrent de sang-froid et de placidité en face des menus inconvénients de chaque jour. Et Dieu sait s’il y en avait au cours d’un voyage en diligence !
Mais, dûment renseignée sur la catastrophe dont sa jeune compagne venait d’être victime, Eulalie Chauvet s’efforçait de lui éviter tout tracas et de lui rendre aussi confortable que possible ce long voyage vers l’inconnu. Le tout dans un silence presque total car, timide, elle se montrait peu causante. Ce dont Hortense lui savait gré. Il était déjà bien assez éprouvant de subir, à longueur de journée, les monologues politiques du notaire traitant presque sans discontinuer du nouveau ministère Martignac, du « milliard des émigrés », des abus de la Congrégation et des bals trop somptueux de Mme la duchesse de Berry.
Pour éviter qu’elle n’eût à en subir davantage à la table d’hôtes, au cours des haltes dans les auberges, Mme Chauvet se faisait servir, avec Hortense, dans la chambre qu’elles partageaient. Mais elles n’en arrivèrent pas moins à Clermont sans que la jeune fille eût appris la moindre chose touchant la vie de sa compagne et sans avoir dû répondre à la plus petite question. Ce fut elle d’ailleurs qui, en arrivant dans la capitale auvergnate, se hasarda à parler de sa famille.
— Ma mère me parlait parfois d’une tante qu’elle avait à Clermont. Une tante qu’elle aimait beaucoup et chez qui… elle avait rencontré mon père. J’ignore si elle l’a revue depuis son mariage mais je sais qu’elles s’écrivaient. J’aurais… aimé la connaître. A moins qu’elle ne soit plus de ce monde… De toute façon, je ne sais comment faire.
— Pouvez-vous me donner son nom ?
— Bien sûr. La comtesse de Mirefleur…
— Je vais m’informer.
Une heure plus tard, Hortense avait sa réponse : Mme de Mirefleur vivait toujours, Dieu soit loué, mais son hôtel de la rue des Gras était fermé. Assez secouée par un mauvais rhume à la fin de l’été, la comtesse était allée passer les mauvais jours en Avignon chez sa fille, la baronne d’Esparron.
— Elle reviendra au printemps, dit Mme Chauvet. Vous pourrez sûrement la rencontrer à cette époque-là.
— Le printemps ? Il me paraît si loin…
Tout juste deux mois, puisque nous sommes fin janvier. Elle hésita un instant puis, timidement :
— Pardonnez-moi si je me montre indiscrète et, en ce cas, ne me répondez pas, mais… n’êtes-vous pas heureuse de retrouver votre famille ? Le marquis de Lauzargues est votre oncle, si je ne me trompe ?
— Oui. Pourtant je n’ai aucune envie de le voir. Je ne vais chez lui que contrainte et forcée…
— Pardonnez-moi… mais peut-être que lui sera heureux de vous recevoir. Il paraît que vous ressemblez beaucoup à votre mère. Cette circonstance le touchera très certainement…

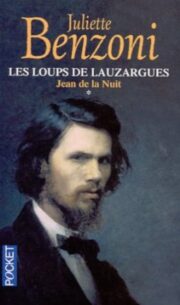
"Jean de la nuit" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jean de la nuit". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jean de la nuit" друзьям в соцсетях.