Juliette Benzoni
Jean de la Nuit
Première Partie
LE CHÂTEAU DES SOLITUDES
CHAPITRE PREMIER
LE CAUCHEMAR
L’homme et la femme fuyaient en aveugles à travers la forêt, poursuivis par le hurlement des loups. Ils fuyaient mais la clameur sauvage était sur eux, les enveloppait, barrait tous les passages. L’homme s’efforçait d’entraîner sa compagne dont il tenait la main. Mais, bientôt, il ne leur resta plus qu’une étroite clairière environnée par un cercle infernal qui se resserrait, se resserrait… Des yeux flamboyants, des gueules sanglantes surgissaient des ténèbres et les guettaient. Le couple ne fut plus qu’une seule silhouette noire et blanche qui semblait s’amincir d’instant en instant à force de s’étreindre. Une bête énorme jaillit, s’envola, s’abattit sur sa proie avec un rire qui était celui d’un homme… Le double cri d’agonie domina le chœur triomphant de la terrible meute. La forêt s’emplit de sang. Le flot bouillonnant déborda des futaies, glissa sur le sol de la clairière, un sol qui n’était point fait de feuilles et d’herbe mais d’une mosaïque de bois précieux à demi couverte d’un tapis bleu de France orné de fleurs de lys. Il envahit tout, noyant la clairière, les loups et leurs victimes, étouffant une dernière plainte… qui réveilla Hortense.
Trempée de sueur, le cœur fou, elle se retrouva assise sur son lit. Le silence du dortoir l’enveloppa comme un linge glacé, bloquant le cri de terreur dans sa gorge, apaisant un peu la fièvre du cauchemar. La jeune fille passa une main tremblante sur ses yeux que des taches rouges brouillaient encore et la retira mouillée de larmes car cet homme, cette femme qu’elle venait de voir mourir de si abominable façon, c’étaient son père et sa mère.
Elle eut besoin d’un bon moment pour reprendre le contrôle d’elle-même, remettre les choses à leur place réelle. Ce rêve était horrible, effrayant, mais stupide, forêts et loups n’ayant guère droit de cité à Paris en cette fin de l’année 1827. Or, à l’instant où leur fille les voyait succomber sous une horde, Henri et Victoire Gravier de Berny devaient dormir paisiblement dans leur élégant hôtel de la Chaussée d’Antin… Demain, d’ailleurs, Hortense les y rejoindrait puisque demain commençait le temps de Noël…
Autour d’elle, tout était silence mais un silence vivant peuplé de souffles imperceptibles, légers comme des battements d’ailes, privilèges de l’extrême jeunesse. Vingt jeunes filles de quinze à dix-huit ans dormaient dans vingt lits blancs, tous semblables… toutes presque semblables, à la couleur de cheveux près. Des nattes blondes, brunes, rousses, châtaines signaient les pages blanches des draps et des oreillers, si rassurantes dans leur aspect familier que leur compagne, peu à peu, retrouva son calme. Les battements désordonnés de son cœur s’apaisèrent et le souvenir du cauchemar se dilua, chassé par la douce lumière de la veilleuse allumée au chevet de la sœur surveillante, derrière la transparence de ses rideaux blancs.
Pour achever de le dissiper, Hortense marmotta une courte invocation à son ange gardien, se recoucha, ferma les yeux et se rendormit. Un instant après le dortoir des grandes avait retrouvé sa paix et son nombre habituel de souffles légers…
Quand la cloche sonna le réveil, le matin revenu, Hortense avait presque oublié son vilain rêve. L’atmosphère, il est vrai, n’était pas à la mélancolie. Dans quelques dizaines de minutes, le portail des Dames du Sacré-Cœur allait s’ouvrir pour les vacances de Noël et le dortoir, en dépit des protestations de la sœur surveillante, ressemblait à une ruche en folie. Les élèves ne pouvaient plus penser qu’aux fêtes qui les attendaient chez elles. Quant à celles qui – soit pour cause d’éloignement, soit pour toute autre raison familiale – ne quitteraient pas l’institution, elles savaient que la discipline, durant ces quelques jours, subirait un certain relâchement et que la Noël revêtirait, comme d’habitude, un éclat exceptionnel du fait de la visite, dûment annoncée, de Son Altesse Royale Madame la Duchesse d’Angoulême, belle-fille du roi Charles X et Dauphine de France.
Ce n’était certes pas la personnalité de Madame qui déchaînait l’enthousiasme des « restantes ». La fille de Louis XVI, le Roi martyr, et de l’éblouissante Marie-Antoinette était sans doute la princesse la plus désagréable de toute la chrétienté. La cinquantaine qu’elle allait atteindre n’arrangeait rien et si sa piété était exemplaire, son abord était assez rude pour décourager les plus courageuses. Mais on savait qu’un mirifique goûter serait servi à cette occasion et que les jeunes filles dont le maintien trouverait grâce sous son œil sévère avaient quelque chance de voir, par la suite, Madame se charger de leur établissement. D’autant que l’on serait en comité restreint. Beaucoup plus que pour la fête du Sacré-Cœur où la princesse, protectrice de la maison, avait coutume de venir passer en revue l’effectif complet des élèves.
Hortense pour sa part était ravie de ne pas assister à la visite. Elle n’était pas assez bien « née » pour avoir la moindre chance de figurer dans les bonnes grâces d’une princesse à laquelle, d’ailleurs, elle trouvait encore moins de charme qu’au maréchal Oudinot, commandant de la Garde nationale. Madame aurait fait une parfaite supérieure de Carmel et le joli titre de Dauphine lui était à peu près aussi seyant qu’un bonnet de dentelle à un grenadier… Il serait infiniment plus doux de retrouver, ce soir, sa ravissante mère, son merveilleux père, sa chère maison et même l’assommante Mlle Baudoin, sa gouvernante. Enfin, passé Noël, il ne resterait plus que deux trimestres à user chez les Dames du Sacré-Cœur car l’hiver prochain verrait ses dix-sept ans et son entrée dans le monde.
Non qu’elle aimât particulièrement la vie de société, tout au moins celle que sa mère prisait tant, mais quitter le Sacré-Cœur ce serait en finir définitivement avec une cohabitation qui lui était souvent pénible et une atmosphère qui lui pesait. Elle tenait en effet de son père un caractère volontaire et fier, un goût de l’indépendance et du bon combat qui lui rendaient difficile la fréquentation des filles d’émigrés rentrés en France dans les fourgons de l’étranger avec leurs vieux rois Bourbons. Leurs dédains répondaient à son indifférence méprisante. On l’appelait « la Bonapartiste » parce que l’Empereur avait anobli son père mais ce sobriquet ne la gênait pas. Elle s’en parait, au contraire, comme d’une couronne sans jamais laisser oublier qu’une reine de Hollande, même détrônée, était sa marraine et Napoléon son parrain.
Elle aurait cent fois préféré rejoindre, à la Légion d’honneur, son amie Louise de Lusigny mais Louise, fille d’un général tué à Leipzig avec le prince Poniatowski, avait tous les droits d’être élevée dans cette maison où l’on ne considérait pas comme une tare les services rendus à l’Empire. Quant à Hortense, fille d’un des banquiers du Roi, elle ne pouvait, sans indisposer à la fois la Cour, la toute-puissante Congrégation[1] et la duchesse d’Angoulême, recevoir une éducation autre que celle des Dames du Sacré-Cœur.
Ce matin-là le climat n’était pas à l’austérité. La messe matinale et les divers exercices de piété furent suivis avec une distraction qui frisait la désinvolture et qui valut quelques rappels à l’ordre. Enfin, vint le temps bienheureux d’endosser les vêtements de sortie car l’heure approchait où les voitures allaient paraître. Et cinq minutes avant dix heures, les pensionnaires de la maison, rangées en ordre parfait, se soumettaient à l’examen de la Mère de Gramont, maîtresse principale.
A dix heures juste, la première voiture se montrait au portail de la rue de Varenne. L’un après l’autre, dans un ordre quasi processionnel, les équipages franchissaient le seuil de la cour, décrivant une courbe parfaite pour s’arrêter finalement au perron. L’élégance des attelages, la robe luisante des chevaux, les caisses laquées des voitures, le cliquetis des gourmettes d’argent et les livrées des cochers réveillaient les vieux murs de l’ancien hôtel des ducs de Biron, jadis témoins des fêtes galantes et des plaisirs raffinés d’un siècle où l’art de vivre avait atteint le degré suprême.
Les temps avaient changé. Les carrosses dorés, les perruques poudrées, les satins nacrés, les plumes et les dentelles de naguère s’étaient enfuis avec le fantôme léger de l’adorable marquise de Coigny, la blonde maîtresse de l’arrogant Lauzun, dernier duc de Biron, héros de la guerre d’Indépendance américaine et victime méprisante d’une révolution qu’il avait pourtant servie. Néanmoins, un jour, un seul, l’hôtel avait revécu.
Ce jour-là – le 17 septembre 1820 – les lustres retrouvèrent leurs bougies, les girandoles de cristal leur éclat limpide, les nymphes de Boucher ou de Fragonard leur sourire coquin : vendue par sa dernière propriétaire, la duchesse de Béthune-Charost, aux Dames du Sacré-Cœur avec l’aide financière du roi Louis XVIII, la maison s’ouvrait à la visite de ses nouvelles occupantes. Une cinquantaine de fillettes et de jeunes filles sous la conduite de la Mère de Gramont s’aventura sur les parquets de bois précieux et put contempler dans toute sa beauté ce merveilleux reflet d’un siècle enfui. Mais les jeunes visiteuses ne venaient pas pour rester. Pas encore. Et on les ramena rue de l’Arbalète tandis que les ouvriers faisaient leur apparition.
La maison s’éteignit pour toujours. Glaces, lustres, meubles fragiles, peintures aimables disparurent. Les boiseries blanc et or qui encadraient, sur les murs des salons, une exubérante flore exotique reçurent une épaisse couche de la plus disgracieuse, la plus affligeante peinture marron dont la vue atterra les jeunes filles au jour de leur installation. L’odeur de la cire et de l’encens remplaça définitivement celles de l’iris, de la violette et de la poudre à la Maréchale. La verveine n’eut plus droit de cité qu’en tisanes…

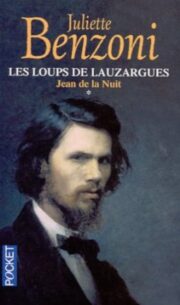
"Jean de la nuit" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jean de la nuit". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jean de la nuit" друзьям в соцсетях.