— La voilà !
Et, en un instant, le perron se couvrit d’un groupe de femmes en robe de soirée, d’hommes en frac au milieu desquels souriaient la figure pointue, la barbiche et les vifs yeux noirs d’Arcadius de Joli-val. Mais ce ne fut pas lui qui s’avança vers la voiture... Du groupe se détacha un homme très grand et suprêmement élégant dont la boiterie légère s’appuyait sur une canne à pommeau d’or. Le visage hautain, les froids yeux bleus s’éclairaient d’un sourire plein de chaleur et Marianne, muette de stupeur, vit M. de Talleyrand écarter d’un geste les valets, marcher jusqu’à la voiture, en ouvrir lui-même la portière et lui offrir sa main gantée en disant d’une voix forte :
— Soyez la bienvenue dans la demeure de vos ancêtres, Marianne d’Asselnat de Villeneuve ! La bienvenue aussi parmi vos amis et parmi vos pairs ! Vous revenez d’un plus long voyage que vous ne l’imaginez, mais nous sommes tous réunis ici, ce soir, pour vous dire combien nous en sommes profondément heureux !
Pâle tout à coup et les yeux égarés, Marianne regarda la foule brillante qui lui faisait face. Elle vit au premier rang Fortunée Hamelin qui riait et pleurait, elle vit aussi Dorothée de Périgord en blanc et Mme de Chastenay qui lui faisait des signes dans son taffetas mauve, elle vit d’autres visages encore qui, jusque-là, ne lui avaient pas été très familiers, mais auxquels elle pouvait attribuer les plus grands noms de France : Choiseul-Gouffier, Jaucourt, La Marck, Laval, Montmorency, La Tour du Pin, Bauffremont, Coigny, tous ceux qu’elle avait rencontrés rue de Varenne quand elle était simple lectrice de la princesse de Bénévent. D’un seul coup, elle comprit qu’ils étaient venus là, ce soir, entraînés par Talleyrand, non seulement pour l’accueillir, mais pour lui rendre enfin la place qui, par droit de naissance, était la sienne et que seul le malheur lui avait fait perdre.
La vision des robes claires, des joyaux scintillants se brouilla. Marianne posa dans la main offerte ses doigts soudain tremblants. Elle descendit, s’appuyant lourdement à cette main amie.
— Et maintenant, s’écria Talleyrand, place, mes amis, place à Son Altesse Sérénissime la princesse Sant’Anna à qui j’offre, en votre nom et au mien, tous nos vœux de bonheur les plus chaleureux !
Aux applaudissements de toute la société, il l’embrassa sur les deux joues avant de lui baiser la main.
— Je savais bien que vous nous reviendriez ! chuchota-t-il contre son oreille. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit, aux Tuileries, un jour d’orage ? Vous êtes l’une des nôtres et vous n’y pourrez jamais rien changer.
— Croyez-vous que l’Empereur pense comme vous ?
L’Empereur ! Toujours l’Empereur ! Malgré elle, Marianne n’arrivait pas à échapper à l’idée obsé-dante de l’homme qu’elle ne pouvait s’empêcher d’aimer toujours.
Talleyrand fit la grimace.
— Il se-peut que vous ayez quelques ennuis de ce côté... mais venez, on vous attend ! Nous parlerons plus tard.
Triomphalement, il mena la jeune femme vers ses amis. En un instant, elle fut entourée, embrassée, félicitée et passa des bras, abondamment parfumés à la rose, de Fortunée Hamelin à ceux, fleurant bon le tabac et l’iris, d’Arcadius de Jolival. Elle se laissait faire, incapable même de penser. Tout cela était trop soudain, trop inattendu, et Marianne avait peine à réagir. Tandis que, dans le grand salon, Talleyrand portait un toast à son retour, elle prit Arcadius à part.
— Tout cela est très touchant, très agréable, mon ami, mais je voudrais comprendre. Comment avez-vous su que je rentrais ? Tout semble préparé comme si vous m’attendiez ?
— Mais je vous attendais. J’ai été certain que vous rentriez aujourd’hui quand on a apporté ceci.
Ceci, c’était un large papier timbré d’un sceau dont l’aspect fit battre plus vite le cœur de Marianne. Le sceau de l’Empereur ! Mais le texte, très sec, n’avait rien de réconfortant.
« Par ordre de Sa Majesté l’Empereur et Roi, la princesse Sant’Anna devra se présenter le mercredi 20 juin, à quatre heures de relevée, au Palais de Saint-Cloud. » C’était signé : « Duroc, duc de Frioul, grand maréchal du Palais. »
— Mercredi 20, c’est demain, remarqua Jolival, et on ne vous convoquerait pas si l’on ne savait que vous serez à même de vous y rendre ? Donc, cela signifiait que vous rentriez aujourd’hui... De plus, Mme de Chastenay est accourue ici en sortant de chez le duc de Rovigo.
— Comment pouvait-elle savoir que l’on ne me garderait pas ?
— Elle l’a demandé à Savary, tout simplement... mais venez, chère Marianne. Je n’ai pas le droit de vous accaparer ainsi. Vos hôtes vous réclament. Vous n’imaginez pas à quel point vous êtes devenue célèbre depuis que Florence a communiqué ici la nouvelle de votre mariage...
— Je sais... mais, mon ami, j’aurais tellement préféré demeurer seule avec vous, au moins ce soir. J’ai tant à vous dire !
— Et j’ai tant à entendre ! répondit Arcadius en serrant affectueusement le bout des doigts de son amie. Mais M. de Talleyrand m’avait fait promettre de l’avertir dès que je saurais quelque chose. Il tenait à ce que votre rentrée ici eût quelque chose de... triomphal...
— Une façon comme une autre de me faire entrer... un peu de force, dans son clan, n’est-ce pas ? Mais il faudra pourtant bien qu’il admette qu’en moi rien n’est changé. Mon cœur ne saurait évoluer si vite.
Songeuse, elle considérait l’ordre impérial qu’elle n’avait pas lâché, cherchant à évaluer ce qui se cachait derrière les mots si brefs, presque menaçants. Elle l’agita légèrement sous le nez de Jolival.
— Qu’en avez-vous pensé en le recevant ?
— Honnêtement, rien du tout !... On ne peut jamais savoir ce que l’Empereur a derrière la tête. Mais je parierais qu’il n’est pas content.
— Ne pariez pas, vous gagneriez, soupira Marianne. Je peux certainement m’attendre à passer au moins un mauvais moment ! Pour l’instant, soyez gentil, Arcadius, continuez à vous occuper de mes hôtes pendant que je vais me rafraîchir un peu et me changer. Après tout, je tiens, pour cette première fois, à remplir dignement mon rôle de maîtresse de maison. Je leur dois bien cela.
Elle allait se diriger vers l’escalier quand elle se ravisa :
— Dites-moi, Arcadius. Avez-vous des nouvelles d’Adélaïde ?
— Aucune, fit Jolival en haussant les épaules. Le Théâtre des Pygmées est fermé pour le moment et je me suis laissé dire qu’il s’est momentanément transporté... aux eaux d’Aix-la-Chapelle. Je suppose qu’elle y est aussi.
— Quelle histoire stupide ! Enfin, cela la regarde ! Et...
Marianne eut une toute légère hésitation puis, se décidant :
— ... et Jason ?
— Pas de nouvelles non plus, répondit Arcadius impassible. Il a dû faire voile vers l’Amérique et votre lettre l’attend sans doute encore à Nantes.
— Ah !
Ce fut presque un soupir, une très petite exclamation si brève qu’il était impossible d’y déceler un sentiment, pourtant il traduisait un bizarre pincement au cœur. Bien sûr, la lettre laissée à Patterson n’avait plus d’importance, bien sûr les dés étaient jetés, les jeux étaient faits et il n’y avait plus à y revenir, mais c’étaient des semaines d’espoir qui débouchaient ainsi sur le vide. Marianne découvrait que la mer était immense et qu’un navire n’y était qu’un fétu, qu’elle avait lancé un cri dans l’infini et que l’infini n’avait pas d’écho. Jason ne pouvait plus rien pour elle... et pourtant, tout en remontant lentement vers sa chambre, Marianne découvrait qu’elle avait toujours la même envie de le revoir... C’était étrange alors même que, dès le lendemain, il lui faudrait affronter la colère de Napoléon, soutenir encore, en face de lui, une de ces luttes épuisantes où l’amour la laissait si vulnérable... Il y aurait là une heure difficile. Cependant, elle ne s’en inquiétait pas. Obstinément, sa pensée retournait sur la mer, à la suite d’un navire qui n’était pas entré au port de Nantes. C’était drôle, d’ailleurs, cette Insistance avec laquelle revenait le souvenir du marin ! C’était comme si la jeunesse de Marianne, peuplée de rêves un peu tous et du désir profond, presque viscéral, de l’aventure, s’accrochait à lui, l’homme de l’aventure par excellence, pour refuser la réalité et survivre encore.
Pourtant, l’heure de l’aventure était passée. En écoutant le brouhaha distingué, sur une ariette de Mozart, qui montait vers elle par la fenêtre ouverte, la nouvelle princesse pensa que c’était le prélude à une tout autre vie, une vie adulte, toute de calme, de dignité que l’enfant pourrait partager. Quand, demain, elle aurait fini de s’expliquer avec l’Empereur, il n’y aurait plus rien d’autre à faire que laisser couler les jours... que vivre comme tout le monde ! Hélas !... A moins que, malgré son mariage, Napoléon eût gardé assez d’amour pour elle, à moins qu’à nouveau il n’arrachât la mère de son enfant à cette vie terne qu’elle n’imaginait pas sans inquiétude, à moins que Marianne ne fût assez forte pour reprendre l’homme qu’elle aimait...
2
LA PREMIERE FELURE
4 heures sonnaient à l’horloge encastrée dans le fronton central du palais de Saint-Cloud quand Marianne gravit le grand escalier construit au siècle précédent. Elle se sentait mal à l’aise, moins à cause des regards qui, depuis la cour d’honneur, s’étaient attachés à elle et dont elle se sentait suivie, qu’à la pensée de ce qui l’attendait dans cette demeure inconnue. Deux mois et demi s’étaient écoulés depuis la dramatique scène des Tuileries et c’était la première fois qu’elle allait « le » revoir. Cela suffisait à faire trembler son cœur.
Une petite note, jointe à la convocation impériale, lui avait indiqué que, la cour portant actuellement le deuil du prince royal de Suède, les grands atours n’étaient pas de mise et qu’elle devait se présenter en « robe ronde » et « coiffure de fantaisie ». Elle avait donc opté pour une robe sans traîne en épais satin blanc et sans autre ornement que des manches-ballons assez volumineuses et l’agrafe d’or et de perles qui marquait, sous les seins, son étroite ceinture. Une toque de même tissu, garnie de plumes d’autruche noires et blanches qui frisaient le long de son cou, coiffait son opulente chevelure sombre et une grande écharpe de cachemire noir et or drapait l’une de ses épaules pour glisser doucement, derrière son dos, jusqu’au creux de l’autre bras. Des perles en poire aux oreilles et des bracelets d’or portés sur les longs gants blancs montant jusqu’au bord des manches complétaient une toilette que toutes les femmes regardaient avec une admirative curiosité. Sur ce point, d’ailleurs, Marianne n’avait aucune inquiétude. Elle en avait médité chaque détail, depuis la simplicité voulue de la robe qui rendait pleine justice à la ligne de ses jambes jusqu’à l’absence de joyaux autour de son long cou souple pour ne pas rompre l’harmonie de sa courbe qui s’attachait avec tant de grâce aux épaules rondes. Jusqu’à la lisière neigeuse de la robe, audacieusement décolletée, sa peau dorée laissait voir sans entrave son éclat chaleureux auquel, Marianne le savait bien, Napoléon s’était toujours montré sensible. Sur le plan physique, sa réussite était totale et sa beauté parfaite. Restait le plan moral.

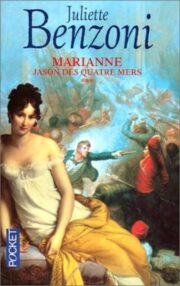
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.