Juliette Benzoni
Jason des quatre mers
LE COURRIER DU TZAR
1
LA BARRIERE DE FONTAINEBLEAU
La voiture franchit en trombe la porte d’Aix et s’engouffra dans les ruelles étroites et sombres du vieil Avignon. Le soleil encore haut dorait les remparts, ciselant leurs créneaux bien dessinés, leurs tours carrées, et arrachait des éclairs au fleuve nonchalant dont les eaux jaunes coulaient sans hâte sous les arches épargnées du vieux pont Saint-Bénezet à demi écroulé. Sur la plus haute tour du formidable palais des papes, la statue de la Vierge brillait comme une étoile. Pour mieux voir, Marianne avait baissé la vitre poussiéreuse et respirait avec délices l’air tiède chargé de toutes les senteurs de la Provence, où se mêlaient l’olivier, le thym et le romarin.
Il y avait maintenant quinze jours qu’elle avait quitté Lucques. On avait pris la route de la Côte, puis celle de la vallée du Rhône et voyagé à petites journées, tant pour ménager Marianne elle-même qui approchait de son quatrième mois de grossesse et dont l’état réclamait quelque prudence, que pour ne pas trop fatiguer les chevaux. Ce n’étaient plus, en effet, de vulgaires postiers qui étaient attelés à la berline, mais bien quatre superbes coureurs des écuries Sant’Anna. On faisait environ dix lieues dans la journée et, chaque soir, l’on s’arrêtait dans quelque auberge.
Ce voyage avait été pour Marianne l’occasion de s’apercevoir combien sa condition avait changé. La beauté des chevaux, les armoiries peintes sur les portières de sa berline et la couronne fermée qui les surmontait lui assuraient partout un accueil, non seulement empressé, mais encore tout plein de déférence. Et elle avait découvert qu’il y avait quelque charme à être une très grande dame. Quant à Gracchus et Agathe, ils éclataient visiblement d’orgueil d’être au service d’une princesse et ne le laissaient ignorer à personne. Il fallait voir Gracchus entrer chaque matin dans la salle de l’auberge où l’on avait fait halte et annoncer pompeusement que « la voiture de Son Altesse Sérénissime attendait... ». L’ancien commissionnaire de la rue Montorgueil n’était manifestement pas loin de se prendre pour un cocher impérial.
Pour sa part, Marianne trouvait un certain plaisir à ce lent voyage. Le retour à Paris ne lui causait qu’une joie très limitée car, si la perspective de revoir le cher Arcadius lui était agréable, elle n’en craignait pas moins de retrouver dans la capitale toutes sortes d’ennuis, dont l’ombre menaçante de Francis Cranmere n’était évidemment pas le moindre, mais où l’accueil que lui réservait l’Empereur avait aussi son importance. Tant qu’elle était sur les routes, les risques se limitaient à d’éventuelles rencontres avec des brigands, mais jusqu’à présent aucune silhouette inquiétante ne s’était dressée sur le passage de la voiture. Enfin, la route buissonnière avait eu l’avantage de laver son esprit des fantômes et des brumes de la villa Sant’Anna car, de toutes ses forces, la jeune femme s’était refusée à évoquer, même un instant, le visage inquiétant de Matteo Damiani et la silhouette fantastique du cavalier au masque blanc, qui était à jamais son époux. Plus tard, elle y penserait, plus tard... quand elle aurait tracé la nouvelle ligne de vie qui allait être sienne et dont, pour le moment, elle n’avait pas la moindre idée, car elle dépendait entièrement de Napoléon. Il avait, naguère, préparé le chemin d’une chanteuse nommée Maria-Stella, mais qu’allait-il faire de la princesse Sant’Anna ? A vrai dire, ladite princesse ne savait trop, elle-même, ce qu’elle ferait de sa noble personne. A nouveau elle se retrouvait mariée... et mariée sans époux !
L’aspect d’Avignon séduisit Marianne. C’était peut-être le soleil ou le gros fleuve paresseux, la couleur chaude des vieilles pierres ou les géraniums accrochés à tous les balcons de fer, à moins que ce ne soit la chanson soyeuse des oliviers argentés, ou encore l’accent chantant des commères en cotillons bariolés qui s’interpellaient sur le passage de sa voiture, mais elle eut envie d’y demeurer quelques jours avant de se diriger enfin vers Paris. Elle se pencha à la portière :
— Vois s’il y a ici une bonne hostellerie, Gracchus. J’aimerais rester deux ou trois jours. Ce pays est si charmant !
— On peut toujours voir. J’aperçois là-bas une grosse auberge et une belle enseigne et comme, de toute façon, nous devions y faire étape...
En effet, près de la porte de l’Oulle, l’auberge du Palais, l’une des plus anciennes et des plus confortables de la région, dressait ses gros murs ocre couverts de rondes tuiles romaines et ses tonnelles de vignes. C’était aussi un relais de diligence comme l’attestait l’énorme machine poussiéreuse qui venait de s’y arrêter et qui déversait ses passagers ankylosés dans un vacarme de sonnailles, de cris des postillons, d’appels, de joyeuses exclamations, de retrouvailles pour les voyageurs que l’on était venu attendre et d’accent méridional où semblaient rouler tous les cailloux du fleuve.
Debout sur le toit de la diligence, un postillon avait enlevé la grande bâche de toile cirée et était occupé à passer les valises, les sacs de tapisserie et les colis des voyageurs à l’un des palefreniers de l’auberge. Quand il en eut fini avec les bagages, il prit plusieurs paquets de journaux et les lança. C’étaient des exemplaires du Moniteur qui avaient traversé tout le pays pour apporter aux Provençaux les dernières nouvelles de Paris. Mais l’un des paquets, mal attaché, échappa au palefrenier. Les liens qui le serraient se rompirent et les journaux s’éparpillèrent sur le sol.
L’un des valets d’écurie se précipita pour les ramasser mais, ce faisant, ses yeux tombèrent sur les nouvelles de la première page et, soudain, il poussa un cri :
— Bonne Vierge ! Le Napoléon, il a renvoyé son Fouché ! Ça, pour une nouvelle, c’est une nouvelle !
Aussitôt, ce fut un beau vacarme. Les gens de l’auberge et les clients se précipitaient sur les journaux répandus pour s’en emparer et commenter l’événement, parlant tous à la fois.
— Fouché renvoyé ! Mais ce n’est pas possible !
— Bah ! L’Empereur a dû finir par en avoir assez.
— Vous n’y êtes pas ! L’Empereur a voulu faire plaisir à la jeune Impératrice ! Ce n’était pas possible pour elle de rencontrer journellement un ancien régicide, un homme de la Révolution qui a voté la mort de son oncle, le roi Louis XVI !
— Est-ce que cela veut dire que ça va commencer à « chauffer » pour tous ces sans-culottes déguisés en grands personnages ? Ça serait trop beau.
Chacun donnait son opinion et tout le monde parlait en même temps, les uns pour s’étonner, les autres pour se réjouir. La Provence ne s’était jamais sincèrement ralliée au nouveau régime. Elle était demeurée profondément royaliste et la fin de Fouché réjouissait plus qu’elle n’inquiétait.
Marianne, cependant, avait de nouveau appelé Gracchus qui, debout sur son siège, avait suivi toute cette petite scène.
— Va me chercher l’un de ces journaux ! ordonna-t-elle, et fais vite !
— Tout de suite, Madame... dès que j’aurai retenu votre appartement.
— Non. Tout de suite ! Si ces gens ne se trompent pas, il se peut que nous ne restions pas ici.
La nouvelle, en effet, était d’importance pour elle. Fouché, son vieux persécuteur, l’homme qui avait osé, sous la menace, l’introduire chez Talleyrand pour espionner, l’homme qui avait été incapable de l’empêcher de tomber aux mains de Fanchon-Fleur-de-Lys, ou qui ne l’avait pas voulu, l’homme enfin grâce auquel Francis Cranmere avait pu, impunément, se promener dans Paris, l’y faire chanter, enlever Adélaïde d’Asselnat, sa cousine, pour, finalement, s’enfuir du château de Vincennes et regagner l’Angleterre où il pourrait tout à loisir reprendre sa détestable activité, cet homme-là perdait enfin sa dangereuse puissance qui en faisait le maître occulte du pays ! C’était trop beau ! C’était à n’y pas croire...
Pourtant, quand elle eut entre les mains la feuille déjà jaunie par le voyage et salie par la poussière, elle fut bien obligée d’en croire ses yeux. Non seulement Le Moniteur annonçait le remplacement, à la tête du ministère de la Police, du duc d’Otrante par le duc de Rovigo, Savary, mais encore il publiait le texte de la lettre officielle que l’Empereur avait adressée à Fouché :
« Les services que vous m’avez rendus dans les différentes circonstances, écrivait l’Empereur, nous portent à vous confier le gouvernement de Rome jusqu’à ce que nous ayons pourvu à l’exécution de l’article 8 de l’acte des constitutions du 11 février 1810. Nous attendons que vous continuerez dans ce nouveau poste à nous donner des preuves de votre zèle pour notre service et de votre attachement à notre personne... »
D’un geste plein de nervosité, Marianne froissa le journal entre ses mains et laissa la joie l’envahir. C’était encore plus beau qu’elle ne l’avait espéré ! Exilé ! Fouché était exilé ! Car il n’y avait pas à se tromper sur la valeur réelle de ce poste de gouverneur de Rome, beaucoup plus honorifique qu’autre chose. Napoléon voulait voir Fouché loin de Paris. Quant à la raison de cette décision, bien sûr, le journal ne la donnait pas, mais une voix secrète chuchotait à Marianne que les fameux pourparlers sous le manteau avec l’Angleterre n’y étaient pas étrangers...
Une autre nouvelle, d’ailleurs, complètement détachée de celle du renvoi de Fouché et placée assez loin pour que le public n’eût pas l’idée de rapprocher les deux événements, vint renforcer sa conviction. Le jour même où Fouché avait été « remercié », le banquier Ouvrard avait été arrêté, pour malversations et atteinte à la sûreté de l’État, dans le salon d’une brillante Parisienne, bien connue pour son dévouement à la cause impériale. Immédiatement, Marianne songea à Fortunée, aux menaces qu’elle avait proférées contre son amant à la suite de l’indécente proposition qu’il avait osé faire à Marianne. Était-ce elle qui avait fait arrêter Ouvrard ? En ce cas, était-ce par elle que Napoléon avait appris toute l’affaire anglaise ? Le belle créole, aussi dévouée dans ses amitiés que vindicative dans ses vengeances, en était bien capable...

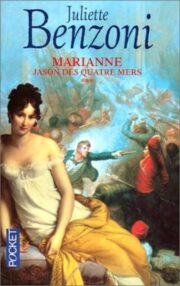
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.