Depuis son arrivée à Acre, Isabelle s’était prise d’affection pour cette blanche forteresse, cité de la foi mais aussi du commerce, jetée sur la mer comme une branche de lys et qui avait su, avec une incroyable rapidité, effacer les traces du terrible siège. Elle n’oublierait jamais le beau jour de son arrivée, accompagnée d’Henri. Toutes les rues jusqu’au port étaient tendues de courtines de soie aux couleurs vives ; des tapis de soie jonchés de fleurs et de brindilles de cèdre illuminaient le chemin et, devant les maisons, on avait placé des encensoirs dont les fumées odorantes emplissaient les rues d’une brume légère et bleutée. Toute la ville – elle comptait alors quelque soixante mille habitants – était venue à leur rencontre, dans ses plus beaux atours et portant ses plus belles armes. Des jeunes filles vêtues de blanc marchaient à reculons devant eux en jetant des fleurs à la tête des chevaux que contenaient les écuyers. Des processions de religieux leur présentèrent bannières et reliques qu’ils baisèrent avant d’être conduits à la cathédrale Sainte-Croix où ils entendirent la messe. Les pauvres reçurent d’eux de larges aumônes. Pour la première fois, la jeune femme goûtait le plaisir d’être reine devant la ferveur manifestée par cette cité qui devenait la capitale du royaume.
Ensuite, Henri partit rejoindre son oncle Richard dans sa dernière tentative pour reconquérir Jérusalem mais son absence fut courte. Sa jeune épouse en profita pour s’acclimater et s’habituer à son nouveau palais qui lui rappelait celui de Naplouse. C’était une belle demeure proche du port, construite jadis pour un riche marchand de Venise. Les pièces en étaient vastes, avec de larges ouvertures sur la mer ou sur le jardin intérieur. Tout y était magnifique, paisible et changeait Isabelle de l’austère château de Tyr et plus encore des noires murailles du Krak de Moab, dont le souvenir reculait à présent dans sa mémoire. Elle s’y efforçait d’ailleurs, souhaitant de toutes ses forces effacer les souvenirs cruels afin qu’ils ne la gênassent pas dans ce métier de reine qu’elle voulait exercer au mieux pour le bien d’un peuple que sa grâce et son sourire venaient de séduire.
Sa cour était réduite, mais vive et gaie, composée de jeunes filles toujours prêtes à mordre la vie à belles dents, et de dames plus mûres au nombre desquelles on ne pouvait pas vraiment compter Helvis, restée près d’elle pendant l’absence de son époux. Marie Comnène, elle, habitait maintenant Caiffa, la cité située au pied du mont Carmel, juste de l’autre côté de la baie, qui avait été donnée en fief à Balian d’Ibelin. Il était agréable de s’y rendre de temps en temps, surtout en bateau quand la mer était calme. Mais, quand elle n’accomplissait pas ses devoirs religieux ou n’allait pas en ville au-devant de misères à soulager, Isabelle aimait à se tenir dans sa chambre ouverte sur le large. Elle y passait des heures, à broder, à filer ou à faire de la passementerie au milieu de ses femmes qui babillaient, chantaient ou se taisaient, accordant ces instants de silence au secret de leur cœur.
Isabelle aussi connaissait de ces moments et, quand les demoiselles la voyaient délaisser son aiguille ou son fuseau pour laisser son regard bleu rejoindre l’horizon, elles savaient qu’il était temps de se taire, sans chercher pourquoi, en dépit de l’éclat du jour, un voile de mélancolie tombait comme un brouillard d’hiver sur le ravissant visage. Elles pensaient toutes que la reine rêvait à son époux absent. Deux seulement savaient qu’Henri n’occupait pas l’esprit de son épouse et que c’était une autre image, un autre regret infiniment douloureux qui brouillait parfois ses yeux : sa sœur Helvis et la vieille Marietta à présent chargée de la petite Marie.
Quand le roi revint avec sa chevalerie – tandis que Richard s’en allait –, la vie s’organisa sur un mode plus officiel car Henri entendait bien jouer à plein le rôle qu’on lui avait assigné ; rapidement il fit montre de sa valeur en menant le royaume avec une prudence qui n’excluait pas la fermeté ou même la sévérité. Les Pisans s’en aperçurent, qui possédaient comme les Vénitiens et les Génois des comptoirs dans cet immense marché de la soie et des épices qu’était Acre.
À Chypre dont il était désormais seigneur, Guy de Lusignan rongeait son frein, n’ayant accepté que du bout des lèvres l’exclusion massive des barons à son endroit. Il n’avait pas perdu tout espoir de reprendre ce qu’il considérait comme son bien et s’aboucha avec les Pisans qui possédaient aussi un comptoir à Chypre. On décida de s’emparer de Tyr d’abord, puis d’Acre, et de chasser Henri et son épouse. Projet assez stupide quand on connaissait la puissance défensive de l’ancienne capitale vénitienne, mais on y avait des complices. En outre, Guy comptait sur l’appui de son frère Amaury toujours Connétable du royaume et donc dans l’entourage immédiat d’Henri.
Celui-ci eut vent du complot. Il chassa les Pisans de Tyr. Furieux, ceux de Chypre envoyèrent des navires ravager la côte entre Tyr et Acre, ce qui mit le nouveau roi en fureur : il fit expulser d’Acre tous les Pisans, comme de tout le royaume, en avertissant :
— S’ils osent reparaître, je les pendrai par la gueule !
Bien entendu, Amaury de Lusignan voulut se faire l’avocat des bannis. Mal lui en prit : Henri tourna sa colère contre lui et le fit arrêter sous l’inculpation de trahison. Il risquait l’échafaud.
Isabelle accueillit cette nouvelle avec satisfaction. Elle n’avait jamais aimé le Connétable, n’ignorant pas qu’il avait été l’instigateur du mariage de Sibylle avec son « oison » de frère. En outre, il avait tenté à plusieurs reprises de pousser le couple royal et Héraclius à briser son mariage avec Onfroi afin d’épouser lui-même Isabelle et de s’assurer ses droits à la couronne. Enfin, il n’avait jamais caché qu’elle lui plaisait infiniment et eût dirigé sur elle une cour ardente si la Dame du Krak n’avait veillé étroitement au ménage de son fils. Le remariage avec le comte de Champagne l’avait courroucé autant qu’embarrassé : comment, sans se déshonorer, abandonner publiquement le parti de Guy en se posant comme son rival ? Il avait donc bien fallu subir le fait accompli, mais il gardait des regrets et Isabelle le savait, bien qu’il n’eût jamais manqué à ses devoirs de chef de l’armée. Cependant elle ne le détestait pas au point de vouloir sa tête. Elle fit entendre à son époux que la mort était peut-être cher payer une simple plaidoirie et fut rejointe dans son conseil par les Maîtres du Temple et de l’Hôpital.
Amaury fut relâché mais, sachant qu’Henri pouvait lui garder rancune, il renonça à l’épée de Connétable et partit rejoindre son frère dans l’île de Chypre. Sans laisser de regrets à personne : le nouveau roi avait déjà d’autres chats à fouetter, et non des moindres puisqu’il s’agissait des chanoines du Saint-Sépulcre installés bien entendu dans la nouvelle capitale.
Le Patriarche Raoul qui avait succédé à Héraclius était un homme âgé. Il venait de mourir. Les chanoines, sans demander l’aval du roi comme ils en avaient le devoir, procédèrent aussitôt à l’élection d’un nouveau Patriarche, en l’occurrence l’archevêque de Césarée, Aymar le Moine, l’un des plus chauds partisans du clan Lusignan. Henri leur témoigna son mécontentement. Le chapitre répondit avec insolence qu’il n’avait pas à tenir compte de l’avis d’un roi n’ayant pas reçu la couronne au Saint-Sépulcre comme le voulait la tradition. Un comble !
Aussitôt, Henri se rendit, en armes, dans la salle capitulaire de l’église Sainte-Croix dont il fit garder les issues et s’avança seul dans le cercle de robes noires sur lesquelles brillaient de riches croix pectorales et son regard, devenu d’une dureté minérale, fit le tour de ces têtes rases, voire chauves, car les tonsures débordées ne se renouvelaient plus.
— Eh bien, mes beaux sires, s’écria-t-il narquois, il semble que vous faites bon marché du roi élu et couronné ? D’où vient que vous ayez oublié de m’appeler en vos conseils pour le choix du nouveau Patriarche ?
— Il nous est apparu, répondit le plus âgé d’une voix asthmatique, que le chef de l’Église de Jérusalem ne relevant que du pape, il était bien inutile d’y mêler le pouvoir séculier. Nous, chanoines du Saint-Sépulcre, mandataires de Sa Sainteté, avons donc fait notre choix et envoyé auprès d’Elle un messager…
— Et moi je vais vous envoyer par le fond ! J’ai grande envie de vous noyer, vous qui n’avez plus de raison d’être, pour vous apprendre à respecter le pouvoir royal…
— Pouvoir que vous tenez d’un meurtre… et d’un meurtre dont, sans être coupable, vous n’êtes peut-être pas innocent !
Henri marcha droit sur l’insolent et le nasal d’acier de son heaume s’approcha dangereusement du nez du chanoine.
— Voulez-vous me répéter cela, Votre Révérence ? Qu’ai-je à voir dans les affaires du Vieux de la Montagne ?
— Vous, non ! Mais votre glorieux oncle Richard d’Angleterre. On dit que dès son débarquement il a envoyé des émissaires au château d’El Khaf pour obtenir qu’on le débarrasse de Philippe de France. Seulement Rachid ed-din-Sinan n’était pas d’accord. En revanche, il aurait accepté de chasser Conrad de Montferrat qui avait osé le défier.
— Les sicaires meurtriers ont avoué la raison.
— Ces gens-là obéissent à leur maître jusque dans la mort. Ils avouent uniquement ce qu’on leur dit d’avouer !
— Vous, vous avez menti par la gorge ! Vous n’êtes qu’un ramassis d’incapables et de conspirateurs ! Vous n’avez d’ailleurs même plus de raison d’être. Le Saint-Sépulcre est loin et vous êtes chez moi !
Le concert de protestations s’interrompit, reprenant de plus belle quand les gardes pénétrèrent dans la salle pour s’emparer des chanoines et les jeter dans les prisons de la citadelle. Il s’ensuivit un beau scandale.

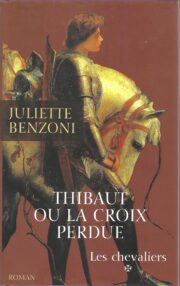
"Thibaut ou la croix perdue" отзывы
Отзывы читателей о книге "Thibaut ou la croix perdue". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Thibaut ou la croix perdue" друзьям в соцсетях.