Juliette Benzoni
Thibaut ou la Croix perdue
À la mémoire de Baudouin IV, le jeune
roi lépreux qui fut le plus pur héros du
royaume franc de Jérusalem.
Tu croiras à ce qu’enseigne l’Église, et
observeras ses commandements.
Tu auras le respect de toutes les faiblesses
et t’en constitueras le défenseur.
Tu aimeras le pays où tu es né.
Tu ne reculeras pas devant l’ennemi.
Tu feras aux infidèles une guerre sans
trêve et sans merci.
Tu t’acquitteras de tes devoirs féodaux
s’ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu.
Tu ne mentiras point et seras fidèle à la
parole donnée.
Tu seras libéral et feras largesses à tous.
Tu protégeras l’Église.
Tu seras partout et toujours le champion
du Droit et du Bien contre l’Injustice et le
Mal.
D’où viennent les rois de Jérusalem ?
Au commencement était Godefroi de Bouillon que tout le monde connaît et qui prit la Ville sainte en 1099, au cours de la Première Croisade. On lui offrit d’en devenir le roi, mais il refusa en disant qu’il ne porterait pas couronne d’or là où le Christ avait porté couronne d’épines. Il se contenta donc du titre assez vague d’avoué du Saint-Sépulcre. À sa mort, son frère Baudouin de Boulogne accepta, lui, d’être couronné et devint Baudouin Ier.
Aucune de ses trois épouses successives ne lui donna d’enfant. Quand il mourut en 1118, les barons de Terre Sainte offrirent le trône à son cousin, Baudouin du Bourg, de la maison de Rethel, qui était alors comte d’Edesse. Et Baudouin du Bourg devint Baudouin II.
De son mariage avec la princesse arménienne Morfïa, il eut quatre filles. L’aînée, Mélisende, devait recueillir l’héritage royal, mais ne pouvait régner seule sur une terre aussi turbulente. Sa main et son trône furent offerts à un croisé de très haut rang : Foulque d’Anjou, un Plantagenêt, qui régna de 1131 à 1144.
À son époux, Mélisende donna deux fils. L’aîné devint le roi Baudouin III, de 1144 à 1162, date où la mort le prit, trop jeune. Son frère Amaury lui succéda sous le nom d’Amaury Ier, mais il dut, avant de coiffer la couronne, répudier sa femme Agnès de Courtenay dont la réputation était détestable. Il en avait cependant deux enfants : le petit Baudouin (futur Baudouin IV) et Sibylle, dont les droits au trône furent déclarés imprescriptibles. Remarié à la princesse byzantine Marie Comnène, Amaury Ier en eut une fille : Isabelle.
Atteint de la lèpre dès l’âge de neuf ans, Baudouin IV fut cependant sacré en 1173 et devint ce roi héroïque jusqu’au prodige dont on va lire l’histoire… ainsi que celle de ses successeurs.
PROLOGUE
LA TOUR OUBLIÉE
1244
L’écho des pas de fer raclant la terre gelée s’éloigna, s’estompa, se perdit dans le lointain… Lentement, comme s’il craignait d’entendre craquer ses vertèbres, le fugitif releva la tête. Contre le sol son cœur cognait si fort qu’il lui semblait saisir les palpitations profondes des mondes souterrains. Cela faisait un bruit immense qui emplissait ses oreilles et chassait celui du vent d’hiver.
Son visage saignait des épines où il s’était jeté quand la lune avait fait luire un instant les casques des hommes d’armes, mais il ne sentait rien que ce battement inhumain qui l’étouffait et ne voulait pas se taire…
L’une après l’autre ses mains raidies de froid se détachèrent des racines affleurantes où elles s’agrippaient, l’aidèrent à se remettre debout sans crainte d’être vu parce qu’il était à l’orée d’une forêt, la grande forêt qui faisait suite au bout de lande sauvage où ne poussaient guère que la bruyère et les rochers. Il devait à la vitesse de ses longues jambes et au sol dur qui ne gardait pas de traces de l’avoir traversée sans être repris. Devant lui c’était la masse des arbres, des taillis, des buissons où il était si facile de se perdre. Les loups aussi, dont c’était le pays, mais derrière lui il y avait celui des hommes où le danger était tapi sous chaque visage et sous le toit de chaque maison. Le choix était facile…
Pour apaiser son cœur fou, il respira longuement. L’air froid lui fit du bien même s’il frissonna sous sa morsure, conscient tout à coup de n’avoir sur lui que sa chemise et ses chausses. Jusque-là, il avait trop couru pour s’en apercevoir. Avec la mort aux trousses, qui se soucie de son vêtement ou de la température ? Certes sa situation n’avait rien d’enviable mais au moins il était vivant… Vivant ! Alors qu’il ne devrait être, à cette heure, qu’un corps inerte, sans regard et sans voix, sans douleur et sans exigences. Un peu de chair morte pendue à un bout de chanvre et promise à l’enfouissement. Au lieu de cela la vie courait toujours dans ses veines et le poids de la terre noire ne fermait pas ses yeux à jamais… Seulement ce n’était peut-être que partie remise. Quelle belle chose qu’être en vie ! Encore fallait-il le rester.
Le premier besoin, le plus impérieux, c’était de manger et il ne s’agissait pas d’un petit problème pour un garçon qui n’avait que ses mains dans un paysage dénudé par l’hiver. Le dernier morceau de pain remontait à la veille. Ce matin, les gens du bailli n’avaient pas jugé bon de nourrir un condamné. Il avait tout juste reçu un verre de vin avant de monter à l’échafaud et comme c’était uniquement pour obéir à la coutume et pour la galerie, on lui avait donné une affreuse piquette à peine moins raide que du verjus. Il en sentait encore les effets dans son estomac vide.
Cela ne le gênait pas quand il n’attendait plus que la mort et s’y résignait, mais voilà que pour un incident fort mince – une bagarre entre deux marchands de volailles éclatant sur la place du Martroi dont on le destinait à devenir l’ornement –, il y avait eu un remous violent dans la foule, une trouée dans les gardes. Il en avait profité. Saisissant cette chance si faible qui s’offrait, il s’était jeté dans ce trou, noyé dans le flot humain. Un couteau invisible avait tranché ses liens avant qu’on le pousse vers l’extérieur. L’épaisseur de la foule avait élevé une barrière naturelle, difficilement franchissable, entre lui et les hommes d’armes, une barrière qui avait fini par céder devant le fer des guisarmes mais qui avait tenu assez longtemps pour lui permettre de fuir.
De taillis en chemins creux, de bosquets en oseraies, il avait gagné les friches, courbé pour se perdre dans la nature, la tête plus souvent à la hauteur des genoux qu’à sa place normale et les genoux bien souvent sur le sol, indifférent au froid, aux épines, aux mares gelées, possédé tout entier par sa fringale de vie et de liberté. Le moindre bruit le couchait à terre, les oreilles bourdonnantes, le cœur arrêté. Mais mille fois aplati, mille fois relevé, il avait fait du chemin et le temps avec lui. Bientôt l’aube humide allait dissoudre en grisaille la suie épaisse du ciel. Quelque part dans la campagne le cri enroué d’un coq annonçait déjà que dans leurs maisons ou leurs cabanes closes les hommes allaient s’éveiller. Il fallait trouver un endroit où se cacher. La forêt représentant le meilleur refuge, il s’y enfonça dans l’espoir d’y trouver, avec un abri pour dormir, quelques-unes de ces racines que, depuis l’enfance, il avait appris à reconnaître. En revanche, il ne savait pas où il était.
En sortant de Châteaurenard, il n’avait songé – en admettant qu’il songeât à quelque chose ! – qu’à mettre le plus de distance possible entre la potence et sa personne. Il avait fui droit devant lui comme un lièvre poursuivi, mais la réflexion et le semblant de lever de soleil le renseignèrent : après les grandes friches, la seule forêt dont il eût connaissance dans cette direction ne pouvait être que celle de Courtenay dont les maîtres, descendants d’un roi de France, étaient si hauts seigneurs qu’ils auraient réussi à coiffer disait-on une couronne impériale dans un lointain pays d’Orient. C’était peut-être pour ça qu’on ne les voyait jamais et qu’à Châteaurenard – de leur mouvance cependant ! – le bailli se comportait comme s’il était le seigneur du lieu ?
De toute façon qu’il allât vers Courtenay ou ailleurs était de peu d’importance. Tout autour de lui, le monde ne pouvait que se montrer hostile et sa seule chance était de trouver sur son chemin un moutier ou un lieu d’église qui lui serait un asile inviolable. Il devait bien en exister un ou deux aux abords de la cité suzeraine ?
Même dépouillée par l’hiver, la forêt était belle, coupée de menus ruisseaux. Il y avait de grands chênes, des hêtres, des bouleaux et des aulnes, des saules aussi près des filets d’eau, et dessous un fouillis de ronces, de merisiers, de prunelliers, de houx et de pommiers sauvages – sans plus de fruits, malheureusement ! Et le fugitif avait si faim, si faim ! En même temps il se sentait bien las et l’idée lui vint que s’il trouvait un rocher ou des buissons pour s’abriter, le mieux serait peut-être de prendre un peu de repos en vertu du vieil adage qui veut que « qui dort dîne ».
Il trouva presque tout de suite ce qu’il cherchait : un amoncellement de trois rocs en surplomb d’un trou broussailleux mais dépourvu d’épines où il se glissa non sans s’écorcher encore. Le trou était étroit mais on pouvait s’y étendre une fois franchies les broussailles. En outre il y faisait sec et un peu moins froid. Conscient donc d’y être à peu près invisible, le jeune homme s’y coucha pelotonné sur lui-même et s’endormit.
Quand il s’éveilla, il avait toujours aussi faim mais il se sentait reposé et prêt à poursuivre son chemin. Le bref jour d’hiver s’achevait. Il était temps de se remettre en route. Ce qu’il fit après avoir bu un peu d’eau d’un ruisseau voisin et mâché une racine affleurante hâtivement lavée qui lui donna seulement l’illusion de la nourriture.

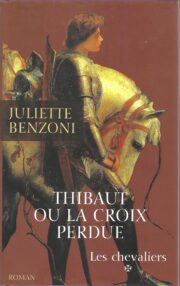
"Thibaut ou la croix perdue" отзывы
Отзывы читателей о книге "Thibaut ou la croix perdue". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Thibaut ou la croix perdue" друзьям в соцсетях.