Dans un soudain silence de la foule marquant ainsi la solennité du moment – les cloches, elles, s’en donnaient à cœur joie ! –, Baudouin sauta à terre comme si le fer dont il était vêtu ne pesait rien, ôta son heaume couronné qu’il tendit à Thibaut, rabattit le camail, découvrant ainsi une épaisse chevelure couleur de miel striée de mèches presque blanches puis, à grands pas souples, marcha vers le Patriarche devant lequel il s’inclina pour baiser l’anneau de sa main.
Avec un sourire où se lisait l’affection, Amaury de Nesle alors le prit aux épaules et l’embrassa avec des larmes dans les yeux… Il n’était pas difficile de deviner ce qu’il pensait : « Si jeune, si beau, si vaillant, si noble et déjà condamné à une mort lente, affreuse… et inévitable. » Il dompta cependant son émotion :
— Dieu a béni tes armes, mon fils ! dit-il d’une voix forte qui résonna au fond de la place. Allons ensemble l’en remercier !
Comme un père conduisant son enfant, ils marchèrent tous deux vers l’église sans que le bras du Patriarche quittât les épaules du jeune roi. Les prêtres les suivirent mais les hauts hommes qui escortaient Baudouin, tous ayant mis eux aussi pied à terre, s’agenouillèrent pour que leurs prières accompagnent celle des deux maîtres de Jérusalem.
Thibaut fit comme les autres mais avec un sourire de contentement. Il lui plaisait que ce soir on eût bousculé le cérémonial habituel plutôt pompeux pour cette simple et affectueuse rencontre du berger des âmes et du berger des corps.
Le roi pria longtemps, prosterné devant la dalle de marbre sous laquelle était le Tombeau, remerciant de tout son cœur pour la victoire donnée et pour cet instant de paix seul en face de Dieu.
Les prières de Baudouin n’avaient rien de commun avec celles d’un garçon de son âge occupé de plaisirs divers, de beaux coups d’épée, de conquêtes et aussi d’amour. Lui n’avait pas à se soucier d’un avenir puisque le sien se bornait à quelques années tout au plus, ni à se choisir une épouse qu’il ne pourrait étreindre. Son amour, c’était à son peuple qu’il le devait tout entier. Ce peuple, lui, avait un avenir et, dépositaire de la plus noble terre qui soit au monde, Baudouin devait, dès à présent, se soucier de celui qui serait assez digne et sage pour conduire après lui Jérusalem dans les eaux calmes d’une paix enrichissante. Alors le royal adolescent suppliait qu’on lui accorde la force et le courage de surmonter la souffrance qui viendrait bientôt et continuer sa tâche, envers et contre tout, pour le bien du royaume et l’honneur de Dieu.
Il savait que les conjonctures politiques lui étaient favorables. Saladin alors en Égypte d’où il avait chassé la dynastie fatimide pour implanter la sienne – celle des Ayyubides – souhaitait extirper définitivement de Syrie le jeune fils de Nur ed-Din, Al-Salih. Certes il avait pris Damas, la « grande silencieuse blanche », mais le jeune prince gardait de chauds partisans appuyés sur les puissantes cités d’Alep et de Mossoul. Avec habileté, Raymond de Tripoli, régent jusqu’au quinzième anniversaire de Baudouin, avait compris qu’en aidant Al-Salih, il combattrait plus efficacement Saladin qu’en l’attaquant de face. Et des trêves, un traité d’assistance mutuelle même s’étaient conclus. Ainsi l’année précédente, alors que Saladin assiégeait Alep, Raymond lui fit lâcher prise par une brève diversion sur Homs, en même temps que Baudouin, chef d’armée à quatorze ans, s’en allait ravager les abords de Damas, faubourgs et campagnes, afin de priver la ville de ses ravitaillements. Saladin s’était tenu tranquille quelque temps mais, toujours talonné par son désir ardent de rassembler sous sa main la totalité de la Syrie musulmane, il était revenu assiéger Alep dont la formidable forteresse hantait ses nuits. Baudouin, alors, avait levé l’ost et dirigé ses coups une fois encore sur Damas. Turhan shah battu à Ain-Anjarr, son frère aîné s’était résigné à abandonner Alep pour regagner Le Caire où des troubles se levaient. Remettant à plus tard ses projets d’empire unifié, le « sultan » venait de décider une longue trêve que le chancelier Guillaume de Tyr jugeait tout à fait satisfaisante. Baudouin, rentrant à Jérusalem, pouvait se consacrer tout entier à l’avenir de son royaume. Saladin apprenait à le respecter…
En ramenant Baudouin sur le parvis du Saint-Sépulcre avec le même geste chaleureux qu’à l’arrivée, le Patriarche fit tomber une large bénédiction sur les barons et les habitants qui s’y pressaient maintenant. Il annonça qu’une cérémonie d’action de grâces serait célébrée le lendemain et que tous y seraient conviés puis l’on se sépara. En s’enlevant en selle avec la maîtrise du cavalier consommé qu’il était, Baudouin sourit à Thibaut :
— Rentrons à présent. J’ai hâte de retrouver la maison…
— Il n’y a que vous pour l’appeler comme ça !
— Peut-être mais le mot palais qui plaît tant à ma mère lui va si mal !
En fait aucun des deux termes ne convenait vraiment au noble et sévère logis bâti par Baudouin Ier au cœur de l’ancienne citadelle de David reconstruite et cernée de massives tours carrées, d’où celle portant le nom du roi biblique surgissait, donjon sévère surmonté d’un élancement svelte comme un minaret de mosquée ou comme une fleur dont la haute galerie ajourée représentait la corolle encore close. Mais cette forteresse avait ses grâces, cette masse de pierres blondes enfermait des jardins pleins d’odeurs, des cours intérieures fleuries comme les patios mozarabes, des galeries couvertes soutenues par de fines colonnettes enroulées de jasmin blanc et d’ipomées bleues, des terrasses où la nuit venue il faisait bon s’étendre en regardant les étoiles. C’était à cela que rêvait Baudouin en guidant son cheval dans les rues ferventes. Le poids de la fatigue des derniers jours était en train de s’abattre sur lui comme cela arrivait parfois depuis quelque temps. Ce dont il enrageait : être las à quinze ans, qui a jamais entendu chose plus ridicule ? Il s’efforçait de n’en rien montrer, continuait à sourire, à saluer de sa main libre, à jeter un mot amical à une figure connue. C’était bon aussi cet amour de tous, cet orgueil de ses armes glorieuses qui leur rapportaient la paix. Une paix qu’ils espéraient fructueuse parce qu’elle signifiait le libre passage des riches caravanes, les cultures arrivant à terme dans les champs, et le droit de vaquer tranquillement à ses occupations sans qu’une mauvaise nouvelle, portée par un cavalier couvert de poussière et relayée par le tocsin, vînt annoncer une incursion ennemie à tel ou tel coin du royaume.
Sultan, le cheval de Baudouin, allait s’engager dans la pente douce menant au pont-levis de la citadelle quand une jeune fille surgit de la foule et se jeta presque dans les jambes du coursier. Elle tenait un bouquet de roses blanches qu’en tombant à terre elle réussit à lancer sur les mains du jeune homme en criant :
— Pour toi, mon roi ! Avec tout mon amour !
Le cri de Baudouin répondit au sien : elle allait être foulée aux pieds de Sultan sans qu’il pût rien pour la tirer de là, mais déjà Thibaut était à terre : sa monture à lui avait moins de sang que celle de son maître et ne rechignait pas à s’arrêter pile. Prenant la jeune fille dans ses bras, il la sortit de ce mauvais pas. Le roi, quelques foulées en avant, maîtrisait l’animal que ce projectile imprévu avait affolé, puis sautait à terre, abandonnant la bride sur le dos du cheval qui ne bougea plus. Il revint vers la jeune fille un peu étourdie, en train de reprendre ses esprits étendue sur le sol, le buste soutenu par Thibaut. Il mit genou en terre auprès d’elle et contempla un instant le mince et délicat visage ivoirin. Une épaisse natte noire et brillante échappée de la légère guimpe de mousseline blanche remontant jusqu’au petit tambourin de satin rouge de la coiffure mettait en valeur le rose de ses lèvres et la profondeur des yeux sombres qui s’illuminèrent en reconnaissant le roi.
— Est-elle blessée ? demanda celui-ci.
— Non, sire. Étourdie seulement, mais elle a eu de la chance : Sultan déteste que l’on se jette dans ses jambes.
— Et pour m’offrir ces fleurs ! fit Baudouin ému. Merci, jeune fille, mais vous avez couru un trop grand risque.
— Non, puisque vous êtes là près de moi. Oh, monseigneur, pour la joie de vous servir j’irais vers la mort en chantant…
Elle se redressait, se relevait en secouant sa robe en soie d’un rouge brillant sur laquelle glissait un collier d’or ciselé. Baudouin la regarda et sourit :
— Quelle folie ! Mais combien douce à entendre ! Quel est votre nom ?
— Ariane, sire, je suis la fille de Toros, l’orfèvre lapidaire arménien de la rue…
Elle n’eut pas le temps d’achever. Comme si le prononcé de son nom le matérialisait soudain, un gros homme emballé dans une robe lie-de-vin et coiffé d’un haut bonnet de feutre noir surgit de la foule et bouscula Thibaut pour s’emparer du bras de la jouvencelle :
— Fille sans pudeur ! As-tu donc juré de me faire mourir de chagrin ? Il faut lui pardonner, grand roi ! Sa pauvre cervelle est dérangée depuis la mort de sa mère et, en outre, elle est tout ce que cette malheureuse m’a donné comme descendance. Vous devez comprendre ma douleur et me la rendre. Viens par ici, toi !
Le flot de paroles s’accompagnait de calottes que Thibaut ne supporta pas ; il arracha Ariane au courroux paternel qui, selon lui, ne sonnait pas très juste :
— Ça suffit ! N’as-tu donc aucun respect pour ton roi à te conduire devant lui comme si tu étais dans ta maison ? Personne ici n’a l’intention de te prendre ta fille : elle a eu seulement le joli geste d’offrir des roses. Il n’y a pas de quoi la frapper.
Le gros homme soufflait la fureur par les naseaux mais n’en considéra pas moins les six pieds de fer vêtus qui venaient de lui arracher sa proie. Il fit un gros effort et se calma :

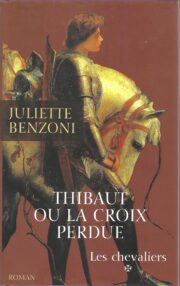
"Thibaut ou la croix perdue" отзывы
Отзывы читателей о книге "Thibaut ou la croix perdue". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Thibaut ou la croix perdue" друзьям в соцсетях.