Cette intransigeance envers un époux dont elle savait bien qu’il ne serait jamais un héros et que l’on ne fait pas un aigle d’une tourterelle irritait Isabelle. Comme l’irritait d’ailleurs le marquis tout entier.
Depuis qu’il l’avait ramenée au château, Montferrat venait chaque jour la saluer et prendre de ses nouvelles. Son attitude était toujours parfaite de respectueuse courtoisie et d’amabilité, mais l’épouse d’Onfroi était trop fine pour ne pas deviner ce qui couvait sous les belles paroles, le souci méticuleux de sa santé et les menus présents de parfum ou de pièces de soie qu’il leur offrait, à elle et à la reine Marie. Il lui avait suffi pour cela de plonger une seule fois son regard dans les yeux ardents et avides de Conrad : il éprouvait pour elle un désir violent, une de ces passions égoïstes où l’amour n’a pas beaucoup de place, sinon pas du tout. Il la voulait, simplement, et elle s’en méfiait, ne le connaissant pas assez pour deviner jusqu’où il était capable d’aller pour la faire sienne. Dans ces conditions, il ne pouvait que lui déplaire, d’autant plus qu’elle n’arrivait pas à lui pardonner le bannissement de Thibaut.
Bien qu’elle n’aimât guère plus le marquis, Marie s’était efforcée d’amener sa fille à plus de justice :
— Soyez équitable, Isabelle ! Comme à tous ceux qui estiment le chevalier de Courtenay et croient à son innocence, sa condamnation ne peut que paraître affreusement injuste, mais je crois, en conscience, qu’en sauvant sa vie le marquis a fait ce qu’il était possible de faire pour lui en de telles circonstances. Songez qu’ameutée par cette horrible Josefa, la ville entière l’attaquait, réclamant pour Thibaut le châtiment des parricides.
— Ce qu’il pouvait, ma mère ? À mon sens, il eût peut-être mieux valu le garder en prison le temps nécessaire à la découverte du véritable meurtrier.
— Et par quel moyen ?
— Se saisir de l’accusatrice, la bien questionner afin de lui faire cracher la vérité !
— Ma fille ! s’écria l’ex-reine abasourdie par l’impitoyable violence qu’Isabelle laissait transparaître. Êtes-vous en train de me dire qu’il la fallait confier aux tourmenteurs ?
— Pourquoi pas ? Ce genre de femme – et j’ai appris à la connaître – n’est que haine, envie et méchanceté. Elle était la mauvaise conseillère de feue dame Agnès, notre ennemie, et elle exerce à présent ses talents auprès d’Etiennette de Milly qui, certes, n’avait pas besoin d’un surcroît de cruauté, en étant suffisamment pourvue. Qui vous dit qu’elle et Josefa n’ont pas machiné le crime ?
— Je n’en vois pas la raison.
— La raison, c’est mon amour pour Thibaut, cet amour né avec moi je crois bien et dont j’ai compris trop tard qu’il était l’essence même de ma vie. Cet amour que j’ai renié un moment pour ce qui n’était rien d’autre qu’une illusion, mais qui me tient à présent captive du plus fort des enchantements et qui ne s’éteindra jamais, parce que je l’emporterai avec moi dans la mort et même au-delà, jusque dans les nuages où règne notre Dieu Tout-Puissant !
Jamais encore Isabelle n’avait livré son secret, ni surtout révélé la profondeur et la force de celui-ci. En l’écoutant, en contemplant le rayonnement soudain de son visage et de son être tout entier, Marie se sentit envahie par un étrange sentiment d’humilité et d’admiration, comme si l’éblouissante lumière de l’Amour absolu venait d’éclairer la profonde embrasure de fenêtre où elles se trouvaient toutes deux, rejetant les rayons du soleil à l’état d’un simple lumignon. Elle comprenait à présent pourquoi sa fille souffrait tant du sort réservé à celui qu’elle aimait.
— Isabelle, murmura-t-elle, il faut prier !
— Pour qui ? Pour lui, livré sans armure avec ses seules mains nues à tous les dangers, toutes les cruautés des hommes et de la nature dans un pays ravagé par la guerre ? Je ne fais que cela !
— Non. Pour vous, Isabelle ! Pour que le Seigneur vous préserve, vous si belle, de la passion des autres hommes et des contraintes parfois insupportables auxquelles le destin oblige presque toujours celles qui naissent aux marches d’un trône. Et parce que vous seriez plus malheureuse que quiconque.
— À quoi pensez-vous, ma mère ?
— À votre sœur Sibylle qui, depuis des mois, est là-bas devant Acre, dans le tref pourpre de son époux. Le bruit court qu’elle est malade et, avec l’hiver qui vient, son état pourrait empirer. Si elle venait à trépasser, c’est à vous que reviendrait la couronne parce que c’est elle qui a été élue par droit de primogéniture et que Guy de Lusignan est seulement roi consort. Qu’elle disparaisse et l’époux n’est plus rien. C’est vous qui serez tout !
— Peut-être, mais je ne vois pas en quoi j’en serais plus malheureuse. Je suis mariée, il me semble. Si je suis reine, mon époux deviendrait roi comme l’est aujourd’hui Lusignan.
— Lui, roi ? Croyez-vous que les hauts barons et la chevalerie entière qui le méprisent accepteraient de plier le genou devant lui ?
— Il le faudrait bien puisque moi je l’ordonnerais ainsi.
— N’en soyez pas si certaine. Avez-vous donc oublié votre père ? Pour obtenir le royaume auquel cependant sa naissance lui donnait plein droit, il a dû répudier Agnès. Il l’aimait, en avait deux enfants, après quoi il m’a épousée.
— Pour son bonheur, ma mère ! Je sais qu’il vous aimait !
— Pas un instant je n’en ai douté, mais un homme est un homme. Au lit comme au gouvernement il impose sa loi et, si l’épouse ne trouve pas grâce à ses yeux, il peut la délaisser, chercher des compensations. Il n’en va pas de même pour une femme bien que reine : il lui faudrait subir l’époux choisi pour en avoir descendance. Quand on aime comme vous aimez le bâtard, ne serait-ce pas la pire épreuve ?
— Si cruelle que je ne veux pas y penser ! Si je devais succéder à Sibylle, ou bien j’imposerais Onfroi comme elle a imposé Guy, ou bien je refuserais la couronne !
— Je ne pense pas que vous en auriez le droit. Parce que régner serait votre devoir !
Sibylle mourut en octobre 1190, victime d’une de ces épidémies qui s’abattaient avec une sorte de régularité sur le camp devant Acre devenu pléthorique. Trop de gens s’y entassaient, plus ou moins aptes à supporter le climat. Trop de ribaudes aussi, arrivées d’un peu partout pour profiter des richesses apportées par les croisés venus d’Occident. Les plus belles étaient parfois les plus dangereuses parce qu’elles portaient en elles des maladies, des virus récoltés ici ou là et qu’elles propageaient au plus grand nombre. En outre, les vivres commençaient à manquer et les tentatives pour desserrer l’étau établi par Saladin s’avéraient infructueuses. Enfin, avec l’automne, les pluies si bénéfiques d’habitude se firent catastrophiques.
La jeune reine de trente ans s’éteignit un soir à l’heure où derrière les remparts de la ville assiégée s’élevait l’appel des muezzins à la prière du soir. L’évêque d’Acre qui prononçait alors les prières pour que Dieu soit clément à cette âme égoïste et légère éleva la voix pour étouffer celle des infidèles. Ceux qui, à genoux, emplissaient le fragile palais de soie pourpre y ajoutèrent la leur avec plus de colère que de piété. Au pied du lit habillé d’azur où s’étalait, vainement sensuel, l’or d’une chevelure dénouée, Guy de Lusignan, le visage pressé contre les pieds de sa femme, sanglotait à fendre l’âme, indifférent à ce qui se passait autour de lui. Il resta là même quand tous sortirent pour permettre aux suivantes de la reine de procéder à la toilette funèbre, inconscient des chuchotements qui s’élevaient déjà parmi les barons et les chefs de guerre réunis par force.
Quelqu’un dit – et c’était Simon de Tibériade, l’époux d’Ermengarde d’Ibelin :
— La reine Sibylle est morte. Vive la reine Isabelle !
Et comme le comte de Dreux s’étonnait, faisant observer que le roi Guy, lui, vivait toujours, on lui expliqua que Sibylle n’était pas l’épouse du roi mais la reine couronnée, et que Lusignan sans elle n’était plus rien. Le Connétable Amaury qui écoutait, l’œil sombre et les bras croisés, fit observer que c’était Guy et non Isabelle qui était venu assiéger Acre et qu’il méritait bien de garder la couronne. Les barons du pays lui opposèrent alors les lois du royaume. Et il dit :
— Que vous n’aimiez pas Guy peut se comprendre, car il a eu de grands torts dont il s’est bien repenti, mais songez qui est à cette heure l’époux d’Isabelle de Jérusalem. Allez-vous détrôner Guy pour mettre à sa place Onfroi de Toron qui a peur de son ombre et ira se cacher en criant « au secours » plutôt que se laisser porter au trône ? Nous avons besoin d’un vrai chef.
— Ce n’est pas votre frère, riposta Tibériade. Sans vous il ne serait pas ici. Quant à Isabelle, il lui sera facile de répudier Onfroi. Il y a, dans Tyr, l’homme qu’il-nous faut. Avec lui nous aurons une nouvelle dynastie forte et déterminée.
Et au matin, tandis que le deuil s’étendait sur le camp et le respectueux silence ordonné par Saladin sur celui des Musulmans, un navire portant l’évêque d’Acre et les plus hauts barons du royaume anéanti fit voile vers la vieille capitale phénicienne.
La nouvelle y était déjà connue. Si Montferrat, l’œil étincelant sous la paupière qui s’efforçait de le voiler, attendait la délégation au port, en compagnie de Balian d’Ibelin, Isabelle, enfermée dans la chapelle avec sa mère, implorait le ciel d’écarter d’elle cette couronne qu’elle redoutait comme un calice empoisonné et refusait les douces représentations de Marie qui ne savait trop si elle devait se réjouir ou se désoler d’avoir eu raison si vite.
Elle ne put cependant éviter de laisser ouvrir les portes du petit sanctuaire devant l’archevêque et de plier le genou pour baiser l’anneau de la main dont il traça sur elle le signe de bénédiction. Elle l’écouta ensuite avec un calme apparent déplorer la mort de Sibylle et lui faire part de son élévation au trône qui avait été celui de son père et de son frère. Mais, quand il en vint à l’obligation pour elle de se séparer d’Onfroi de Toron, la jeune femme s’insurgea :

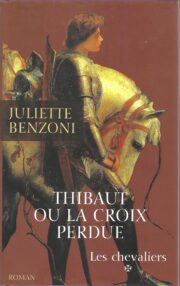
"Thibaut ou la croix perdue" отзывы
Отзывы читателей о книге "Thibaut ou la croix perdue". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Thibaut ou la croix perdue" друзьям в соцсетях.