Naturellement, après une entrevue de cette aménité, le Valentinois rentra au palais de la cité à peu près fou de rage, jurant qu’avant peu, il aurait raison de cette femme indomptable. Et cela, par n’importe quel moyen !
Or, il se trouva que ce moyen vint à lui le soir même, sous la forme d’un homme masqué, entièrement vêtu de noir, qui se présenta au palais et demanda à lui parler personnellement :
— Si je vous livre la forteresse de Ravaldino, que ferez-vous de moi, seigneur duc ?
L’œil froid de César s’alluma brièvement, tandis qu’un sourire glissait sous le masque de velours noir. Ce langage lui convenait car il le comprenait. Un traître. C’était tout juste ce qu’il lui fallait. Mais il avait l’impression de connaître cette tournure, de l’avoir déjà vue plusieurs fois.
— Qui êtes-vous ?
— Que vous importe si je vous donne ce que vous souhaitez.
— Je n’aime guère les gens masqués quand ce n’est pas pour une raison aussi valable… que la mienne.
— Elle est aussi valable, croyez-moi… peut-être craigné-je moi aussi de faire horreur. Mais nous perdons du temps ! Que m’offrez-vous contre la forteresse ?
— Vous croyez-vous en mesure de vous montrer fort exigeant ? Tôt ou tard, Ravaldino tombera. Il faudra bien que le comtesse Catherine cède, car je sais qu’aucun secours ne lui viendra.
— Mais dans combien de temps ? Croyez-moi, si je vous dis que vous pouvez encore être retenu ici jusqu’au printemps. Qu’en sera-t-il alors de votre réputation ? Ne fût-ce qu’aux yeux de vos alliés, qui déjà n’ont que trop tendance à admirer leur ennemie.
Il y eut un silence. Puis, à nouveau, César sourit. Il savait maintenant qui était l’homme assez lâche pour livrer une femme.
— Venez, fit-il en se dirigeant vers une petite porte basse. Nous allons en discuter dans mon cabinet.
Le 12 janvier 1500, les crieurs de César Borgia parcoururent les rues de Forli, ordonnant aux habitants de se rendre aux bords de la forteresse en apportant chacun une fascine. Celui qui mettrait quelque mollesse à l’accomplissement de cette tâche serait pendu quels que soient son âge ou son sexe.
— Nous sommes dimanche, clama César depuis le balcon du palais et vous verrez que mardi, la comtesse sera entre mes mains. J’ai parié trois cents ducats qu’il en serait ainsi. Malheur à celui qui me fera perdre !
Il n’était pas question de discuter. Chacun obéit, certains avec un affreux sentiment de honte, d’autres avec l’espoir de toucher une fabuleuse récompense, car l’on disait que Borgia avait promis cinq mille ducats à qui lui livrerait la forteresse et la comtesse. Sans se douter d’ailleurs le moins du monde que le futur bénéficiaire des cinq mille ducats était déjà trouvé. Le traître était prêt à agir.
Le jour même, les troupes pontificales se ruèrent à l’attaque. Les canons avaient enfin réussi à ouvrir deux brèches en tirant sur deux points de la muraille dont rien ne révélait extérieurement la faiblesse, mais qu’un avis judicieux leur avait signalé. Les assiégés se précipitèrent pour les colmater, mais durent se replier sous une véritable rafale de projectiles. La comtesse comprit que sa ruine était imminente, mais pas un instant l’idée de capituler n’effleura son âme vaillante.
Les assaillants avaient jeté dans les fossés tant de fascines, de pierres et de pontons qu’ils pouvaient maintenant les franchir sans peine. Aussi s’élancèrent-ils à l’assaut, passant seize à la fois. Mais là aussi, l’objectif de l’assaut avait été soigneusement choisi, car sur la grosse tour qui commandait le lieu de l’attaque et portait la bannière frappée de la vipère Sforza, les canons se taisaient. C’était le poste de combat de Giovanni da Casale, l’amant de la comtesse.
Un Suisse, nommé Cupizer, escalada cette tour, en arracha la bannière et l’agita en l’air en signe de triomphe.
— Venez, venez, nous avons la victoire ! voici la bannière ennemie !
Mais la victoire n’était pas encore acquise et la comtesse pas encore prise. Avec une poignée d’hommes, elle s’était enfermée dans le donjon non sans avoir craché son mépris à la face de son amant.
— Lâche ! aucun homme n’est plus lâche que toi ! et peut-être aussi n’es-tu qu’un traître ! Que t’a promis Borgia pour que tu laisses passer l’assaut sans tirer ?
Mais l’heure n’était pas encore aux explications. Le combat reprit, féroce, acharné. Plusieurs fois, entourée de ses derniers fidèles, la dame de Forli tenta des sorties. Elle combattait elle-même, alors que César, laissant faire ses troupes, avait préféré regagner son palais de la cité pour y attendre la fin des combats en préparant la suite de ses campagnes.
Droite dans la mêlée, ses longs cheveux blonds dénoués flottant sur ses épaules, elle abattait inlassablement la hache d’armes qu’elle maniait comme un homme. Autour d’elle, les siens accomplissaient des prodiges de valeur. Cinq cents cadavres jonchaient les abords du donjon. Mais la lutte était par trop inégale, et Catherine comprit qu’elle allait voir fondre ses troupes sans parvenir à vaincre.
— En arrière ! cria-t-elle. Retirez-vous dans le donjon ! Je le ferai sauter plutôt que de le rendre.
Ce n’était pas une menace en l’air. Dans les caves du donjon, dont les murailles lisses défiaient l’escalade, il y avait une grosse réserve de poudre. Donnant l’exemple, la comtesse voulut regagner son ultime retranchement tandis que ses hommes, reculant peu à peu, couvraient sa retraite.
Soudain, une exclamation de stupeur partit des rangs des combattants.
Le drapeau blanc !
En effet, sur les créneaux du donjon, quelqu’un hissait l’emblème de la capitulation, tandis qu’en bas une main criminelle refermait la porte de l’ultime refuge de Catherine. Giovanni da Casale parachevait sa trahison et s’assurait les cinq mille ducats promis par César Borgia.
L’instant de stupeur et de colère qui s’empara de la comtesse et de ses hommes leur fut fatal. Les Suisses se ruèrent en avant…
Quelques instants plus tard, l’un d’eux s’emparait de Catherine au nom du bailli de Dijon, son capitaine. D’abord furieuse, celle-ci se calma très vite, jeta sa hache ensanglantée désormais inutile tandis qu’un sourire, le premier depuis bien longtemps, apparaissait sur son visage las.
— Le bailli de Dijon ? Soit donc, Monsieur. Sachez que je me rends à lui et au roi de France ! C’est de votre maître suprême que je me déclare prisonnière.
C’était, en effet, très certainement le salut. La comtesse n’ignorait pas que la loi française interdisait qu’une femme fût prisonnière de guerre et c’est très calmement que, encadrée par les Suisses, elle quitta sa forteresse à demi ruinée et gagna le tertre où l’attendaient ses vainqueurs.
César Borgia, qui s’était hâté de revenir, s’y tenait auprès du duc de Vendôme, du bailli de Dijon et du seigneur Yves d’Allègre. Voyant s’avancer cette femme pâle aux cheveux défaits répandus sur sa robe déchirée et sanglante, ce dernier sauta à bas de son cheval et s’inclina profondément, balayant la poussière des plumes noires de sa toque. Puis il se redressa et, à pleine voix, ordonna :
— Soldats ! Au nom du roi de France, saluez !
Les tambours roulèrent, les trompettes sonnèrent, tandis que des larmes montaient aux yeux de la guerrière vaincue. Et ce fut en reine, saluée par les vivats de toute l’armée, qu’elle approcha des capitaines.
Vivement, à l’exemple d’Yves d’Allègre, le duc de Vendôme avait mis pied à terre et force fut à César Borgia, si furieux qu’il en grinçait des dents, d’en faire autant.
Le soir venu, une violente discussion éclatait entre les chefs de guerre. César Borgia exigeait que la prisonnière lui fût remise. Yves d’Allègre s’y opposait farouchement.
— Vous êtes ici pour me servir, hurlait le fils du pape. Le traité que j’ai signé avec le roi votre maître indique que les conquêtes seront miennes !
— Les conquêtes, oui, pas les femmes ! Madame de Forli est sous la protection du roi de France et je suis prêt à soutenir, les armes à la main, que ma cause est juste. Êtes-vous prêt, Monseigneur, à en faire autant ?
Il n’en était évidemment pas question. Borgia parut céder. Il se contenterait donc de la ville et de sa forteresse… Cependant, il restait encore, dans l’État un point chaud : la petite citadelle de Forlimpopoli qui ne semblait pas désireuse de se rendre, sans doute parce qu’elle ignorait la chute de Ravaldino. Monseigneur d’Allègre accepterait-il de s’en charger ?
Allègre accepta. Ce n’était d’ailleurs qu’une formalité : la comtesse vaincue, Forlimpopoli ne résisterait pas plus de quelques heures, et il voulait tout de même faire preuve de bonne volonté.
— J’y vais, dit-il. Demain, je serai de retour !
Hélas, l’apparente courtoisie de Borgia avait trompé le Français, qui n’avait encore qu’une faible idée de la duplicité du personnage. Il ne vit aucun inconvénient à ce que l’on offrît à Catherine de résider dans la maison de l’un des notables de Forli, un certain Numai, ignorant que Borgia venait d’y transporter ses quartiers personnels à la suite de l’effondrement du toit du palais de la cité sous un boulet de canon.
Le soir même, Catherine et son ennemi se trouvèrent face à face et seuls. Borgia ne crut pas utile de conserver plus longtemps la façade d’amabilité que lui avaient imposée ses alliés. Brutalement, il mit la comtesse en demeure de lui livrer ses enfants, que l’on n’avait pu trouver.
Elle lui éclata de rire au nez.
— Mes enfants ? Me croyiez-vous donc assez stupide pour les laisser à votre merci ? Il y a longtemps qu’ils ont quitté la région et le véritable seigneur de Forli, mon fils, Ottaviano, est en sûreté à Florence. Vous pouvez me tuer, ma famille vous échappe !

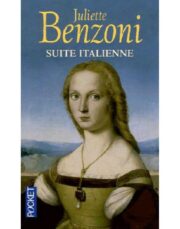
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.