Ayant ainsi parlé, la comtesse salua d’un bref signe de tête et s’éloigna. Un instant, on vit voltiger son voile blanc sur le fond clair du ciel. Puis il n’y eut plus rien sur le rempart que les lourdes silhouettes des soldats de garde.
Remontant en selle, César Borgia fit volter son cheval avec rage et, entouré de son escorte cette fois, franchit de nouveau la porte de la ville dans laquelle il s’engouffra. Dans le camp français, on avait suivi la courte scène avec un mélange d’étonnement et d’admiration, ce second sentiment allant tout entier à la comtesse.
— Quelle femme ! s’écria le bailli de Dijon, Antoine de Bissey, qui commandait les troupes suisses engagées par le pape Alexandre VI pour renforcer celles de son fils. Comment ce maudit Borgia ose-t-il s’en prendre à cette magnifique créature ?
Un éclat de rire lui répondit. L’homme qui l’avait poussé était le propre cousin de Louis XII, le duc de Vendôme. Comme la plupart de ceux qui prenaient part à ce siège, il n’aimait guère César, ni d’ailleurs aucun Borgia. En revanche, Catherine Sforza avait droit à toute son admiration. Ce n’était pas le cas, jusqu’à présent, d’Antoine de Bissey, qui entendait n’avoir pour sentiments que ceux de son intérêt. Sa remarque avait donc mis le duc en grande joie.
— Si je vous comprends bien, mon ami, vous voici parvenu au même point que tout le reste de notre armée : Madame de Forli vous a séduit.
— Au point que je veux ce soir même faire composer une ode en son honneur.
— Faites, mon cher, faites ! Ce ne sera pas la première. Il n’est pas un seul de nos Français sachant tenir une plume et aligner un vers qui n’ait rimé en son honneur quelque poème, bon ou mauvais. Par la voie des frondes, on lui en adresse une bonne dizaine à chaque lever du soleil. Votre ode ne fera qu’une de plus.
César Borgia fit donner l’assaut presque aussitôt. Il fut violent, rageur, du côté de ses troupes, plus mou de la part des Français et, bien entendu, sans résultat. Quand vint la nuit, le calme que dispensait le crépuscule s’installa sur le camp, sur la ville, où l’on n’avait guère osé fêter le nouveau siècle, et sur la forteresse.
Tout fut paisible comme si la guerre avait soudain cessé.
En haut du donjon, de nouveau accoudée au créneau, la dame de Forli vint observer la campagne nocturne où traînait encore, vers l’occident, une mince bande blafarde.
Complètement enveloppée dans un manteau noir, elle se fût confondue avec la nuit et avec la muraille sans la tache plus claire de sa tête nue. Les paroles d’orgueil et d’insolence criées l’ennemi lui avaient causé une joie violente, grisante comme un vin trop fort. Il y avait si longtemps qu’elle rêvait de les lancer au visage de cet homme, jadis un ami, parrain de l’un de ses enfants même, et qui cherchait maintenant sa perte avec un acharnement impitoyable.
Mais cette minute enivrante était passée, et dans le silence et l’obscurité, la comtesse osait s’avouer qu’elle était lasse, lasse à mourir, en dépit de la belle confiance qu’elle s’était donné la joie d’afficher.
Les renforts qu’elle espérait n’arrivaient pas. Florence, dont son mariage avec Jean de Médicis l’avait faite fille et ressortissante, était réduite à l’inaction par les menaces non déguisées d’un pape indigne, dont la main bénissante s’armait tantôt d’une dague tantôt d’une coupe de poison. Une lettre assez embarrassée de l’habile Machiavel, depuis longtemps l’ami de Catherine, lui avait appris qu’elle n’avait plus rien à attendre de ce côté-là.
Du côté de Milan non plus, d’ailleurs. Le duc régnant, Ludovic le More, oncle de la comtesse, avait fui jusqu’en Autriche devant les armées du roi de France, qui réclamait pour lui-même, par héritage, le duché de Milan.
Restait la propre sœur de Catherine, Bianca-Maria Sforza, que son mariage avec l’empereur Maximilien avait faite impératrice d’Allemagne. La dame de Forli avait beaucoup espéré d’elle, mais Bianca-Maria ne donnait même pas signe de vie. Et c’était cela, au fond, qui attristait le plus l’assiégée : le silence de sa petite sœur, qui pouvait si facilement oublier les tendres années de l’enfance et les membres de sa famille. Non, en vérité, il n’y avait de secours à attendre de personne… que d’elle-même et de son propre courage.
— Je suppose que vous savez aussi bien que moi que nous sommes perdus ? fit soudain une voix derrière la jeune femme.
Et cette voix répondait si bien à celle qui résonnait au fond de son âme, que la comtesse ne se retourna même pas. D’ailleurs, elle savait bien qui était là : le seul être qui dans la forteresse eût le droit de troubler ses méditations et de lui parler sur un ton aussi rude, parce que ce droit, il le tenait de l’amour.
— Je le sais, Giovanni, dit-elle doucement.
— Alors, pourquoi avoir refusé l’offre de Borgia ? Qu’aurez-vous gagné quand cette forteresse sera prise, détruite, et que nous serons tous morts ?
Elle haussa imperceptiblement les épaules. Ce n’était pas d’hier qu’elle avait découvert que chez un homme, la beauté s’accompagnait rarement d’une grande intelligence.
— Que gagnerai-je à écouter César ? rétorqua-t-elle. Si j’acceptais, sais-tu ce qui m’arriverait, ce que l’on m’offrirait ? Une bonne prison… ou alors quelque bon souper chez le pape ou chez César, un de ces soupers que l’on digère si mal. La cantarella ne me tente pas, Giovanni, ni les cachots du château Saint-Ange. Je les connais trop bien.
Avec insolence, Giovanni da Casale haussa les épaules. Il jugeait stupide une résistance aussi acharnée contre un ennemi tellement plus puissant, et ne s’en cachait pas.
— Voilà bien les femmes ! Elles sont incapables de croire à la parole d’un homme, d’un capitaine.
— Parce que les hommes sont rarement dignes de foi. Je connais César, mon ami, c’est l’avantage que j’ai sur toi. Il me hait, et bien davantage encore depuis que j’ai refusé pour mon fils Ottaviano la main de sa sœur, la trop fameuse Lucrèce.
— Pourquoi ces offres aimables, alors, puisqu’il est sûr de gagner ?
— Parce qu’il craint de se couvrir de ridicule aux yeux de ses alliés. Ton capitaine en est à sa première campagne, Giovanni. Souviens-toi qu’il n’y a pas deux ans, ce foudre de guerre était encore cardinal, qu’il a tué son frère Juan pour prendre sa place et qu’à peine la simarre jetée aux orties, il s’est marié avec la complicité de son lamentable père !
« Qu’attendre de cet assassin, de ce défroqué, fils d’un prêtre concussionnaire et débauché ? Je hais les Borgia, Giovanni, et il me plaît de voir César trépigner de rage, avec sa belle armée, devant la porte d’une femme.
— Et c’est pour cette satisfaction que nous devons tous périr, jusqu’au dernier ?
Elle le toisa, frappée tout à coup par une cruelle déception.
— Je ne pensais pas que la mort pût effrayer un soldat, Giovanni, ou même un homme véritable. Mais peut-être après tout n’es-tu ni l’un ni l’autre ?
II
La captive aux chaînes d’or
Ce soir-là, Catherine demeura longtemps sur le rempart après que son amant eut disparu, sans doute pour aller chercher au fond d’un broc de vin l’oubli de la peur que lui inspirait César Borgia. Jamais comme cette nuit, elle n’avait éprouvé à ce point le besoin de solitude. Peut-être parce que son âme indomptable portait maintenant une fêlure.
Résister lui avait paru facile, vivifiant même, tant qu’elle avait imaginé que le cœur de celui qu’elle aimait battait à l’unisson du sien. Mais avec quelques phrases, l’idole avait vacillé sur ses pieds d’argile et s’était effondrée dans la boue. Un lâche ! Giovanni n’était qu’un lâche. Elle l’avait cru sans peur, sinon sans reproche, et à découvrir en lui un couard, elle éprouvait une sorte de malaise physique proche de la nausée.
Elle n’avait pas de chance, décidément. Hormis Jean de Médicis, tous les hommes qui avaient joué un rôle quelconque dans sa vie étaient des lâches, depuis Girolamo Riario, son premier mari, jusqu’à ce Giovanni da Casale, en passant par le beau et stupide Feo, son second époux. On eût dit qu’elle attirait les pleutres, elle dont la vaillance était célèbre dans toute la péninsule.
La dame de Forli allait enfin quitter le chemin de ronde pour prendre quelque repos quand une flèche siffla et vint s’enfoncer en vibrant dans la porte de l’escalier, non loin d’elle. Quelque chose de blanc, un papier sans doute, était attaché à l’empennage.
Elle le détacha, le lut, et un sourire mélancolique vint éclairer son beau visage. C’étaient des vers d’amour, un court poème écrit en français et qui célébrait à la fois son courage et sa beauté. Ce siège, décidément, n’avait rien d’habituel et si Borgia se révélait un ennemi acharné, les Français qui l’aidaient par ordre du roi Louis XII étaient de bien curieuses gens. Ils assiégeaient la forteresse d’une femme qu’ils couvraient de vers et de déclarations enflammées…
Car ce billet n’était pas un cas isolé. Il en tombait sur le chemin de ronde trois ou quatre chaque nuit, et ce n’étaient jamais des lettres anonymes ; poèmes ou billets doux étaient toujours signés, parfois de fort grands noms, et tous comportaient autant de passion que de fautes d’orthographe, ce qui n’était pas peu dire !
Fourrant le papier dans son aumônière, la comtesse se décida enfin à regagner ses appartements, mais sans qu’elle pût expliquer pourquoi, son cœur était un peu moins lourd. Ces hommages venus du camp ennemi apaisaient quelque peu sa déception, car elle était trop femme pour ne pas se montrer sensible, si peu que ce fût, à une dévotion qui employait de tels moyens pour se faire connaître.
Le lendemain matin, Borgia fit une nouvelle tentative de conciliation, encore plus mal reçue que la veille. La dame de Forli lui rit au nez, et comme il offrait pour caution de sa bonne foi les paroles d’honneur du bailli de Dijon et du seigneur d’Allègre, elle lui répliqua fort vertement que « là où manquait le principal, il n’y avait que faire de l’accessoire… ». On ne pouvait, selon elle, être bon gentilhomme, même si l’on était roi de France, en étant l’allié d’un bandit tel que César Borgia !

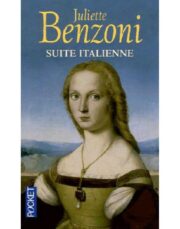
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.