Ce n’était vraiment pas une femme ordinaire que la dame de Forli ! Fille bâtarde mais légitimée de Galeazzo-Maria Sforza, duc de Milan, et de Lucrezia Landriani, une belle Milanaise, elle avait été élevée en véritable princesse par l’épouse légitime du duc, Bona de Savoie, sœur de la reine de France.
Elle avait appris les lettres, le grec, le latin, les sciences et les arts. À onze ans, pour des raisons politiques et malgré les larmes de la duchesse Bona, on l’avait mariée à un très déplaisant mais très puissant personnage, Girolamo Riario, neveu favori du pape Sixte IV, qui devait tout à son oncle et rien à sa fort mince naissance. C’était, selon les uns, un ancien épicier, selon les autres, un ex-douanier de Savone.
Mais comme tous les parvenus, il n’en était que plus arrogant, et sitôt le mariage célébré, il avait exigé, en dépit du jeune âge de la fiancée, d’exercer aussitôt ses droits conjugaux. Catherine, traitée comme une esclave par ce gros homme beaucoup plus vieux qu’elle, était sortie de l’expérience meurtrie, déçue mais fermement décidée à tirer de sa triste situation le plus grand parti possible : elle ne serait pas heureuse, soit. Mais du moins serait-elle puissante et riche !
Et de fait, pendant dix années, elle avait été la véritable reine de Rome, faisant de son palais de Saint-Apollinaire le rendez-vous de toutes les élégances, de toutes les noblesses et de tous les arts. Des enfants étaient nés, qui n’empêchaient pas Riario de courir les filles. Mais Catherine s’en moquait : elle régnait.
À vingt ans, sa beauté était célèbre dans toute la péninsule. Elle y ajoutait une vitalité débordante, une intelligence aiguë, une profonde culture et un orgueil quasi démesuré qui ne permettait à personne, et à l’époux moins encore qu’à quiconque, d’oublier ses origines princières. Ses toilettes étaient luxueuses, ses bijoux royaux, et sa maison capable de faire envie à une impératrice.
Malheureusement, toute cette fortune tenait à une chose bien fragile : la vie d’un vieillard. Or, le 12 août 1484, Sixte IV mourait dans une Rome écrasée de chaleur et en proie à la mort noire que ramenait chaque été la pestilence des marais voisins. La ville fermentait, bouillonnait comme un chaudron de sorcière, et tandis que les factions nobles, déchaînées, se livraient à de sanglants règlements de comptes, le peuple s’abandonnait au pillage des riches demeures des parents du défunt. Celui des Riario, bien sûr, venait en tête. C’était d’ailleurs une sorte de coutume, et les Romains se payaient ainsi, avec l’enthousiasme que l’on devine, des exactions subies durant le règne.
Prudemment, Girolamo Riario choisit de se terrer au milieu de l’armée pontificale, dont il était gonfalonier, et se retira au Ponte Molle, c’est-à-dire aux portes mêmes de Rome, attendant dans l’angoisse la nomination du nouveau pape dont dépendrait son sort.
Tandis qu’il se contentait de trembler sans songer un seul instant à utiliser sa puissance militaire, sa femme faisait face aux événements avec un courage magnifique. Enfermée dans le château Saint-Ange avec une poignée de soldats, une cuirasse lacée sur sa robe de drap brun et sur son corps déformé par une grossesse presque à terme, Catherine tenait Rome sous la menace de ses canons, bien décidée à ne sortir qu’après avoir obtenu du nouveau pontife une sérieuse contrepartie.
Une escarcelle pleine d’or à la ceinture, une hachette tordue à la main, elle imposa la terreur à la ville ainsi qu’au Sacré Collège, qui la savait capable de tout. Et son attitude énergique en imposa si bien que, lorsqu’elle consentit enfin à rendre la forteresse au nouveau pape, Innocent VIII, elle conservait ses biens et ses États de Romagne, jadis donnés par Sixte IV à son neveu bien-aimé. Ce fut donc en toute tranquillité et avec les honneurs de la guerre que, escortée de son époux et de ses enfants, elle gagna Forli et s’y installa pour y vivre comme n’importe quelle autre souveraine.
Malheureusement, à peine installé à Forli, le peu intéressant Girolamo se hâta d’y reprendre ses détestables habitudes et ne mit guère de temps à se faire exécrer. Tant et si bien qu’en 1488, il était proprement assassiné. Toutefois, aux yeux de sa femme, il n’en était pas moins le légitime seigneur, victime d’une poignée de croquants, et non seulement elle porta son deuil mais encore elle vengea sa mort avec un certain nombre de potences qui ne tardèrent pas à recevoir leur charge sinistre. Après quoi, la conscience tranquille, elle s’occupa d’elle-même et s’offrit un amant.
Elle s’était éprise, assez follement comme les femmes qui n’ont pas trouvé à épancher un cœur trop brûlant, d’une espèce de capitaine d’aventures, un certain Giacomo Feo, superbe garçon mais bête à pleurer et d’une prétention sans limite qui, jointe à une cruauté native, en faisait un être assez odieux.
Il l’était même tellement qu’en 1495, une conspiration menée par le propre fils de la comtesse, Ottaviano, régla le sort du beau capitaine, dont entre-temps Catherine avait fait son époux, car c’était une femme qui avait des principes et ne pouvait aimer que dans la légalité.
Cette fois, la vengeance fut atroce, parce que le cœur de la veuve était cruellement touché ; des hommes, des femmes et même des enfants payèrent de leur vie la mort du bien-aimé. Ottaviano lui-même ne dut son salut qu’à la rapidité de son cheval.
Catherine pleura beaucoup mais reçut chez elle un autre capitaine, un vrai cette fois, et une sorte de héros. Il se nommait Jean de Médicis et appartenait à la grande famille florentine. Mais décidément, le mariage ne réussissait guère à la dame de Forli : après un an de bonheur, Jean de Médicis mourait, de sa belle mort d’ailleurs, la laissant mère d’un petit garçon destiné à faire quelque bruit dans le monde{11}.
Veuve pour la troisième fois, la comtesse Catherine ne se remaria pas… mais on disait que son cœur battait un peu trop fort pour le beau Giovanni da Casale, qui commandait les troupes de sa forteresse… et sur lequel reposait une grande partie de sa défense.
Giovanni da Casale ! L’homme dont l’appui et l’amour étaient devenus ses biens indispensables à l’heure du grave danger que représentait Borgia.
Ce matin du 1er janvier, le fils du pape demeura un moment immobile et silencieux en face de la forteresse. Il ne se pressait pas. Il regardait, cherchant un moyen de mordre dans cet énorme gâteau de pierre dure dont la défense obstinée l’irritait. Sous lui, son cheval grattait du sabot le sol gelé.
Puis, avec un soupir, il recula, et sur un signe, les sonneurs embouchèrent leurs longues trompettes d’argent et lancèrent un appel dans l’air glacé. L’un des capitaines de Borgia s’approcha du fossé et interpella la sentinelle qui s’était penchée au créneau :
— Va dire à la comtesse que le seigneur duc désire lui parler sur l’heure.
Le soldat fit signe qu’il avait compris et disparut. César, impassible, attendait, laissant son regard errer par les trous du masque sur le camp français dont on pouvait apercevoir, d’où il était placé, toute l’étendue. De temps en temps, ses yeux revenaient au château fort, bâtisse ramassée et trapue, pas très élevée mais dont les fossés étaient si profonds qu’ils donnaient une énorme impression de puissance. Depuis trois semaines que les canons de Borgia battaient ses rudes murailles, celles-ci montraient tout juste quelques lézardes. Encore la comtesse les faisait-elle réparer durant la nuit.
Soudain, de l’une des tours, une voix claire se fit entendre :
— Que voulez-vous, seigneur duc ? Me voici !
Appuyée d’une main au créneau en forme de papillon, une femme éblouissante regardait César qui, machinalement, intimidé peut-être par l’aspect imposant de son ennemie, descendit de cheval, ôta son bonnet et salua en grand seigneur.
En l’honneur de l’année nouvelle, la dame de Forli avait fait toilette, de même qu’elle avait arboré sur ses murailles les bannières de toutes les familles qui lui étaient alliées, depuis les pilules{12} des Médicis jusqu’au lion de Bologne. Délaissant pour une fois l’armure devenue sa vêture la plus habituelle, elle portait une fastueuse robe de satin blanc, tellement brodée d’argent que dans le pâle soleil d’hiver, elle paraissait givrée. Une cape de velours noir, aussi grande que celle du Borgia mais doublée d’hermine, la protégeait du froid, et sous le voile argenté qui ennuageait sa tête, les diamants qui semaient ses épais cheveux d’un blond de lin jetaient des éclairs. Dans tout ce blanc et tout ce noir, qui étaient d’ailleurs ses couleurs, Catherine avait l’air d’une apparition et César ne put s’empêcher de penser qu’en dépit de ses trente-six ans, sa taille et son pur visage éclairé de deux grands yeux couleur d’aventurine étaient ceux-là mêmes d’une jeune fille. Visiblement, elle attendait qu’il parlât, et devant son silence, fronçait déjà les sourcils.
— Eh bien ? fit-elle.
— Madame, fit César, j’ai à cœur de vous montrer la très haute estime en laquelle je vous tiens et de vous persuader que je ne voudrais jamais, non seulement maltraiter, mais seulement contrister plus qu’il n’est nécessaire votre personne. Et je vous propose, et je vous conjure de me céder spontanément cette forteresse de Ravaldino. Je vous promets les conditions les plus avantageuses. Ainsi, vous ferai-je assigner par le Souverain Pontife des revenus convenables pour Votre Seigneurie et pour ses enfants. Je vous en donne ma parole et m’en porte garant : vous pourrez même vous établir à Rome si cela vous agrée, à moins que…
La comtesse, qui jusqu’à cet instant avait écouté son ennemi sans sonner mot, l’interrompit d’un geste sec :
— Brisons là, seigneur duc, fit-elle. Je suis fille d’un homme qui n’a point connu la peur et suis déterminée à marcher sur ses traces tant que Dieu m’accordera un souffle de vie. Je vous rends grâce de la bonne opinion que vous prétendez avoir de moi, mais quant à la promesse que vous me faites aujourd’hui en votre nom et en celui du pontife suprême, je me vois forcée de vous dire que, les prétextes invoqués par votre père pour me faire déchoir de mes droits souverains ayant été déclarés iniques et misérables par tout le monde, je tiens vos promesses et les siennes pour fallacieuses et menteuses. L’Italie tout entière sait ce que vaut la parole des Borgia et la mauvaise foi du père enlève tout crédit aux offres de son fils.

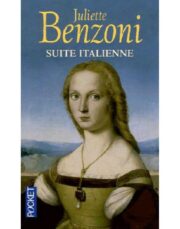
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.