Bon gré mal gré, il fallut bien que Lucrezia, plus morte que vive, précédât sa maîtresse. Son domestique lui avait dit que la maison était cernée et Ludovic était dans sa chambre. En désespoir de cause, elle l’avait poussé derrière un rideau, dans sa garde-robe, et il n’était guère encourageant de savoir qu’il avait presque aussi peur qu’elle.
Lentement, sans lui faire grâce de rien, la duchesse visita chaque pièce, commentant chaque objet, chaque peinture, mais ce fut dans la chambre qu’elle s’attarda le plus longtemps. Sa main, gantée de peau souple, poussa négligemment une porte peinte.
— Ta garde-robe, j’imagine ? Montre-moi tes robes. Tu sais combien j’adore les chiffons.
Lucrezia, flageolante, dut s’appuyer au mur pour ne pas tomber en voyant la dame d’honneur ouvrir les coffres, sortir les robes. La duchesse cherchait quelqu’un, elle en était sûre et malheureusement, son visage décoloré avait dû la renseigner amplement. Bientôt, Béatrice aperçut, sous un rideau, le bout d’une botte en maroquin vert… et ce fut elle qui dut se raidir.
Au prix d’un violent effort sur elle-même, elle parvint à retenir le geste qui la poussait à écarter ce rideau, à découvrir le coupable. Mais son orgueil la sauva.
Une Este ne pouvait s’abaisser à une réaction de petite-bourgeoise. D’un geste nerveux, elle rejeta l’étoffe qu’elle examinait.
— Rien de fort beau… Celui qui t’entretient est bien ladre, ma fille ! C’est misérable ici.
Puis, sans un regard à la malheureuse Lucrezia, elle saisit le bras de sa suivante et sortit. Malgré ses fourrures, elle tremblait comme une feuille. Mais elle refusa de rentrer au château. Elle voulait chercher l’apaisement dans la prière et se fit conduire à Sainte-Marie-des-Grâces.
Elle aimait cette église que venait de construire Bramante et pria longtemps dans le sanctuaire. Avant de partir, elle gagna le réfectoire du couvent. Sur un vaste échafaudage, Léonard de Vinci travaillait à une grande fresque représentant la dernière Cène.
— Ne bougez pas, messer Leonarde ! lui dit-elle gentiment tandis qu’il dégringolait et venait s’agenouiller devant elle. Je passais. Laissez-moi seulement admirer. C’est magnifique… vraiment très beau. Comme j’aimerais être sûre d’en voir la fin, ajouta-t-elle, prise d’un brusque pressentiment.
Le peintre allait parler, protester, mais elle lui ferma la bouche d’un geste triste.
— Non, ne dites rien. Je crois que je suis malade, mon ami, très malade… et que je ne durerai guère. Dieu vous garde.
Et elle s’éloigna, petite silhouette emmitouflée, pitoyable malgré ses joyaux, que Léonard regarda disparaître, péniblement impressionné par ce regard désespéré qu’elle avait eu, par ce masque tragique sur son jeune visage. Se pouvait-il que la mort eût déjà marqué cette créature qui incarnait la vie même ?
Il y avait bal, ce soir-là au château, et les danses avaient commencé. Lentes, graves, elles semblaient faites pour les robes fantastiques et somptueuses des dames. Elles s’approchaient de leurs cavaliers puis s’en séparaient avec solennité, saluaient gracieusement pour revenir encore reprendre les mains offertes. La musique était douce, tendre et presque mélancolique, propice aux rapprochements amoureux, et ce soir, elle faisait mal aux nerfs de Béatrice, qui l’avait tant aimée.
Pour paraître à cette fête, elle avait rassemblé tout ce qui lui restait de forces. Parée comme une madone, ruisselant d’or et de pierreries qui faisaient plus tragique encore son petit visage peint et maquillé, elle était apparue, droite, la tête haute, comme une idole impassible, si hautaine et si lointaine que Ludovic n’avait pas osé rencontrer son regard. Presque timidement, il était venu lui offrir la main pour la conduire au trône ducal, mais il n’avait pas osé s’y asseoir auprès d’elle. Elle savait tout de lui à présent et une gêne affreuse le paralysait, jointe à l’inquiétude d’avoir trouvé glacée la main qu’il avait prise.
— Bice, implora-t-il, tu es bien pâle… Tu ne devrais pas être ici…
Elle n’avait pas répondu, s’était détournée pour sourire aux stupides compliments, aux fadaises de ses courtisans. Jamais elle n’avait senti son cœur si lourd, si oppressé. Il lui semblait que ses forces coulaient de ses membres comme de l’eau. Mais sa nature la poussait à combattre encore, contre elle-même, contre le sort, contre la mort même s’il le fallait, tant qu’il lui resterait un souffle. Avec un regard de défi à son époux, elle annonça :
— Je veux danser.
— Bice ! Ce n’est pas sérieux ?
Sans répondre, elle appela du geste l’un de ses fidèles, Gaspare Visconti, lui tendit la main pour qu’il l’aidât à descendre du trône.
Lentement, au milieu d’un silence profond, elle s’avança, vision éblouissante dans ce décor de fête. La musique reprit, très doucement, comme si elle hésitait. Béatrice sourit à son cavalier, fit quelques pas, tourna légèrement, se plia pour une révérence. Mais les caissons bleu et or du plafond se mirent soudain à tournoyer. Le sol parut se dérober, les murs s’abattre comme si un tremblement de terre avait soudain secoué le palais. Avec un cri plaintif, Béatrice d’Este glissa sur le sol, sans connaissance… Le bal était fini.
À peine eut-on rapporté la duchesse dans son lit que les douleurs de l’enfantement commencèrent, prématurées mais si violentes qu’elles achevèrent l’œuvre de mort. Bien avant le lever du sombre jour d’hiver, la jeune duchesse de Milan avait cessé de vivre.
Le vendredi suivant, son corps léger, délivré de l’enfant mort-né, était conduit à Sainte-Marie-des-Grâces par un cortège si long que son commencement entrait déjà dans l’église alors que sa fin n’avait pas encore quitté le château des Sforza. Ludovic le More le suivit, tête nue, vêtu de noir, le désespoir au cœur. Pis encore : un noir pressentiment l’assaillait dont il ne pouvait se défaire : celui que Béatrice, avec elle, avait emporté sa chance. Elle avait été une étoile joyeuse dans sa vie, une étoile qui ne se rallumerait plus… son étoile ! Que serait maintenant le destin de l’homme qui avait usurpé le trône de Milan ?
Les voix profondes des moines entonnèrent les cantiques de la mort. L’époux de Béatrice ferma les yeux et frissonna…
Trois ans plus tard, sa défaite à Novare en faisait le prisonnier de Louis XII, et tandis que le Milanais tombait aux mains des Français, Ludovic allait vivre ses dernières années derrière les murs formidables du donjon de Loches. Il n’en sortit en 1508 que pour mourir de joie d’avoir retrouvé le soleil et l’air libre.
La dame de Forli
I Échec à César !
Vêtu d’un grand manteau noir qui recouvrait presque totalement son armure et s’étalait sur la croupe luisante du cheval, une plume blanche agrafée d’un beau diamant à son bonnet de velours noir, César Borgia chevauchait d’un air sombre. Le dos rond, le regard lointain, il cachait sous un masque son visage couvert de pustules par le violent accès de la syphilis qui le rongeait. Quand il était aux prises avec le mal, César cachait sa figure, devenue repoussante, même à ses plus intimes familiers.
Précédé de ses sonneurs de trompettes, il traversa Forli sous la bise aigre de ce 1er janvier 1500, franchit la porte de Ravaldino et s’approcha de la forteresse silencieuse, retranchée derrière son large fossé plein d’eau, murée dans une défense hautaine. Derrière les créneaux, on apercevait la silhouette grise des hommes d’armes qui veillaient, en apparence indifférents à la masse compacte des troupes et des tentes qui investissaient leur dernier refuge.
Le XVe siècle venait de se terminer et ce froid matin d’hiver marquait la naissance d’un nouveau siècle, dans les Romagnes dévastées par la guerre qui offrait un aspect bien sombre. Chacun se terrait chez soi, autant pour se protéger de la neige et du gel que de cette armée de quatorze mille hommes qui avait ravagé les campagnes et campait maintenant sous Forli. Une belle armée en vérité, forte et magnifique, l’armée de César Borgia ; fils du pape Alexandre VI et duc de Valentinois par la grâce de Louis XII, roi de France, et aussi par l’effet de son mariage avec la belle Charlotte d’Albret.
Avec cette armée, César voulait se tailler un royaume dans la mosaïque d’États indépendants dont se composait alors l’Italie, qu’il déclarait vouloir « manger feuille à feuille comme un artichaut ». Et comme entrée en matière, il avait jeté son dévolu sur les Romagnes. Le roi Louis XII ayant conquis le Milanais avec la bénédiction du pape, César avait entraîné ses alliés français, peu enthousiastes mais liés par leur alliance, à l’attaque de ces Romagnes, authentique verrou soudé entre le territoire de Florence et les États de Venise.
Il avait cru venir aisément à bout du premier État romagnol parce qu’il appartenait à une femme. Mais depuis trois semaines qu’il avait pénétré sur ses terres, Catherine Sforza, comtesse d’Imola et de Forli, lui avait démontré que toutes les femmes n’étaient pas de faibles créatures faciles à vaincre.
Néanmoins, par crainte des rigueurs d’un siège, Imola avait ouvert ses portes au Borgia et Forli elle-même, la capitale comtale, travaillée par les couards de son Conseil communal, l’avait reçu sans coup férir, mais la victoire n’était pas acquise pour autant car, enfermée dans la forteresse de Ravaldino commandant la cité, Catherine, bien pourvue d’armes, d’hommes et de vivres, narguait Borgia et menaçait sa capitale traîtresse qui, sans Ravaldino, n’était guère plus qu’une coquille vide. Les canons de la comtesse tiraient aussi bien sur les assiégeants que sur la ville et, sur le donjon de la citadelle, sa bannière où se tordait la vipère des Sforza toisait insolemment le taureau Borgia.

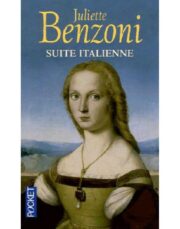
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.