Ferdinand était arrivé et des visites courtoises avaient été échangées. Le 12 octobre, une grande partie de chasse réunit cette étrange famille. On courut le cerf et le lièvre à travers la campagne toscane, puis on se retrouva chez le cardinal pour un fastueux banquet. En rentrant, les deux époux s’attardèrent auprès d’un petit lac de leur propriété pour jouir d’une nuit splendide… et le lendemain, tous deux devaient garder le lit, pris d’une fièvre violente.
Chez François, cette fièvre s’aggrava bien vite du fait qu’il se soigna lui-même avec des médicaments de son cru, qui avaient tout au moins le mérite de l’originalité : le bouc, le hérisson et le crocodile s’y mélangeaient aux pierres précieuses et aux perles pilées. À ce régime, le prince ne tarda pas à entrer en agonie.
De son côté, Bianca se sentait décliner. Par une étrange prescience, elle avait toujours prophétisé qu’entre la mort de son époux et la sienne propre il ne s’écoulerait que quelques heures. Quand elle comprit que le temps, désormais, lui était compté, elle fit appeler son confesseur et lui dit :
« Faites mes adieux à Monseigneur François et dites-lui que je lui ai toujours été très fidèle et très aimante ; dites-lui que ma maladie n’est devenue si grande qu’à cause de la sienne et demandez-lui pardon si je l’ai offensé en quelque chose… »
Mais François était déjà mort et ne put recevoir cet ultime message. Peu après, Bianca Capello, à son tour, fermait les yeux pour toujours, tuée par une nuit humide ou par un festin mal digéré. Le mystère, si mystère il y a, n’a jamais été éclairci. Mais les sénateurs de Venise n’eurent qu’une seule voix pour déclarer : « Notre fille a été empoisonnée par le cardinal ! »
Autour des deux cadavres, une joie insultante éclata dans tout Florence. On illumina. Le cardinal, jetant sa soutane aux orties, accepta la couronne grand-ducale. Mais, s’il fit faire à son frère des funérailles grandioses, il refusa la sépulture chrétienne à Bianca, et c’est dans un terrain vague que fut enterrée clandestinement « la Sorcière »…
Sforza (MILAN et FORLI)
La bonne étoile de Ludovic le More :
Béatrice d’Este
L’automne enveloppait Ferrare de sa chaleur adoucie, de ses teintes flamboyantes et d’une vie nouvelle, succédant aux torpeurs accablantes de l’été. La vigne mûrissait, accrochée à ses hauts espaliers, dans l’immense plaine du Pô dont le cours retrouvait vigueur et couleur. C’était un bel automne que celui de cette année 1489 et pour les gens de Ferrare, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ne possédaient-ils pas l’une des plus grandes villes d’Italie, la plus moderne en tout cas ? Le duc Hercule Ier d’Este régnait avec sagesse et il était des marchands qui se reconnaissaient moins avisés que lui tandis que les hommes de guerre admettaient en lui un seigneur.
Au premier étage de ce château, dans une grande salle peinte à fresque, une très jeune fille, presque une fillette encore, assise très droite sur un escabeau d’ébène recouvert de velours pourpre, posait pour un sculpteur, mais posait sans joie aucune. C’était tellement ennuyeux de rester ainsi immobile ! Son corps lui semblait empli de fourmis et il avait fallu toute l’autorité de la duchesse sa mère pour que la jeune Béatrice d’Este consentît à cette corvée, obligatoire puisque le buste que l’on exécutait était destiné à un homme sur le point de demander sa main.
Cela, d’ailleurs, n’arrangeait rien. Béatrice n’avait aucune envie de se marier. Elle aimait la vie libre, les chevaux, la chasse, les courses folles à travers la campagne et aussi tout ce qui composait la vie d’une princesse de la Renaissance : l’étude des sciences, les arts, la peinture, la musique, la danse (dont elle raffolait). Où voulez-vous caser un mari dans tout cela ?
La mauvaise humeur de la jeune fille ne faisait pas davantage l’affaire du sculpteur, un maître cependant, le célèbre Cristoforo Romano, envoyé de Milan par le duc de Bari, oncle du duc régnant. Ou bien la jeune princesse bougeait trop ou bien elle se figeait avec une raideur désespérante, empêchant ainsi l’artiste de rendre fidèlement ce qui faisait son plus grand charme : cette extraordinaire vitalité qui émanait d’elle, cette joie de vivre, ce charme qu’irradiait toute sa personne. Le marbre ne reflétait que ses traits : ceux d’une gamine aux joues rondes, aux lèvres fortes et au petit nez pointu avec des épaules étroites et une poitrine plate. Une seule chose demeurait : l’étonnante majesté naturelle de cette enfant capable d’en imposer aux hommes les plus assurés.
Mais Cristoforo se tourmentait. Monseigneur Ludovic, dont le goût pour les jolies femmes était célèbre, n’apprécierait guère en cette petite princesse que l’alliance, haute et profitable. Et il avait hâte d’en finir : le silence obstiné que gardait cette petite fille au regard accusateur était extrêmement pénible.
Soudain, elle parla, mais d’un ton si pointu que Cristoforo n’en fut pas autrement réconforté.
— Quel âge a mon futur époux ? demanda-t-elle brusquement.
— Euh !… trente-sept ans, Madona. Mais il est un fort bel homme, très séduisant, très galant, très…
— Il est vieux ! coupa Béatrice. J’espère bien que mon buste ne lui plaira pas.
Elle n’ajouta plus un mot. Cristoforo essuya la sueur qui coulait de son front à sa manche de velours et, avec un soupir, se remit au travail. Achever ce calvaire au plus vite et rentrer à Milan de toute la vitesse de son cheval…
C’étaient l’ambition et la nécessité politique qui avaient conduit Ludovic Sforza, surnommé le More, à cause à la fois de sa peau un peu brune et de ses armoiries qui représentaient un mûrier (moro), à demander la main de Béatrice d’Este. Sa situation avait grand besoin d’être renforcée s’il voulait atteindre un jour cet objectif que toute sa vie il s’était fixé : monter sur le trône de Milan, régner enfin, lui, le dernier des fils du grand Francesco Sforza.
Après la mort de son frère, Galeas, assassiné à Milan en 1476, il s’était associé pour la régence à sa belle-sœur Bona de Savoie, sœur de la reine de France{10}, mais il voulait le pouvoir avec trop d’âpreté pour qu’une femme fût longtemps gênante. Une histoire d’amour lui avait permis d’éliminer la trop peu méfiante Bona et depuis, il avait exercé seul la régence durant la minorité de son neveu, le jeune duc Jean-Galeas, de santé faible et d’esprit infiniment moins robuste et moins retors que son superbe oncle. Car, avec son visage brun aux yeux vifs, au grand nez majestueux, avec sa haute taille et sa fière prestance, c’était un bel homme que Ludovic, et son charme agissait autant sur les Milanaises que sa poigne sur leurs époux.
Les choses auraient pu durer ainsi encore longtemps mais en janvier 1489, le jeune Jean-Galeas épousait Isabelle d’Aragon, petite-fille du roi de Naples. C’était une jolie fille, longue et souple, au visage de chat sous de magnifiques cheveux blond foncé, aux yeux graves qui eussent peut-être séduit le duc de Bari. Mais quand ces yeux-là rencontrèrent les siens, le régent eut la sensation pénible que cette jeune fille ne serait jamais son amie. Elle était d’emblée, et il le sentit parfaitement, son ennemie. Il la devinait avide de pouvoir, énergique. S’il n’y prenait garde, cette Isabelle était capable de secouer l’indolent Jean-Galeas et de l’obliger à prendre ce pouvoir auquel son oncle tenait tant.
Or, il lui fallait une épouse pour lui-même et justement, quelques années plus tôt, des projets de mariage s’étaient ébauchés avec la petite Béatrice d’Este. Il était temps, pensa Ludovic de les mettre à exécution.
Le buste que rapporta Cristoforo Romano ne souleva, comme l’avait prévu le sculpteur, qu’un enthousiasme très restreint chez le sensuel duc de Bari.
— Ainsi, c’est là ma fiancée ? dit-il en contemplant l’œuvre de son envoyé. Et c’est un portrait fidèle que tu m’as fait là ?
— Fidèle quant aux traits, Votre Grâce, mais mon ciseau a été impuissant à rendre le charme et la vivacité qui émanent de la princesse. Elle semble faite de vif-argent et cependant sa dignité est sans exemple. En vérité, nul ne saurait lui résister. Il faut la voir, seigneur, le marbre est trop froid, trop conventionnel, pour cette flamme sans cesse en mouvement.
— Peste, quel enthousiasme ! Tu me montres là une gentille gamine et tu en parles comme d’une sylphide.
— Voyez-la, Monseigneur, je crois que vous serez conquis.
Ludovic le More eut une moue dubitative. Depuis bientôt dix ans, il était amoureux de l’éblouissante Cecilia Gallerani, la plus belle fille de Milan, la plus savante aussi. Une âme de poète dans un corps de nymphe ! Elle l’avait envoûté, réduit à l’esclavage. Pour célébrer sa beauté, il avait emprunté au maître de Florence, Laurent le Magnifique, l’un des admirables peintres dont sa ville était si riche.
Le Magnifique lui avait envoyé un personnage à peu près inconnu mais qui se doublait d’un habile ingénieur et qui savait faire toutes choses. C’était un homme grand et majestueux, d’une extraordinaire beauté et dont le regard semblait toujours aller au-delà des choses humaines. Il s’appelait Léonard de Vinci.
Le nouveau venu fit de Cecilia un admirable portrait (La dame à l’hermine) et devint le meilleur ami de son maître.
Épouser Béatrice, cela voulait dire se séparer de Cecilia, du moins en apparence, car le duc ne se sentait pas le courage de renoncer définitivement à elle. À son ami Sanseverino qui lui posait la question, il répondit après mûre réflexion :
— Je vais la marier, mais à quelqu’un dont je n’aurai rien à redouter. Le vieux comte Bergamini fera l’affaire, moyennant une belle somme en or, car il saura fermer les yeux. J’espère qu’ainsi la susceptibilité de dona Béatrice sera mise à l’abri. Tu penses bien que je ne vais pas me priver de ma merveilleuse Cecilia pour une gamine aux grosses joues.

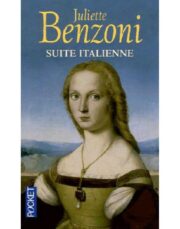
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.