« Un si grand forfait ne saurait demeurer impuni sans que la terre ne crie vers le Ciel. Et que le coupable soit un serviteur de Dieu ne fait qu’accroître sa honte. Il vous appartient, mon seigneur et frère, d’user envers lui de la plus extrême rigueur, car c’est votre propre sang qu’il a osé faire couler… »
Cette lettre plongea Alphonse d’Este dans une grande perplexité. Il était sincèrement navré de ce qui était arrivé à Jules et en éprouvait une profonde indignation. Mais d’autre part, il avait peine à frapper Hippolyte, son meilleur et son plus fidèle conseiller. Par ailleurs, tous deux étaient fils légitimes du duc Hercule et d’Éléonore d’Aragon, alors que Jules était de naissance irrégulière. Enfin, il lui répugnait de donner satisfaction au pape Jules II, son ennemi, qui, de Rome, profitant de l’occasion, fulminait contre Hippolyte et réclamait sa tête pour la seule raison qu’il ne pouvait le souffrir.
Voulant se donner le temps de réfléchir, le duc commença par faire emmener le blessé à Ferrare afin de l’avoir sous la main et d’essayer de modifier autant que faire se pourrait ses sentiments envers le cardinal. Le 6 novembre, le pauvre Jules parvenait au château, installé aussi confortablement que possible et les soins redoublèrent. Ils ne l’empêchèrent d’ailleurs nullement d’endurer un véritable martyre.
Avec une patience et une sollicitude assez éloignées de ses habitudes, Alphonse d’Este entoura personnellement le blessé d’attentions. Il s’installait de longues heures à son chevet, écoutant ses plaintes, veillant à ce qu’il ne manquât de rien, pressant les médecins pour obtenir la moindre lueur d’espoir.
Les souffrances du blessé diminuèrent. Vint enfin le jour où Alphonse put affirmer à son jeune frère qu’il ne serait pas aveugle.
— Les médecins jurent que l’un de vos yeux sera sauvé. Vous ne verrez que d’un œil, mais vous verrez clair.
— Si vous saviez combien cela m’est égal, répondit Jules amèrement. J’aimerais cent fois mieux être mort, et mon seul regret est que ces misérables ne m’aient pas tué tout à fait.
Le duc posa une main apaisante sur l’énorme paquet de pansements qui entourait la tête du blessé et murmura :
— La vie est douce chose, mon frère, et la lumière est un si grand bien qu’avoir l’assurance de la retrouver doit vous apaiser quelque peu.
— La lumière ne montrera que mieux quel objet d’horreur je suis devenu. Pensez-vous, mon frère, que ce soit là une vie digne d’être vécue ?
— Vous étiez destiné à l’Église, Jules, vous l’êtes toujours. Dieu ne regarde que la beauté des âmes.
— Dites cela au cardinal Hippolyte, monseigneur, vous le ferez bien rire. Et penser que tandis que je suis ici à souffrir comme une bête, à me désespérer, lui est libre, heureux. Alors que je voudrais le voir mort, je voudrais qu’il endure tout ce que j’ai enduré, je voudrais…
Il s’énervait. Le duc prit sa main et la serra. Elle était brûlante.
— Calmez-vous, je vous en conjure ! Vous vous faites mal sans rien arranger. Jules, je donnerais des années de vie pour vous ramener à votre état d’autrefois et vous savez combien la justice m’est chère, mais le cas du cardinal nous pose un grave problème de gouvernement. Nous sommes princes et n’avons que trop d’ennemis. Et je voulais vous demander si, au nom de notre père, au nom de la grandeur et de la prospérité de Ferrare… il ne vous est pas possible d’envisager… le pardon.
Le blessé bondit comme si on l’avait piqué avec une épingle longue. Le paquet de pansements se tourna vers le duc Alphonse et il en sortit un cri de fureur.
— Pardonner ? à qui ? À ce misérable qui a fait de moi un monstre ?
— Qui vous a dit que vous serez un monstre, une fois ôtées ces bandelettes ?
— Moi ! Je l’ai senti. Il m’a suffi, lorsque l’on change ces pansements, de passer mes doigts sur mon visage. Je suis défiguré, monseigneur, et vous le savez fort bien. Non, je ne puis pardonner. Je veux même qu’on le punisse avec une exemplaire sévérité.
— Vous êtes encore trop malade pour juger sainement des choses, Jules. Et je ne vous cache pas que punir publiquement le cardinal risque de me mettre dans un cruel embarras. Outre qu’il est pour Ferrare un conseiller plein de sagesse, une querelle aussi grave dans notre famille ne peut qu’encourager ceux qui nous guettent de toutes parts. Il y a le pape, qui conquiert en ce moment la Romagne et regarde bien souvent de notre côté d’un œil luisant de convoitise. Il y a Venise, notre redoutable voisine, qui de tout temps, a convoité nos États…
— Il y a la France, qui est avec vous, pour vous, et avec qui vous entretenez les meilleures relations depuis que le roi Louis XII a conquis le Milanais.
— En effet, mais le gouverneur de Milan, Monsieur de La Palice, a tout juste assez de troupes pour maintenir l’ordre chez lui. En cas d’attaque, et d’attaque sur plusieurs fronts, il ne pourrait se porter à notre secours. C’est pourquoi, Jules, j’ai voulu vous demander de réfléchir à ce mot de pardon qui vous fait horreur pour le moment. En acceptant, au moins des lèvres sinon du cœur, de renoncer à la vengeance qui vous est due, vous rendrez à votre patrie un immense service… et vous aurez à jamais droit à ma reconnaissance !
Longtemps encore, Alphonse d’Este parla, lui qui parlait si peu d’ordinaire, plaidant sa cause, promettant de l’or, des terres, essayant désespérément d’extirper la haine et la rancune du cœur du blessé. Cela, c’était impossible. Mais Jules aimait son frère aîné et il consentit à réfléchir.
Deux jours plus tard, il finit par lui dire qu’il renonçait à sa vengeance. Soulagé, le duc respira. Mais il lui restait à répondre à une question difficile.
— Depuis que je suis ici, fit le blessé, je n’ai reçu aucune nouvelle de dona Angela ? Est-elle donc encore à Belriguardo avec la duchesse ?
— Elle y est toujours, en effet. Votre malheur, vous le devinez, lui a porté un coup très rude et dans son état, les médecins ont jugé qu’il valait mieux pour elle demeurer encore éloignée à la campagne. Quand elle sera tout à fait bien, elle reviendra. Mais je sais qu’elle fait demander très souvent de vos nouvelles.
Pour toute réponse, Jules se contenta de soupirer. Des nouvelles ? Des nouvelles sans réponse, alors ? Pourquoi donc Angela ne lui écrivait-elle pas ? N’importe quel familier aurait pu lui lire ses lettres. Elle était devenue bien prudente tout à coup. Pourtant, nul n’ignorait plus à la cour de Ferrare que l’enfant qu’elle portait était son enfant à lui…
Cependant, le duc n’avait pas osé avouer à son jeune frère que l’affreuse mutilation du beau visage qu’elle aimait tant avait emporté d’un seul coup tout ce grand amour qu’Angela avait voué à Jules. C’était de beauté physique, plus encore que de rang ou de fortune, qu’était éprise la coquette fille. La face sanglante et hachée qu’elle avait un instant contemplée l’avait d’abord jetée dans l’épouvante, mais elle éprouvait désormais un insurmontable dégoût à l’idée de revoir son amant. C’était elle, maintenant, qui repoussait de toutes ses forces l’idée d’un mariage avec Jules, mariage que, pour apaiser son frère, Alphonse eût accordé sans hésiter.
De plus, il y avait l’enfant, dont la naissance était proche. Certes, il était facile de s’en débarrasser dès son entrée dans le monde en le confiant à de braves gens que l’on paierait grassement, mais il n’en serait pas moins là, et Angela commençait à s’inquiéter pour son avenir. Cette maternité ne lui ferait aucun bien et la rendrait plus difficile à caser. Or, Angela souhaitait éperdument se marier et atteindre la stabilité et la respectabilité.
Le mois de décembre était à peine entamé qu’elle promettait sa main à un puissant baron de la montagne, Alexandre Pio de Carpi, seigneur de Sassuolo, dans l’Apennin modénais. Ce n’était pas un homme excessivement beau et ses yeux n’avaient pas de quoi faire rêver une fille exaltée, mais il était riche, puissant, et de taille à garder son bien contre toute attaque. En somme, le mari idéal, d’autant qu’il était follement, éperdument, épris de la trop jolie future mère.
Bientôt Angela, tandis que Jules sur son lit de souffrances attendait en vain une lettre qui ne viendrait jamais, fut tout entière aux préparatifs de son mariage.
Alphonse d’Este avait décidé que la réconciliation de ses frères aurait lieu à Ferrare, la veille de Noël, afin que cette fête de tendresse ajoute sa douceur et sa joie à son projet de rapprochement. Il avait espéré qu’Hippolyte saurait se montrer convenablement repentant.
Mais le cardinal, revenu vingt-quatre heures plus tôt, s’était réinstallé dans son appartement sans montrer la moindre repentance. Il était toujours aussi dur, aussi arrogant et plusieurs dans l’entourage du duc fronçaient les sourcils devant une telle dureté de cœur. Certains allaient même jusqu’à prédire qu’il n’en sortirait rien de bon. Déjà, il avait été difficile d’obtenir de don Jules ce pénible pardon et la moindre des choses eût été qu’Hippolyte en montrât au moins quelque reconnaissance.
Celui qui se montra le plus indigné de cette attitude fut le second des frères d’Este, don Ferrante. Il aimait sincèrement Jules. Ils avaient été de tout temps inséparables. Et Ferrante plaignait Jules autant qu’il en voulait à Hippolyte.
— Notre frère, disait-il avec rage, paraît servir un tout autre maître que Dieu ! Il serait temps pour lui d’apprendre l’humilité et l’amour de son prochain.
Mais apparemment c’étaient là deux sentiments aussi éloignés du cardinal que la lune et les étoiles le sont de la terre.
Quand vint la veillée de Noël, la grande salle du château de Ferrare s’illumina d’une forêt de torches portées par des valets. Les flammes dansaient et communiquaient une vie nouvelle aux personnages des tapisseries. Annoncé par une sonnerie de trompettes, Jules fit son entrée au bras de Ferrante. Un profond silence l’accueillit, car le duc avait menacé des pires châtiments quiconque se permettrait une seule exclamation ou manifesterait le moindre mouvement de répulsion devant le jeune homme. Car malheureusement, il était affreux à voir.

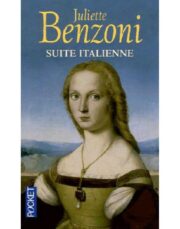
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.