Mais quand l’aîné des Médicis vint s’agenouiller devant Lucrezia pour recevoir sur son casque le laurier d’or du vainqueur, la jeune femme faillit éclater en sanglots. Elle espérait, à cette rencontre suprême, recueillir au moins un regard d’amour, un regard aussi lourd de regrets que le sien propre. Or, Laurent lui avait souri assez distraitement, tandis que ses yeux noirs se tournaient continuellement, les paupières un peu plissées à cause de sa myopie, vers la place où rayonnait Simonetta.
Un soupir échappa à la reine d’un jour. Allons ! Le temps de l’amour était bien mort et la jeune femme en venait presque à plaindre la princesse romaine qu’elle détestait tant l’instant précédent.
Le 4 juin suivant, Laurent de Médicis épousait Clarissa Orsini, au milieu de fêtes somptueuses. Mais si l’événement marqua beaucoup la vie mondaine de Florence, celle du nouvel époux ne le fut guère, car dans son journal intime, on trouve à la date de ce jour nuptial :
« Moi, Lorenzo, j’ai pris pour femme dona Clarissa, fille du seigneur Jacopo Orsini. Ou plutôt, elle me fut donnée… »
Constatation indifférente et fort peu encourageante pour une jeune femme. Laurent se mariait parce qu’il le fallait, pour la descendance et pour la gloire de sa maison. Que Clarissa fût rousse comme une flamme, belle et orgueilleuse, était de peu d’importance. Elle était princesse et digne de porter les enfants du maître de Florence (encore qu’elle n’en fût pas tellement fière, considérant le Magnifique, de son point de vue de princesse romaine d’ancienne souche, comme un vulgaire fils de marchands enrichis et parvenus). Quant à l’esprit de son époux, comme celui de Julien et comme celui de tous les hommes de Florence, il s’était tourné une fois pour toutes vers une blonde et radieuse enfant en qui semblait s’incarner tout l’éclat du printemps des collines toscanes.
Car la présence de Simonetta déterminait dans la cité du Lys rouge un curieux phénomène, comme il ne s’en produit pas un par siècle : toute la ville, avec ensemble, était tombée amoureuse d’elle ! Il n’y avait guère d’homme qui n’en rêvât et même les femmes, chose extraordinaire, l’admiraient sans la moindre jalousie. Elle était si belle, si douce, si lumineuse, que les Florentins, superstitieux, n’étaient pas loin de la croire un ange descendu sur la terre pour la plus grande gloire de leur ville. Quant à la nature exacte des sentiments qu’elle inspirait, s’ils étaient profonds, violents parfois, ils étaient beaucoup plus proches de la vénération que du désir charnel.
Le plus atteint de tous, en dehors des Médicis, était un jeune peintre de vingt-cinq ans, Sandro Filipepi, qu’agrémentait déjà le surnom de Botticelli.
Avec son père, Marino le tanneur, et sa famille, Sandro vivait dans la partie basse de Florence, là où, entre Arno et Mugnone, couraient les canaux d’eau sale, souillée par les déjections des tanneries et des teintureries, non loin de l’église d’Ognissanti… et tout près du palais Vespucci. C’était un garçon étrange, délicat, raffiné, et quelque peu visionnaire. Ses peintures, dont raffolait Laurent de Médicis, reflétaient ses rêves. Il était l’habitué, le protégé de son palais de la Via Larga, et dès qu’il aperçut Simonetta, Sandro tomba sous un charme puissant dont il ne devait jamais se relever.
Peu à peu, l’image de la jeune femme prit l’habitude de naître sous son tendre pinceau. Et Sandro, amoureux sans même le savoir, adorait tout simplement, à deux genoux et en extase, celle que le peuple appelait l’Étoile de Gênes… Comme si elle eût été un diamant fabuleux.
Un soir, après le souper au palais Médicis, Laurent vit que Julien se disposait à sortir. Ce n’était pas un événement en soi car Julien sortait presque tous les soirs, mais il s’était vêtu avec un soin tout particulier et même une magnificence un peu inusitée. L’aîné laissa s’éteindre la mélodie qu’il jouait distraitement sur son luth et leva sur le jeune homme un regard amusé.
— Comme te voilà beau ! Pour quelle belle t’es-tu si bien paré ? Car ce ne peut être que pour une femme.
Julien ne songea même pas à éluder la question. D’un mouvement vif, il se laissa tomber à genoux près de son frère, saisit sa main maigre et y déposa un baiser léger.
— Bien sûr… Malheureusement, la parure est insuffisante. Je ne serai jamais assez beau pour elle.
Déjà relevé, Julien ne vit pas la soudaine pâleur qui s’étendit sur le visage du Magnifique.
— Est-ce donc… elle qui t’attend ?
— Oui, Laurent. J’ai ce bonheur et je n’arrive pas à y croire encore. Elle m’aime, mon frère, elle m’aime, et cette nuit, son époux sera à Pise !
Au prix d’un cruel effort de volonté, Laurent réussit à maîtriser la douleur soudaine qui lui vrillait le cœur. Ainsi, la belle Simonetta avait choisi. Et en respectant, hélas, les lois normales de dame Nature. Au plus beau, la plus belle. À lui, le Maître, qui cachait son amour sous un extérieur impassible, ne restait que le droit d’aimer de loin… Mais il repoussa les pensées amères.
— Puisqu’elle t’attend, que fais-tu ici, à musarder ? dit-il avec un haussement d’épaules. À ta place je serais déjà sous les murs de son palais.
Julien ne se le fit pas dire deux fois et, après un salut affectueux, s’en alla en chantonnant. Laurent demeura seul, écoutant décroître le bruit pressé de ses pas.
D’un geste las, il reprit le luth un instant abandonné, caressa les cordes qui gémirent… Machinalement, les paroles d’une chanson qu’il avait composée lui montèrent aux lèvres.
« Il tempo fuggi e vola
Mia giovinezza passa… »
Jamais les échos de son palais ne lui avaient paru si vides, jamais sa puissance n’avait été si vaine, puisque ce n’était pas lui qu’aimait Simonetta.
Bientôt, le secret des jeunes amants fut celui de Polichinelle. Florence sut le nom de celui qu’aimait l’Étoile de Gênes mais cela ne détruisit pas le charme dont elle était captive. Le jeune couple devint pour tous le symbole même de la jeunesse et de l’amour. L’insignifiant époux n’eut que le droit de s’effacer et de retourner compter ses ducats. D’ailleurs, quelle pouvait être l’importance de l’époux d’un symbole ? Simonetta était devenue pour tous l’âme et la quintessence même de Florence qui, avec orgueil, se reconnaissait en elle.
Durant sept belles années, Simonetta Vespucci présida en reine incontestée à toutes les fêtes que donnaient les Médicis, aussi bien dans leur palais de la Via Larga que dans leurs somptueuses villas des collines, à Careggi ou à Fiesole. Sa gaieté, sa grâce répandaient autour d’elle une atmosphère aimable et douce.
Laurent, toujours secrètement épris mais attaché aux affaires de la ville, trouvait dans le travail un dérivatif à l’amour sans espoir. Julien, heureux, se laissait griser par son bonheur sans imaginer un seul instant que certains parmi ceux qu’il approchait journellement pouvaient nourrir au fond de leur cœur une envie amère. Ainsi de Francesco dei Pazzi, le fils d’un des plus riches banquiers de la ville.
II
La fin d’une déesse…
Le grand triomphe de Simonetta Vespucci eut lieu le 28 janvier 1475 quand, pour son anniversaire, les Médicis ordonnèrent un grand tournoi, plus fastueux que tout ce que l’on avait pu voir jusqu’à présent. Elle devait en être la reine, l’inspiratrice et la lumière et Florence, ce jour-là, eut pour elle les yeux mêmes de Julien qui, vainqueur désigné du tournoi, y participa vêtu d’une armure d’or et portant une bannière sur laquelle Botticelli avait peint Simonetta en Pallas, avec comme devise : « La Sans Pareille ».
Naturellement, le jeune homme défit tous ses adversaires. La plupart étaient des amis qui se « laissèrent faire » aimablement. Un seul lui donna du fil à retordre : le jeune Pazzi, qui s’était juré de recevoir, en ses lieu et place, le laurier d’or et le baiser des mains et de la bouche de Simonetta… Furieux, Julien l’envoya mordre la poussière et s’en alla recevoir sa double récompense tandis que les valets des Pazzi emportaient Francesco, inconscient et contusionné… sous les vivats de la foule.
Ils l’emportèrent ainsi jusqu’au palais familial où, en guise de baume et de vulnéraire, le vieux Jacopo, son père, lui délivra une verte mercuriale.
— Qu’avais-tu besoin de te rendre ridicule aux yeux de tous alors même que les Médicis rêvent notre ruine ? Je t’avais interdit de figurer à ce tournoi ridicule où Julien étale son adultère aux yeux de tous !
— Je voulais que ce soit lui qui morde la poussière. J’en étais capable, car je sais combattre aussi bien que lui… mais tout était convenu d’avance.
— Si tu veux prendre une revanche sur ces frères maudits ce n’est pas dans un tournoi qu’il faut la chercher, ce n’est pas au milieu de leurs flatteurs et de leurs amis, c’est auprès de ceux qui les haïssent, qui complotent contre eux. Ce n’est pas sur la place Santa Croce qu’il faut aller, c’est à Prato, c’est à Volterra… c’est à Rome, où le pape Sixte IV voit d’un mauvais œil grandir leur puissance et se consommer notre esclavage.
En effet, Laurent, à mesure que coulait le temps, infléchissait lentement les institutions de la république de Florence vers une structure presque monarchique. Il était devenu l’âme, l’esprit et le bras de la ville, qu’il menât ses affaires commerciales ou conduisît une guerre avec toute l’impitoyable rigueur de son époque. Les cités satellites et rebelles de Volterra et de Prato, dont il avait réprimé les velléités d’indépendance avec une dureté proche de la cruauté, en gardaient le souvenir douloureux.
Le Conseil de la République était tout entier dans sa main car, peu à peu, il en avait évincé les membres des grandes familles comme les Guicciardini, les Ridolfi, les Nicolini et les Pazzi, pour les remplacer par des hommes de petite condition qui ne devaient qu’à lui seul leur élévation. Dans ces conditions, une colère sourde commençait à gronder dans les luxueux palais florentins, tandis que le peuple tout entier adorait à l’égal d’un dieu celui qui savait régner sur lui tout en lui laissant l’illusion du pouvoir.

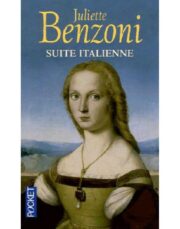
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.