Ensuite, elle fit tendre de velours et de satin noirs tous les murs de son château de la Motte-Feuilly qui avait vu son trop court bonheur, deuil fastueux convenant à une duchesse de Valentinois, une princesse royale, puis, voilant de crêpe son doux visage, s’enferma seule avec sa douleur, dans le château-tombeau, où elle mourut en 1514, après avoir confié sa fille à Louise de Savoie sa marraine, mère du roi François Ier… qui se chargea de son avenir.
Lucrèce pleura beaucoup puis se retira dans un couvent y prier pour le repos de l’âme de l’homme qui l’avait le plus fait souffrir au monde, et qu’elle avait aussi aimé de tout son cœur.
À présent, elle n’était plus Borgia et son charme lui avait conquis cette famille d’Este si hostile lors du mariage. Elle avait su se rendre agréable à son beau-père, plaire à son époux, se faire même une amie de la redoutable Isabelle, marquise de Mantoue. Elle moissonnait les cœurs, savait s’entourer d’artistes, d’érudits. Elle était Lucrèce d’Este, duchesse de Ferrare… une grande princesse de la Renaissance. Le taureau Borgia gisait foudroyé dans l’arène emplie de ses fureurs. Il n’en restait plus qu’un souvenir.
Médicis (FLORENCE)
I
Le plus beau printemps de Florence
Jamais Florence n’avait été si jeune, si fraîche et si fleurie ! En dépit de la saison encore neuve – on était le 7 février 1469 –, la ville ressemblait à un énorme bouquet, à une fresque chatoyante grâce aux tapisseries, aux soies précieuses piquées de toutes les fleurs que l’on avait pu trouver, coulant de toutes les fenêtres comme autant de fontaines pétrifiées. Mais une fresque animée par une foule en vêtements de fête, qui mettait l’arc-en-ciel jusque dans les ruisseaux encore boueux de la dernière pluie. À travers l’air bleu, les cloches de tous les campaniles sonnaient à rompre les bras des sonneurs et, dans chaque carrefour, des musiciens ambulants, des chanteurs proclamaient à qui mieux mieux la joie de vivre, la joie d’être jeune, la joie d’aimer, qui était celle de l’honnête mais turbulente cité marchande.
C’est que Florence, ce jour-là, se voulait à l’image de ses maîtres du jour : Laurent et Julien de Médicis, âgés respectivement de vingt et de seize ans…
La fête dont chacun se promettait tant de plaisir était un grand tournoi, ordonné par Laurent déjà dit le Magnifique malgré son jeune âge. Et à le voir chevaucher vers la place Santa Croce où allait se dérouler la joute, le peuple émerveillé se disait que le surnom n’était pas usurpé.
Sur une tunique de velours rouge et blanc dont les manches montraient des crevés de soie, le jeune homme portait une écharpe brodée de roses en perles fines, mais si adroitement disposées que certaines paraissaient encore en boutons tandis que d’autres atteignaient le plein épanouissement, où, au milieu, apparaissait, brodée de fil d’or, la devise du prince, « Le Temps revient ». Sur sa toque noire, couverte de perles, Laurent portait une aigrette de diamants et de rubis au bout de laquelle tremblait une énorme perle et, sur le bouclier d’or pendu à son bras, le plus gros diamant des collections familiales, le Libro, renvoyait au soleil ses rayons. Quant au cheval berbère, noir et plein de feu, qu’il montait, il caracolait sous un admirable caparaçon de velours blanc et rouge tout constellé de perles lui aussi… Et devant cette splendide image, Florence, qui se reconnaissait en elle, ne ménageait pas ses acclamations car elle s’était prise pour ce jeune homme impassible, d’une passion de femme.
Ce n’était pourtant pas à cause de sa beauté physique car, très grand, maigre, noir de cheveux et olivâtre de peau avec un long nez, une grande bouche sinueuse et des yeux noirs étincelants, Laurent était franchement laid, mais d’une laideur si puissante, si chargée d’intelligence, qu’elle dégageait un charme plus grand que la beauté dont rayonnait son jeune frère Julien, qui trottait à son côté.
Celui-là, sous les épaisses boucles noires qui encadraient son visage pur, avait une beauté de dieu grec et, tout vêtu d’argent et de perles, ressemblait à un rayon de lune. Or cette extraordinaire dissemblance des deux frères, unis au demeurant par une profonde tendresse, ajoutait encore à leur éclat et ils aimaient jouer de ce contraste en se montrant continuellement ensemble.
Julien, visiblement, rayonnait de joie mais, en dépit de son apparence magnifique et souriante, ceux qui connaissaient bien Laurent, comme le poète Ange Politien, son meilleur ami, avaient l’impression qu’il ne jouissait pas pleinement de cette fête dont il était cependant le principal héros. N’était-il pas au sommet de la gloire ? Il avait humilié Venise et le pape, conquis Sarzana, vaincu la faction rivale des Pitti. II allait prochainement épouser une princesse romaine, Clarissa Orsini… et pourtant, par instants, le sourire s’effaçait, le regard s’assombrissait, et Laurent semblait se laisser reprendre par quelque pensée mélancolique et secrète…
Le nuage finit par revenir si souvent que Julien s’en inquiéta :
— Qu’as-tu, mon frère ? Es-tu souffrant ?
— Mais non. Quelle idée !
— Alors… Est-ce que tu n’es pas heureux ? Il fait si beau et tous ces braves gens qui t’acclament t’adorent.
— Ils m’adorent, oui… mais moi, je dois dire adieu à l’amour. Comment pourrais-je être heureux ?
Julien se mordit les lèvres en se traitant mentalement de sot. Qu’avait-il besoin de soulever ce lièvre du bonheur ? Ne savait-il pas qu’en se mariant, Laurent allait devoir rompre avec une maîtresse bien-aimée : Lucrezia Donati, la beauté de Florence.
Et comme on arrivait justement sur la place Santa Croce, le regard du jeune frère chercha instinctivement, dans les tribunes préparées pour les nobles invités de la joute, la place privilégiée où devait se tenir Lucrezia, craignant que le chagrin l’eût retenue chez elle.
Mais elle était bien là, assise sur le trône de la reine du tournoi, qu’elle occupait pour la dernière fois. Brune, mince, ravissante, et si triste dans sa robe de brocart d’argent brodée de fines fleurs multicolores, des perles se mêlaient à ses tresses noires et d’autres, liquides celles-là, emplissaient ses grands yeux sombres. Tout à l’heure, elle remettrait au vainqueur la couronne du triomphe… et puis elle s’en irait, elle quitterait Florence pour longtemps, pour toujours peut-être, et regagnerait les terres d’un époux qu’elle n’aimait pas afin que sa présence, sa trop belle image ne vinssent ternir l’arrivée de la fiancée romaine.
Et Lucrezia offrait un spectacle si émouvant que Julien se prit à soupirer. C’était vraiment affreusement triste, un amour en train de mourir…
Pour ne pas se laisser emporter lui aussi par l’émotion, il regarda distraitement l’assistance. Mais brusquement, son regard s’immobilisa, s’agrandit et Julien, tout à coup, se frotta les yeux comme un enfant ébloui.
C’est que, non loin de Lucrezia, il venait de découvrir tout à coup une créature de rêve, une créature comme il ne croyait pas qu’il pût en exister sur la terre.
C’était une très jeune femme… une jeune fille plutôt, et si blonde, si claire, si belle qu’elle en était lumineuse. L’or de ses lourdes tresses luttait d’éclat avec ses yeux immenses, noirs et veloutés. Son corps mince, souple et long, avait une grâce inimitable et son visage délicat, au petit nez légèrement retroussé, aux lèvres tendres, était un poème d’harmonie et de charme spirituel. Une robe d’un blanc éblouissant, tissée d’argent et d’or, l’habillait et elle appelait si bien l’attention de ses voisins qu’autour d’elle, personne ne prenait garde à ce qui se passait dans l’arène. Tout le monde observait la merveilleuse inconnue, auprès de laquelle se tenait un jeune homme à l’air bougon auquel d’ailleurs personne ne prenait garde.
Julien posa soudain sa main sur le bras de son frère.
— Regarde là-bas, souffla-t-il.
Le Magnifique suivit la direction indiquée et son regard mélancolique s’arrêta lui aussi sur la blonde apparition.
— Par la Madone ! Qui est-ce ? La connais-tu ? Moi, je ne l’ai jamais vue.
— Moi non plus. Elle ne doit pas être florentine…
Soudain, Laurent eut une exclamation de surprise car il venait de remarquer le jeune garçon maussade qui se tenait auprès de la jeune fille.
— Elle n’est pas d’ici, en effet. Ne vois-tu pas celui qui est assis auprès d’elle ? C’est Marco Vespucci. Ta beauté doit être la jeune fille qu’il est allé épouser à Gênes et qu’il nous ramène.
— Mariée ? s’exclama Julien, déjà désolé. Tu crois ? Elle paraît si jeune.
— J’en suis presque certain.
Laurent ne se trompait pas. L’apparition était bien la jeune épouse de Marco Vespucci. Elle avait seize ans. Elle se nommait Simonetta dei Cattanei et elle était née à Porto Venere, près de Gênes, d’une famille d’armateurs riches et puissants. Quant à son jeune époux, qui n’avait lui aussi que seize ans, il appartenait à l’une des plus grandes familles de Florence. C’était un garçon renfermé, n’aimant que l’or et l’étude, et qui faisait sa société préférée d’un sien cousin, Amerigo Vespucci, qui, plus tard, baptiserait le continent découvert par un autre. Et l’on regrette de constater que Marco était plus sensible aux navires des Cattanei qu’à la beauté de Simonetta.
Mais il était bien le seul dans son cas. La première apparition publique de sa jeune femme bouleversait visiblement les Florentins, si naturellement épris de beauté que plus d’un spectateur ne vit pas grand-chose du tournoi.
Il se déroulait d’ailleurs selon les prévisions des organisateurs : Laurent vainquit tous ses adversaires, ce qui permit à Julien, plus que distrait, de se désintéresser complètement de la joute, sans le moindre souci de l’honneur familial.

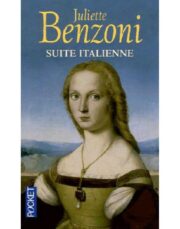
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.