La garde apparut enfin. Les pèlerins avaient mené un tel tapage qu’il était impossible de les ignorer plus longtemps sans risquer l’émeute. Les flammes des torches balayèrent la place obscure. On emporta le blessé et, quelques instants plus tard, Lucrèce recevait, dans le salon où elle s’était attardée à bavarder avec Sancia, le corps sanglant de son époux.
Elle se jeta sur lui avec un affreux cri de douleur :
— -Alfonso mio… Mon Dieu… Ils me l’ont tué.
— Il respire encore, Madame, dit le capitaine des gardes. Il n’est peut-être pas trop tard…
— Qu’on l’emporte dans ma chambre, ordonna le pape qui accourait au bruit. Que l’on appelle mon médecin. Allons… vite… faites vite !
Il était aussi épouvanté que sa fille, davantage peut-être, car cette scène lui en rappelait une autre, aussi douloureuse, qu’il avait subie au lugubre matin où lui avait été rapporté le corps sans vie de Juan, son aîné bien-aimé. Et ce fut avec une horreur désespérée qu’il entendit le moribond murmurer entre deux sanglots de sa femme :
— César… c’était lui… je l’ai reconnu…
On l’emporta avec mille soins tandis que les tapis précieux buvaient le sang dégouttant encore de ses blessures.
Quand, à l’aube, Rome apprit la nouvelle, la personnalité de l’assassin ne fit de doute pour personne… mais personne n’osa le dire. Le blessé avait été transporté dans l’une des chambres récemment achevées des appartements Borgia. Lucrèce, brûlante de fièvre mais pâle et résolue, le veillait nuit et jour, relayée uniquement par Sancia, la seule en qui elle eût confiance.
Les deux femmes dormaient sur des lits improvisés, dans la chambre même du blessé. Elles le soignaient et préparaient elles-mêmes sa nourriture sur un petit réchaud par crainte du poison.
Pourtant, elles avaient peur. Une peur atroce, mêlée de chagrin et d’horreur.
— César n’aime pas manquer son coup, disait Sancia. Il cherchera à recommencer.
— Alors il faudra qu’il me passe sur le corps car je défendrai mon époux ! affirmait Lucrèce, farouche. Mais je ne crois pas qu’il oserait l’arracher de mes bras.
Elle ignorait encore les paroles, ironiques et menaçantes tout à la fois, articulées par César en apprenant que sa victime vivait encore.
« Ce qui ne s’est pas fait à midi peut se faire le soir… »
Pourtant, il ne bougeait pas. Les jours passaient. Alphonse, lentement, très lentement, reprenait des forces. La jeunesse peut accomplir des miracles, et il fut bientôt évident pour son entourage qu’il allait guérir.
Oubliant peu à peu ses craintes, Lucrèce en venait à penser que César, peut-être pris de remords devant la douleur de sa sœur, en était venu à de meilleurs sentiments, qu’il avait renoncé… Mais vint le soir du 18 août…
Alphonse reposait sur son lit, entouré de Sancia, qui jouait de la guitare, et de Lucrèce qui, tout contre lui, chantait à mi-voix. Il avait fait très chaud toute la journée et un orage s’annonçait vers les monts Albains, où de grands éclairs blancs et silencieux rayaient la nuit.
Tout à coup, la porte de la chambre s’ouvrit, livrant passage à deux sombres silhouettes qui s’arrêtèrent un instant sur le seuil, contemplant le tableau intime.
Avec un cri d’angoisse, Sancia se levait, lâchait sa guitare. Malgré la demi-obscurité, elle avait parfaitement reconnu César et Micheletto. À son tour, Lucrèce glissait du lit.
— Que voulez-vous ? demanda-t-elle durement, s’efforçant de maîtriser la terreur que lui causait le sourire cruel de son frère.
— Sortez ! ordonna Borgia sans élever la voix.
— Il n’en est pas question ! Tu ne me feras pas sortir de cette chambre. J’y suis chez moi !
— Oh, mais si, ma chère sœur, tu sortiras ! Et toi aussi, Sancia ! Tu as entendu, Micheletto ? Ces dames doivent sortir… Je vais t’aider.
Malgré leurs cris et leur défense désespérée, les deux jeunes femmes, d’ailleurs fatiguées par leur longue claustration, furent empoignées et jetées hors de la pièce dont César referma la porte.
— Au secours ! hurlait Lucrèce, désespérée. Il veut le tuer… Il veut tuer mon époux…
Plus forte, Sancia récupérait déjà.
— Courons chez le Saint-Père ! s’écria-t-elle. Vite ! Lui seul peut le sauver.
Rassemblant leurs jupes, elles partirent en courant, revinrent très peu de temps après, escortées d’hommes d’armes et de dignitaires du Vatican précédant le pape lui-même.
Mais quand on pénétra dans la chambre, dont la porte était demeurée entrouverte, il n’y avait plus personne. La somptueuse pièce qui portait le nom de chambre des Sibylles était vide… à l’exception du cadavre d’Alphonse qui gisait en travers du lit, défiguré par l’agonie.
Miguel Corella venait de l’étrangler au moyen d’une cordelette…
Alors, Lucrèce eut un soupir et glissa, sans connaissance, sur les dalles de marbre noir, au pied même de la robe blanche d’Alexandre VI.
VIII
« Aut Caesar, aut nihil{6}… »
Le 18 août, à la nuit close, le corps d’Alphonse d’Aragon, duc de Bisceglia, était porté en terre presque secrètement : vingt serviteurs armés de torches dont les flammes éclairaient sinistrement l’obscurité, une poignée de religieux entourant François Borgia, archevêque de Cosenza. Rien d’autre : ni sœur ni épouse, car Sancia comme Lucrèce avaient été enfermées par ordre de César dans leurs appartements où elles avaient tout loisir de pleurer en écoutant tinter le glas de la petite église Santa Maria delle Febbri{7}, où Alphonse allait dormir son dernier sommeil.
La douleur de Lucrèce semblait inapaisable et le pape, atterré, regardait avec angoisse cette créature inconnue, cette veuve farouche dont le visage pâle, lavé par les larmes, se montrait nu et tragique sous des voiles noirs qu’aucun bijou ne venait adoucir.
Ce fut cette femme-là que rencontra César quand, deux jours après le meurtre, il osa venir jusqu’à la chambre de Lucrèce sous la protection de cent estafiers, car la version officielle du crime voulait que le Valentinois n’eût fait que se défendre d’un complot dirigé contre sa vie. Statue de la douleur muette, celle que l’on appellerait un temps « la tragique duchesse de Bisceglia » n’offrit à son frère ni une parole, ni même un regard, et César repartit avec ses soldats sans avoir pu attirer, ne fût-ce qu’une seconde, son attention.
Furieux, il alla en rendre compte à son père, mais Alexandre VI n’avait pas la conscience assez en repos pour intervenir. Lucrèce avait eu pour lui un regard si glacial, si indifférent, lorsqu’il avait tenté de lui offrir des consolations, à vrai dire assez dérisoires, qu’il se sentait à présent mal à l’aise vis-à-vis d’elle. C’était tout juste s’il reconnaissait sa fille chérie.
Bientôt, d’ailleurs, cette attitude hostile et désespérée indisposa le pontife. Lucrèce était un vivant reproche et il n’aimait pas les reproches.
« Jadis, écrivit alors l’ambassadeur de Venise, Madame Lucrèce, qui est sage et aimable, avait les bonnes grâces du pape, mais à présent il n’aime plus autant sa fille… » Et c’était vrai : au bout de quelques jours, Alexandre ne pouvait plus endurer sa présence. Il lui accorda la « permission » de se retirer dans celle de ses terres qui lui conviendrait.
Avec une sorte de soulagement, la jeune femme saisit la balle au bond et le 30 août, escortée de trois cents cavaliers, elle quittait Rome pour sa forteresse de Nepi, en pays étrusque.
Elle était satisfaite de partir, de n’être plus obligée de voir son père, son frère, ou même Rome, qui lui faisaient horreur. Seule, la vue du petit Rodrigue, son fils, qu’elle emmenait, réussissait à l’apaiser un peu. Elle haïssait César pour tout le mal qu’il lui avait fait, elle détestait son père pour n’avoir pas su protéger Alphonse. Il était déjà bien suffisant d’avoir à se supporter elle-même, car elle s’en voulait de sa faiblesse, de sa lâcheté de femme incapable de trouver dans sa douleur assez de force pour venger son amour, pour frapper à son tour. Elle avait choisi la fuite… et avec quel empressement !
Elle aimait Nepi, où elle avait été heureuse au bruit chantant du ruisseau de la vallée et dans les hautes pièces claires décorées de fleurs peintes à fresque. Elle y retrouvait le souvenir des heures douces vécues naguère avec son bien-aimé Alphonse et pouvait y oublier les nuits sanglantes de Rome, le vacarme étouffé des banquets et des chansons bachiques. Là, elle avait le droit d’être seulement une veuve douloureuse.
À Rome, pendant ce temps, César se préparait à dévorer l’artichaut Italie feuille à feuille. La Ville éternelle résonnait du fracas des armes et des rumeurs de guerre car, seul maître à présent de l’esprit du pontife, César allait enfin régner.
Il attirait à lui les meilleurs capitaines des meilleures maisons : Orsini et Savelli, de Rome, Baglioni, de Pérouse, Vitelli, de Cita di Castello, tous accouraient pour avoir part au butin, qui promettait d’être abondant. Certaines villes même, comme Cesena, faisaient leur soumission avant même d’avoir été attaquées.
Tout ce monde se mit en branle. On arracha Pesaro à Jean Sforza, le premier mari de Lucrèce, Faenza au jeune et charmant Astorre Manfredi, qui allait connaître une mort cruelle dans les caves du château Saint-Ange.
Chaque jour voyait l’armée de César plus forte, sa puissance plus insolente. Oubliant Charlotte, son épouse demeurée en France, il vivait ouvertement avec une belle Milanaise, Bianca Lucia Stanga, qui le suivait depuis la conquête de sa ville par les Français, mais cela ne l’empêchait pas d’enlever au passage les femmes qui avaient le malheur de lui plaire : ainsi d’une fille d’honneur de la duchesse d’Urbino, la belle Dorotea, fiancée au capitaine vénitien Gian-Battista Carracciolo. Alors qu’elle rejoignait son fiancé pour de joyeuses noces, la jeune fille avait été enlevée par ordre de César, jetée dans son lit afin d’y subir sa loi…

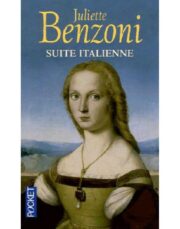
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.