Le 14 octobre, ils regagnèrent donc leur palais de Santa Maria in Portico où, le 1er novembre, un beau petit garçon venait au monde dans l’allégresse générale.
Le 11 novembre, dans la chapelle Sixtine, le cardinal Carafa baptisa le petit prince, qui reçut le prénom de Rodrigue, comme son grand-père, et en cadeau de bienvenue, le duché de Sermoneta.
Ce fut une superbe cérémonie, comme le pape les aimait, et Lucrèce, radieuse encore qu’un peu pâle, murmura en serrant à la dérobée la main de son époux :
— Où peut-on être mieux qu’entourés des siens ? Je crois qu’à présent, rien ni personne ne viendra nous empêcher d’être heureux.
Pauvre Lucrèce… Une semaine plus tard, César Borgia était de retour à Rome.
VII
La main de César
Le très évident et un peu insolent bonheur étalé par Lucrèce et son jeune mari Alphonse ne pouvait que porter ombrage à César quand, auréolé de son nouveau titre, de sa nouvelle puissance et de l’éclat de son mariage français, il regagna Rome. Le sombre duc de Valentinois n’aimait pas que sa sœur fût heureuse par un étranger, et surtout un Napolitain.
À l’exception de Sancia, il avait toujours haï les gens de Naples – encore Sancia s’en était-elle tirée à cause du désir violent qu’elle lui avait inspiré. Mais en France, cette haine était devenue quasi maniaque depuis que la demi-sœur d’Alphonse, Charlotte d’Aragon, avait refusé dédaigneusement de l’épouser, lui, César, en criant bien haut qu’elle ne voulait pas devenir « la Cardinale ».
Certes, il n’avait pas regretté, bien au contraire, que ce refus lui eût permis d’épouser Charlotte d’Albret, mais les blessures d’amour-propre étaient de celles que César pardonnait le moins.
Retrouver Lucrèce aussi tendrement unie à l’époux qu’il l’avait forcée d’accepter, c’était plus qu’il n’en pouvait supporter. Et il sut tout de suite qu’Alphonse ne resterait pas longtemps l’époux de sa sœur.
Pourtant, Rome lui avait réservé un triomphe digne d’un imperator romain. Louis XII, ayant conquis Milan, avait tenu sa promesse et confié à César des troupes pour conquérir la Romagne. Il en avait fait bon usage ; Faenza, Imola, Forli, qu’avait défendue jusqu’au bout la belle Catherine Sforza, l’ancienne amie du cardinal Rodrigue Borgia, toutes ces villes étaient tombées. Devenu par sa propre grâce « duc de Romagne », le conquérant Borgia avait empli Rome des rumeurs de sa guerre quand il y était entré le 26 février 1500. Et en quel appareil !
Deux hérauts ouvraient le cortège, l’un aux couleurs de France, l’autre à celles des Borgia. Puis cent estafiers, portant sur la poitrine le nom de César brodé en grandes lettres d’argent, précédaient la cavalerie commandée par le condottiere Vitellozzo Vitelli. César venait ensuite, habillé de velours noir des pieds à la tête, avec au cou le collier de l’ordre de Saint-Michel. Son frère et le mari de Lucrèce le suivaient immédiatement au rang d’aides de camp. Ensuite, c’étaient cent valets de pied vêtus de noir, des pages, des serviteurs, des soldats encore : gigantesques Suisses bariolés et Gascons arrogants, maigres et dangereux comme des chats sauvages. Et puis encore, des gardes entourant une prisonnière altière : Catherine Sforza elle-même, droite et méprisante, le regard à la hauteur des nuages. Enfin, des coffres, des bagages, tout un train immense et interminable déroulant ses anneaux comme un serpent à travers la ville.
Rome accueillit le revenant avec un enthousiasme de commande. Jamais la vieille méfiance italienne contre l’Espagnol n’avait été aussi forte. Et puis, l’absence de César n’avait pas duré assez longtemps pour que l’on eût oublié ses violences, ses fureurs, ses haines et ses vengeances. On applaudissait, on souriait, on acclamait, et les fleurs tombaient sous les pas de son coursier noir, mais à la dérobée, on se montrait Miguel Corella, dit Micheletto, son âme damnée, son homme de main, le maître incontesté du couteau et de la corde, plus dangereux qu’une portée de cobras. Et l’on s’interrogeait : César allait-il demeurer longtemps ou bien retournerait-il à Milan, où l’attendait Louis XII ? Descendrait-il sur Naples, dont on disait qu’il méditait la conquête ? Tournerait-il ses armes vers Camerino, vers Urbino… vers Florence peut-être ?
En fait, où que César allât, quel que fût l’horizon qui attirerait sa convoitise, ce serait de toute façon une excellente chose car, aux yeux des Romains, tout valait mieux que le garder dans la ville.
Pourtant, il resta. L’année 1500 était une année sainte, une année jubilaire, et les pèlerins qui depuis le 1er janvier affluaient de toutes parts constituaient une manne providentielle pour qui a les caisses vides. César était trop avisé pour laisser passer une telle occasion de puiser à pleines mains dans le trésor pontifical, empli à ras bord par les aumônes, les dons, les ventes d’indulgences et tout le trafic éhonté d’une Église qui avait perdu l’Esprit pour n’en garder qu’une apparence.
Jamais on n’avait vu année sainte comparable à celle-là.
« Nous autres Rhénans, écrit alors un pèlerin venu des bords du Rhin, sommes bons chrétiens, et quand on a vu la vie que mènent à Rome les prélats et les grands personnages, on peut redouter non seulement de perdre la foi mais de devenir turc et de douter de l’immortalité de l’âme… » Et en effet, les fêtes qui se déroulent au Vatican pour le retour de César n’ont rien à voir avec les réjouissances de patronage voire les pompes liturgiques : ce sont des orgies au cours desquelles le pape, certains de ses cardinaux, ses familiers et ses enfants, servis par des femmes nues, s’adonnent à des jeux de société d’un genre tout à fait particulier.
À toutes ces festivités Lucrèce assistait avec Alphonse comme à un spectacle amusant, puis regagnait son palais, au bras de son époux, pour y retrouver la paix de leur chambre à coucher sans s’apercevoir du regard venimeux dont César enveloppait leur couple d’amoureux.
Au lendemain de ces festins, le Tibre, boueux et sinistre, crachait des corps sans vie : des prêtres, des soldats, des filles de joie qui avaient eu le malheur de déplaire à César, car c’était le sort réservé au menu fretin. Pour ceux qui méritaient une haine plus subtile, la scène se jouait sous les baldaquins de chambres princières où agonisait tel ou tel cardinal, tel ou tel seigneur qui venait d’être honoré d’une invitation à souper au Vatican.
Et Lucrèce vivait dans cette ambiance sans même s’en soucier. Ces morts qu’on lui apprenait au matin n’étaient pas plus pour elle que les faits divers de nos journaux. Elle était heureuse, sûre d’elle, sûre aussi de la protection de son père, qui semblait conquis par le charme d’Alphonse et qui étendait sur eux deux son ombre paternelle.
Et puis, César était presque aimable. N’avait-il pas autre chose à faire que s’occuper d’un jeune couple innocent ?
C’est alors que deux événements vinrent mettre en branle l’impitoyable machine à tuer que le roi de France avait parée d’une couronne ducale.
D’abord, Milan, après une tentative de-reprise des Sforza, fut définitivement vaincue. Ludovic le More, prisonnier, était envoyé dans les prisons du roi Louis et ce dernier annonçait déjà son prochain départ pour la conquête de Naples.
Ensuite, le pape Alexandre fut victime d’un grave accident qui le mit à deux doigts de la mort : une cheminée s’effondra au-dessus de son trône pontifical, tua plusieurs personnes dont trois marchands florentins qui venaient réclamer à César une créance, et envoya dans son lit Sa Sainteté, très commotionnée : sans le baldaquin du trône, il fallait réunir le conclave.
Lucrèce, en fille aimante, vint s’installer au chevet de son père pour le soigner, abandonnant Alphonse au palais de Santa Maria in Portico. Alors, César, qui ne savait encore si un nouveau pape n’allait pas le chasser de Rome et avait demandé des renforts à Milan, décida de passer à l’action : il avait momentanément les mains libres.
Au soir du 15 juillet, Alphonse de Bisceglia vint dîner au Vatican. Dîner familial, sans plus. Seuls y assistaient le pape, Lucrèce, Joffré et Sancia, revenue depuis peu auprès de son époux… et du lit de César.
La soirée était belle et chaude, mais avec les ombres de la nuit, venait une fraîcheur qui invitait au repos.
Fatigué par une journée de chasse, Alphonse prit congé de sa famille, embrassa tendrement Lucrèce qui demeurait encore chez son père, puis, accompagné de deux écuyers, se mit d’un pas nonchalant en route vers son logis.
Les trois hommes sortirent par la porte située sous la loggia des Bénédictions et s’avancèrent sur la place Saint-Pierre sans accorder d’attention aux nombreux mendiants, pèlerins et badauds qui, comme chaque soir, l’encombraient, certains s’installant même sur les marches de la basilique pour dormir plus saintement.
Or, à peine le prince et ses serviteurs avaient-ils fait quelques pas qu’un cri jaillit :
— Tue ! Tue !…
Une troupe de dormeurs s’éveilla et bondit, l’épée haute. En un clin d’œil les trois hommes furent entourés.
— Qui voulez-vous tuer ? demanda Alphonse, méprisant. Si c’est moi, je vous préviens que vous aurez du mal.
Dégainant rapidement, il tomba en garde et engagea le fer avec vigueur, courageusement secondé par ses écuyers. Mais la partie était inégale. Au bout de quelques instants, alors que les vrais pèlerins, épouvantés, appelaient à l’aide une garde qui semblait curieusement sourde, Alphonse tomba percé de plusieurs coups.
Ce que voyant, l’un des écuyers, abandonnant son adversaire, se précipita pour tirer son corps à l’abri d’une colonne tandis que le second, qui se nommait Albanese, ferraillait désespérément contre la meute pour couvrir leur retraite.

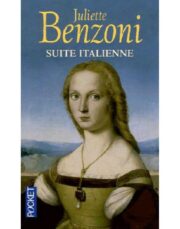
"Suite italienne" отзывы
Отзывы читателей о книге "Suite italienne". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Suite italienne" друзьям в соцсетях.