Rencogné en face du palais, dans l’ombre d’une porte cochère, Aldo dut faire violence à son tempérament latin pour ne pas aller tirer la cloche d’une demeure devenue mystérieuse. C’eût été un geste stupide : si le personnage de tout à l’heure venait lui ouvrir il passerait pour un fou, un malotru ou un espion. Et puis aucune lumière ne brillait derrière les hautes fenêtres d’une maison tellement muette qu’il finit par se demander s’il n’avait pas rêvé. Il n’avait plus rien à faire ici et mieux valait repartir. D’ailleurs, sa montre lui apprit qu’il lui restait tout juste le temps de rentrer à l’hôtel, de se mettre en tenue de soirée et d’avaler quelque chose avant de se rendre à l’Opéra. Les mains au fond des poches, il repartit sous la pluie...
Deux heures plus tard, sanglé dans un habit coupé à Londres qui rendait pleine justice à son corps athlétique, le prince Morosini gravissait de son pas nonchalant le magnifique escalier de marbre du Staatsoper, considéré en Autriche comme la pièce maîtresse de la culture nationale. La splendeur de ce monument, ordonnée jadis par François-Joseph, demeurait intacte. Les marbres italiens et les ors des candélabres brillaient sous la lumière opaline des globes de verre. Tout semblait comme autrefois... Les femmes en longues robes portaient des fourrures de prix et d’admirables bijoux... même si tous n’étaient pas absolument vrais. Beaucoup étaient jolies, avec ce charme si particulier des Viennoises, et beaucoup aussi laissaient glisser un regard souriant sur la silhouette du visiteur étranger qui s’accorda le plaisir d’en dévisager quelques-unes.
L’atmosphère était à la fête, ce soir-là, pour entendre Le Chevalier à la rose, œuvre récente mais très admirée de Richard Strauss, inscrite depuis sa création, en 1911, au répertoire de l’Opéra dont le compositeur était aussi le directeur. Un célèbre chef d’orchestre allemand, Bruno Walter, devait diriger deux des plus grands chanteurs de l’époque : la cantatrice Lotte Lehmann dans le rôle de la Maréchale et le baryton Loritz Melchior dans celui du baron Ochs. Une véritable soirée de gala que présiderait le chancelier Seipel en personne.
Sous la main d’une ouvreuse vêtue de noir dont le chignon s’ornait d’un bouquet de rubans, Morosini vit s’ouvrir devant lui la porte d’une loge de premier rang. Un homme seul l’occupait qu’il ne reconnut pas au premier regard. Vêtu d’un habit noir irréprochable, il se tenait assis sur l’une des chaises de velours, le visage tourné vers la salle d’où montait l’habituel bruissement des conversations sur le vague fond musical de l’orchestre en train de s’accorder.
Aldo ne vit d’abord qu’une chevelure argentée portée assez longue dans le cou et rejetée en arrière, un profil perdu dont il ne distingua que la glace d’un monocle logé sous une arcade sourcilière. L’occupant de la loge ne se retourna pas et, comme l’habituelle canne à pommeau d’or semblait absente, Morosini se demanda s’il ne s’était pas trompé en espérant rencontrer son étrange client, mais ce ne fut qu’un instant :
– Entrez, mon cher prince ! fit la voix inimitable de Simon Aronov. C’est bien moi.
CHAPITRE 2 LE CHEVALIER À LA ROSE
Morosini serra la main que lui tendait son hôte et prit place sur la chaise voisine :
– Je ne vous aurais jamais reconnu, fit-il avec un sourire admiratif. C’est étonnant !
– N’est-ce pas ? Comment allez-vous, mon ami ?
– Si vous voulez parler de ma santé, elle est excellente, mais le moral est moins bon. En vérité, je m’ennuie et c’est la première fois que ça m’arrive...
– Vos affaires sont-elles moins prospères ?
– Non, tout va bien de ce côté-là. C’est vous, je crois, qui me manquiez. Et aussi Adalbert ! Depuis la fin du mois de janvier je n’ai plus aucune nouvelle de lui.
– C’était un peu difficile et surtout fort délicat, pour lui, de vous envoyer une lettre ou tout autre message : il était en prison au Caire.
Les yeux de Morosini s’arrondirent :
– En prison ? ... Une histoire de services secrets ?
– Oh non ! fit le Boiteux. Une histoire de chez Toutankhamon. Notre ami n’aurait pas résisté à l’attrait de certaine statuette votive d’or pur...
Aldo s’indigna. Il savait son ami habile de ses doigts et capable de pas mal de choses, mais pas d’un vol crapuleux.
– Rassurez-vous ! L’objet a été retrouvé et on a relâché Vidal-Pellicorne avec des excuses, mais il est resté enfermé un bout de temps. Vous le reverrez bientôt, je pense ! Vous venez d’arriver à Vienne ?
– Non. J’y suis depuis trois jours. Je voulais revoir certains lieux et aussi visiter le Trésor impérial. Ne m’aviez-vous pas dit que l’opale devait en faire partie ?
– Je me trompais. L’opale qui s’y trouve n’a rien à voir avec celle que nous cherchons.
– J’ai remarqué, en effet, mais j’ai aussi constaté qu’aucun des bijoux des deux derniers empereurs et de leur famille n’y était exposé. Je n’ai pas pu apprendre où ils étaient.
– Dispersés ! Vendus ! Les joyaux privés de la famille impériale ont été enlevés le 1er novembre 1918, juste avant le changement de régime, par le comte Berchtold qui les a transportés en Suisse. Beaucoup ont été vendus, et je ne serais pas étonné que certain banquier de vos amis en ait acquis un ou deux... J’ajoute que j’ai pu examiner la parure de noces de Sissi et qu’aucune des opales n’était celle que je recherche.
Le dialogue s’interrompit. Par-dessus la cloison de la loge voisine, une dame empanachée de « paradis » saluait Aronov en l’appelant « mon cher baron », entamait avec lui une conversation à bâtons rompus, et Aldo choisit de s’intéresser à la salle, pleine à présent... Elle offrait l’agréable coup d’œil d’une assemblée où les femmes vêtues de satin, de brocart, de velours aux couleurs contrastées arboraient diamants, perles, rubis, saphirs et émeraudes sur leur gorge découverte ou dans leur chevelure. Aldo put constater avec plaisir que l’horrible mode des cheveux courts et des nuques rasées n’avait pas encore atteint la haute société viennoise qui ne faisait sans doute pas son livre de chevet de La Garçonne, le livre scandaleux de Paul Margueritte dont la France se régalait depuis l’an passé. Il détestait cette mode-là !
Non qu’il fût rétrograde, mais il adorait les belles chevelures, parures naturelles où il est si doux de noyer ses doigts ou d’enfouir son visage ! C’était un crime de les massacrer ! En revanche, il n’avait rien contre les robes courtes, souvent charmantes et qui permettaient d’admirer de bien jolies jambes jusque-là interdites à d’autres regards que celui de F époux ou de l’amant.
Un tonnerre d’applaudissements salua le maestro qui eut juste le temps de dresser la salle sur l’hymne national à l’entrée de Mgr Seipel. Puis on se rassit ; les lumières s’éteignirent, ne laissant que la rampe éclairée. Un profond silence s’établit.
– Pourquoi m’avez-vous fait venir ici ce soir ? chuchota Morosini.
– Pour vous montrer quelqu’un qui n’est pas encore là. Chut !
Résigné, Aldo consacra son attention au spectacle. Le rideau se levait sur un ravissant décor de chambre féminine au temps de l’impératrice Marie-Thérèse et dans le palais de la Maréchale. Celle-ci, une très jolie femme, s’y livrait à un charmant badinage amoureux avec son jeune amant Octavian avant de recevoir, comme son rang l’y obligeait, les visites et les solliciteurs du petit lever. Parmi ceux-ci, le baron Ochs, personnage aussi important qu’importun, assez ridicule, venu prier la grande dame de lui trouver un chevalier chargé de porter la traditionnelle Rose d’argent, symbole d’une demande en mariage officielle, à la jeune fille qu’il souhaitait épouser. En dépit de sa répugnance, ce chevalier sera, bien sûr, le bel Octavian.
Aldo se laissait emporter par la grâce allègre et malicieuse d’une œuvre servie par des voix superbes quand la main de son voisin se posa sur sa manche :
– Regardez ! souffla-t-il. La loge en face de nous...
Deux personnes venaient d’y entrer, toutes deux vêtues de noir. D’abord un homme entre deux âges mais qui devait être d’une rare vigueur physique. Il portait une sorte de livrée de velours soutachée de soie à la mode hongroise.
Après un bref coup d’œil à la salle, il livra passage à sa compagne qu’il fit asseoir avec toutes les marques d’un profond respect avant de se retirer au fond de la loge. Plus remarquable encore était la femme qui fixa l’attention du prince. Son port était celui d’une altesse et, en la regardant, Morosini évoqua certain portrait de la duchesse d’Albe peint par Goya. Elle était à la fois vêtue et masquée de dentelles noires : une sorte de mantille retombant de sa haute coiffure un peu plus bas que la bouche. Ses longs gants étaient taillés dans le même tissu léger et sombre qui faisait ressortir l’éclatante blancheur d’une peau sans défaut. Aucun autre bijou qu’une broche scintillant d’un éclat magique dans les dentelles mousseuses au creux d’un magnifique décolleté. Un éventail était posé sur le rebord de velours rouge de la loge.
Sans un mot, sans même tourner la tête vers lui, Aronov glissa des jumelles de nacre dans la main de son invité qui faillit les laisser tomber tant il était saisi par l’apparition. Cependant, il réussit à retenir l’instrument qu’il plaça devant ses yeux, d’abord braqué sur la scène où la Maréchale déplorait la fuite du temps puis sur la loge. La femme inconnue s’y tenait un peu en retrait de façon à n’être pas trop éclairée par les feux de la rampe. Le masque de dentelles empêchait de distinguer les traits de son visage mais à la teinte ivoirine de sa peau, à sa finesse devinée, à la façon qu’elle avait de se tenir droite et la tête fièrement portée sur son long cou, il était évident qu’elle n’était pas vieille et qu’un noble sang coulait dans ses veines.

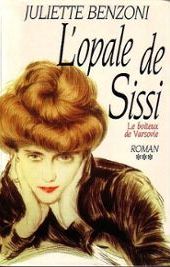
"L’Opale de Sissi" отзывы
Отзывы читателей о книге "L’Opale de Sissi". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "L’Opale de Sissi" друзьям в соцсетях.