Le voleur d’ombres
Robert Laffont
© Robert Laffont 2010.
978-2-221-11312-7
À Pauline, Louis et Georges
« Il est des gens qui n’embrassent que des ombres ; ceux-là n’ont que l’ombre du bonheur. »
William SHAKESPEARE
« L’amour, tu sais, ce dont il a le plus besoin, c’est l’imagination. Il faut que chacun invente l’autre avec toute son imagination, avec toutes ses forces et qu’il ne cède pas un pouce de terrain à la réalité ; alors là, lorsque deux imaginations se rencontrent... il n’y a rien de plus beau. »
Romain GARY
J’ai eu peur de la nuit, peur des formes qui s’invitaient dans les ombres du soir, qui dansaient dans les plis des rideaux, sur le papier peint d’une chambre à coucher. Elles se sont évanouies avec le temps. Mais il me suffit de me souvenir de mon enfance pour les voir réapparaître, terribles et menaçantes.
Un proverbe chinois dit qu’un homme courtois ne marche pas sur l’ombre de son voisin, je l’ignorais le jour où je suis arrivé dans cette nouvelle école. Mon enfance était là, dans cette cour de récréation. Je voulais la chasser, devenir adulte, elle me collait à la peau dans ce corps étroit et trop petit à mon goût.
« Tu verras, tout va bien se passer... »
Rentrée des classes. Adossé à un platane, je regardais les groupes se former. Je n’appartenais à aucun d’eux. Je n’avais droit à aucun sourire, aucune accolade, pas le moindre signe témoignant de la joie de se retrouver à la fin des vacances et personne à qui raconter les miennes. Ceux qui ont changé d’école ont dû connaître ces matinées de septembre où, gorge nouée, on ne sait que répondre à ses parents quand ils vous assurent que tout va bien se passer. Comme s’ils se souvenaient de quelque chose ! Les parents ont tout oublié, ce n’est pas de leur faute, ils ont juste vieilli.
Sous le préau, la cloche retentit et les élèves s’alignèrent en rangs devant les professeurs qui faisaient l’appel. Nous étions trois à porter des lunettes, ce n’était pas beaucoup.
J’appartenais au groupe 6C, et une fois encore, j’étais le plus petit. On avait eu le mauvais goût de me faire naître en décembre, mes parents se réjouissaient que j’aie toujours six mois d’avance, ça les flattait, moi je m’en désolais à chaque rentrée.
Être le plus petit de la classe, ça signifiait : nettoyer le tableau, ranger les craies, regrouper les tapis dans la salle de sport, aligner les ballons de basket sur l’étagère trop haute et, le pire du pire, devoir poser tout seul, assis en tailleur au premier rang sur la photo de classe ; il n’y a aucune limite à l’humiliation quand on est à l’école.
Tout cela aurait été sans conséquence s’il n’y avait pas eu, dans le groupe 6C, le dénommé Marquès, une terreur, mon parfait opposé.
Si j’avais quelques mois d’avance dans ma scolarité – au grand bonheur de mes parents –, Marquès avait deux ans de retard et ses parents à lui s’en fichaient totalement. Du moment que l’école occupait leur fils, qu’il déjeunait à la cantine et ne réapparaissait qu’à la fin de la journée, ils s’en satisfaisaient.
Je portais des lunettes, Marquès avait des yeux de lynx. Je mesurais dix centimètres de moins que les garçons de mon âge, Marquès dix de plus, ce qui créait une différence d’altitude notoire entre lui et moi ; je détestais le basket-ball, Marquès n’avait qu’à s’étirer pour placer le ballon dans le panier ; j’aimais la poésie, lui le sport, non que les deux soient incompatibles, mais tout de même ; j’aimais observer les sauterelles sur le tronc des arbres, Marquès adorait les capturer pour leur arracher les ailes.
Nous avions pourtant deux points en commun, un seul en fait : Élisabeth ! Nous étions amoureux d’elle, et Élisabeth n’avait d’yeux pour aucun de nous. Cela aurait pu créer une sorte de complicité entre Marquès et moi, ce fut hélas la rivalité qui prit le dessus.
Élisabeth n’était pas la plus jolie fille de l’école, mais elle était de loin celle qui avait le plus de charme. Elle avait une façon bien à elle de nouer ses cheveux, ses gestes étaient simples et gracieux et son sourire suffisait à éclairer les plus tristes journées d’automne, quand la pluie tombe sans cesse, quand vos chaussures détrempées font flic floc sur le macadam, ces journées où les réverbères éclairent la nuit sur le chemin de l’école, matin et soir.
Mon enfance était là, désolée, dans cette petite ville de province où j’attendais désespérément qu’Élisabeth daigne me regarder, où j’attendais désespérément de grandir.
Partie 1
1.
Il a suffi d’une journée pour que Marquès me prenne en grippe. Une petite journée pour que je commette l’irréparable.
Notre professeur d’anglais, Mme Schaeffer, nous avait expliqué que le prétérit simple correspondait d’une manière générale à un passé révolu n’ayant plus de relation avec le présent qui n’a pas duré et que l’on peut parfaitement situer dans le temps. La belle affaire !
Aussitôt dit, Mme Schaeffer me désigna du doigt, me demandant d’illustrer son propos par un exemple de mon choix. Lorsque je suggérai que ce serait drôlement chouette que l’année scolaire fût au prétérit, Élisabeth laissa échapper un franc éclat de rire. Ma blague n’ayant fait marrer que nous, j’en déduisis que le reste de la classe n’avait rien compris au sens du prétérit en anglais et Marquès en conclut que j’avais marqué des points avec Élisabeth. C’en était fait du reste de mon trimestre. À compter de ce lundi, premier jour de rentrée des classes, et plus précisément de mon cours d’anglais, j’allais vivre un véritable enfer.
J’héritai illico d’une colle de Mme Schaeffer, sentence applicable dès le samedi matin suivant. Trois heures à ramasser les feuilles dans la cour. Je déteste l’automne !
Le mardi et le mercredi, j’eus droit à une série de croche-pattes de la part de Marquès. Chaque fois que je m’étalais de tout mon long, le même Marquès récupérait son retard dans la course à celui qui faisait le plus rire les autres. Il prit même une certaine avance, mais Élisabeth ne trouvait pas cela drôle et son appétit de vengeance était loin d’être rassasié.
Le jeudi, Marquès passa à la vitesse supérieure, et moi, l’heure du cours de maths cloîtré dans mon casier, dont il avait cadenassé la porte après m’y avoir fait entrer de force. Je soufflai la combinaison au gardien qui balayait les vestiaires et avait fini par m’entendre tambouriner. Pour ne pas m’attirer plus d’ennuis en passant pour un cafteur, je jurai m’être bêtement enfermé tout seul en cherchant à me cacher. Le gardien, intrigué, me demanda comment j’avais pu verrouiller le cadenas depuis l’intérieur, je fis semblant de ne pas avoir entendu la question et filai à toutes jambes. J’avais manqué l’appel. Ma colle du samedi fut prolongée d’une heure par le professeur de mathématiques.
Le vendredi fut la pire journée de ma semaine. Marquès expérimenta sur moi les principes élémentaires de la loi de la gravitation de Newton apprise au cours de physique de 11
heures.
La loi de l’attraction universelle, découverte par Isaac Newton, explique en gros que deux corps ponctuels s’attirent avec une force proportionnelle à chacune de leurs masses, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cette force a pour direction la droite passant par le centre de gravité de ces deux corps.
Voilà pour l’énoncé qu’on peut lire dans le manuel. Dans la pratique, c’est une autre histoire. Prenez un individu qui subtiliserait une tomate à la cantine, avec une autre intention que de la manger ; attendez que sa victime se trouve à une distance raisonnable, qu’il applique une poussée sur ladite tomate avec toute la force contenue dans son avant-bras et vous verrez qu’avec Marquès la loi de Newton ne s’applique pas tel que prévu. J’en veux pour preuve que la direction empruntée par la tomate ne suivit pas du tout la droite passant par le centre de gravité de mon corps ; elle atterrit directement sur mes lunettes. Et au milieu des rires qui envahissaient le réfectoire, je reconnus celui d’Élisabeth, si franc et si joli, et ça me fila un sérieux cafard.
Ce vendredi soir, tandis que ma mère me répétait, sur un ton sous-entendant qu’elle avait toujours raison, « Tu vois que tout s’est bien passé », je déposai mon bulletin de colle sur la table de la cuisine, annonçai que je n’avais pas faim et montai me coucher.
*
* *
Le samedi matin en question, pendant que les copains prenaient leur petit déjeuner devant la télévision, moi je pris le chemin du collège.
La cour était déserte, le gardien replia mon bulletin de colle dûment signé et le rangea dans la poche de sa blouse grise. Il me remit une fourche, me demanda de prendre garde à ne pas me blesser, et désigna un tas de feuilles et une brouette au pied du panier de basket, dont le filet m’apparaissait tel l’oeil de Caïn, ou plutôt celui de Marquès.
Je me débattais avec mon tas de feuilles mortes depuis une bonne demi-heure, quand le gardien vint enfin à ma rescousse.
— Mais, je te reconnais, c’est toi qui t’étais enfermé dans ton casier, n’est-ce pas ? Se faire coller le premier samedi de la rentrée, c’est presque aussi fort que le coup du cadenas verrouillé depuis l’intérieur, me dit-il en m’ôtant la fourche des mains.
Il la planta d’un geste assuré dans le monticule et souleva plus de feuilles que je n’avais réussi à en récolter depuis que j’étais à la tâche.

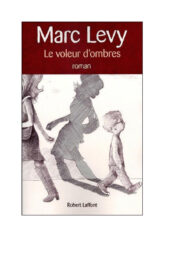
"Le voleur d’ombres" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le voleur d’ombres". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le voleur d’ombres" друзьям в соцсетях.