– Belle descente ! apprécia Adalbert. Mais un pur malt vingt ans d’âge mérite un autre traitement !
– Je vous promets de déguster le second ! fit l’homme avec un pâle sourire. Je vous jure que j’en avais besoin.
– Si je vous comprends, vous n’étiez pas au courant de ce qui allait se passer ?
– En aucune façon. Je ne savais même pas que les Solmanski devaient venir à la fête. Alors, le meurtre ! …
– Je vous ai connu moins sensible quand nous nous sommes rencontrés au Vésinet, remarqua Aldo.
– Je ne crois pas avoir tué qui que ce soit, cette nuit-là ? Sachez-le, je ne tue que pour me défendre et j’ai horreur de l’assassinat gratuit.
– Gratuit ? ricana Adalbert. Comme vous y allez. Un collier qui vaut peut-être deux ou trois millions… Car, bien sûr, ce sont vos amis qui l’ont subtilisé ?
– Trêve de mondanités ! coupa Aldo. Vous m’avez dit que vous saviez où ils sont ? Alors, vous buvez encore un verre et vous nous emmenez !
– Hé là ! Un instant ! À propos de collier, vous m’en aviez promis un. J’aimerais le voir !
– Il est dans le coffre de l’hôtel. A notre retour je vous le remettrai. Je vous le répète : vous avez ma parole !
Ulrich ne considéra qu’un instant le regard d’acier froid du prince-antiquaire :
– C’est OK ! Au retour. En attendant, si j’ai un conseil à vous donner, c’est de prendre des flingues…
– Soyez tranquille ! Nous savons à qui nous avons affaire ! dit Adalbert en sortant un imposant revolver de sa poche de pantalon.
À leur retour à l’hôtel, lui et Aldo avaient, en effet, troqué leurs habits de soirée pour des vêtements plus adaptés à une expédition nocturne.
– On y va ?
Entassés dans l’Amilcar de l’archéologue, les trois hommes se dirigèrent vers la rive méridionale du lac.
– C’est loin ? demanda Aldo.
– Environ quatre kilomètres. Si vous connaissez le coin, c’est entre Wollishofen et Kilchberg…
– Ce qui m’étonne, dit Aldo, c’est que vous, vous connaissiez si bien Zurich et ses environs.
– Ma famille est originaire de par ici. Ulrich, ce n’est pas un prénom américain… et mon nom c’est Friedberg.
– Vous m’en direz tant !
Trois heures sonnaient à l’église de Kilchberg quand la voiture atteignit l’entrée du village. Une odeur inattendue vint alors caresser les narines des voyageurs :
– Ça sent le chocolat ! fit Adalbert qui reniflait avec ardeur.
– La fabrique Lindt et Sprüngli est à une centaine de mètres, le renseigna Ulrich. Mais, tenez, voici la maison que vous cherchez, ajouta-t-il en désignant, au bord du lac, un beau vieux chalet dont la nuit, claire, permit d’admirer le colombage compliqué, encore enrichi par un décor peint.
Un joli jardin l’entourait. Adalbert, pour sa part, se contenta de jeter un coup d’œil et alla garer sa voiture, assez bruyante, un peu plus loin. On revint à pied et, un moment, on considéra la maison aux volets clos dans laquelle tout semblait dormir.
– C’est curieux ! remarqua Ulrich. Ils ne sont pourtant pas rentrés depuis bien longtemps et ce ne sont pas des couche-tôt ?
– De toute façon, fit Morosini, je ne suis pas venu ici pour contempler une vieille demeure. La meilleure façon de savoir ce qui s’y passe est d’y aller voir. L’un de vous saurait-il ouvrir cette porte ?
Pour toute réponse, Adalbert sortit de sa poche un trousseau comportant divers objets métalliques, gravit les deux marches du petit perron et s’accroupit devant le vantail. Sous l’œil admiratif d’Aldo, l’archéologue fit une brillante démonstration de ses talents cachés en ouvrant sans bruit et en quelques secondes une porte d’un abord plutôt rébarbatif.
– On peut y aller ! souffla-t-il.
Guidés par la torche électrique confiée à Ulrich, les trois hommes s’avancèrent le long d’un couloir dallé ouvrant d’un côté sur une vaste pièce meublée où, dans la grande cheminée de pierre, brûlaient encore quelques tisons. De l’autre côté du couloir c’était la cuisine, où flottaient des odeurs de choucroute, et, au fond du couloir, un bel escalier en bois sculpté montait vers les étages que la double pente du toit rétrécissait au fur et à mesure. L’arme au poing, les trois hommes explorèrent le rez-de-chaussée puis, avec d’infinies précautions, commencèrent à gravir l’escalier recouvert d’un chemin en tapis. Au premier ils trouvèrent quatre chambres, vides. Il en allait de même à celles du second étage, et toutes portaient la trace d’un départ précipité.
– Personne ! conclut Adalbert. Ils viennent de filer.
– C’est la meilleure preuve qu’ils ont le collier, grogna Morosini. Ils ont eu peur que la police les découvre.
– Il aurait pu se passer pas mal de temps avant qu’on les trouve, remarqua Ulrich. C’est grand, Zurich, et les environs encore plus.
– Il a raison, dit Aldo. Pourquoi cette fuite précipitée ? Et vers quelle destination ?
– Pourquoi pas chez toi ? Ta chère épouse tenait tellement à te faire arrêter ! Elle rapporte peut-être le collier, avec ou sans rubis, dans ta noble demeure où, quand tu seras revenu, elle pourrait s’arranger pour qu’il soit découvert par les flics ?
– Elle en est bien capable, fit Aldo songeur. Je ferais peut-être mieux de rentrer chez moi au plus vite ?
– N’oublie pas ce que nous a dit ce brave inspecteur : défense de quitter Zurich jusqu’à nouvel ordre !
À ce moment, Ulrich qui était allé inspecter la cuisine plus en détail les rejoignit :
– Venez voir ! J’ai entendu du bruit à la cave. Quelque chose comme une plainte… un râle. On y descend par une trappe…
Par prudence, on décida qu’Ulrich passerait le premier, puisqu’il connaissait la maison. On se précipita à la suite de l’Américain qui, arrivé en bas, tourna le bouton de l’éclairage. Ce qu’ils découvrirent les fit reculer d’horreur : un homme dont le corps n’était plus qu’une plaie marquée de traces de brûlures gisait à même le sol. Le visage tuméfié, saignant, était à peine reconnaissable, pourtant les deux amis n’hésitèrent pas à identifier Wong. Aldo se laissa tomber à genoux auprès du malheureux, cherchant par où il fallait commencer pour lui porter secours…
– Mon Dieu ! murmura-t-il. Comment ces salauds l’ont arrangé ! Et pourquoi ?
Ulrich, décidément de plus en plus utile, avait déjà été chercher une carafe d’eau, un verre, des torchons propres et même une bouteille de cognac.
– Leur idée fixe, en dehors du rubis, c’était de savoir où se trouvait un certain Simon Aronov. En revanche, j’ignore d’où sort celui-là ?
– Une villa à trois ou quatre kilomètres d’ici, répondit Adalbert. J’ai essayé d’aller le voir mais je n’ai trouvé personne. Et pour cause ! Une voisine m’a même dit qu’elle l’avait vu partir un soir avec un taxi et une valise.
– Elle a vu partir quelqu’un mais ce n’était sûrement pas lui, fit Aldo occupé à passer un peu d’eau sur le visage blessé. Tu penses bien que lorsqu’ils l’ont enlevé, ils n’ont pas convoqué les voisins pour assister à la scène.
– Comment va-t-il ?
– Laissez-moi voir ! dit Ulrich. Dans ma… profession on a l’habitude de toutes sortes de blessures et puis… je suis un peu médecin !
– Il faut trouver une ambulance, le faire conduire dans un hôpital, dit Aldo. La Suisse en est pavée !
Mais l’Américain secouait la tête :
– Inutile ! Il est en train de mourir. Tout ce qu’on peut faire c’est essayer de le ranimer au cas où il aurait quelque chose à nous dire ?
Avec d’infinies précautions étonnantes chez cet homme voué à la violence, il nettoya la bouche où le sang séchait et fit avaler un peu d’alcool au mourant. Cela dut le brûler car il réagit faiblement, gémit mais ouvrit les yeux. Il reconnut sans doute le visage anxieux d’Aldo penché sur lui. Il essaya de lever une main que le prince prit entre les siennes.
– Vite ! … chuchota-t-il. Aller vite ! …
– Où voulez-vous que nous allions ?
– Var… Varsovie… Le maître ! Ils savent… où il est !
– Vous le leur avez dit ?
Dans les yeux éteints, une faible flamme se ralluma, une flamme d’orgueil :
– Wong… n’a pas parlé mais ils savent… Un traître… Würmli ! Les attend là-b… as.
Le dernier mot sortit avec le dernier souffle. La tête glissa un peu entre les mains d’Aldo qui la soutenait. Celui-ci releva sur l’Américain un regard interrogateur.
– Oui. C’est fini… dit celui-ci. Qu’est-ce que vous comptez faire ? reprit-il. Prévenir la police ?
– Sûrement pas ! dit Adalbert. La police, il va falloir qu’on lui fausse compagnie alors que nous n’avons pas le droit de quitter la ville. On s’arrangera pour la prévenir quand on sera loin.
– C’est la sagesse ! Et on fait quoi maintenant ? En ce qui me concerne, je n’ai pas envie de m’éterniser…
– On peut comprendre ça, soupira Morosini. Je vous propose de rentrer à l’hôtel avec nous et d’attendre qu’il soit une heure décente pour faire ouvrir le coffre. Pendant ce temps, nous préparerons notre départ. Je vous remets ce que je vous ai promis et nous nous séparons.
– Un instant, coupa Adalbert. Sauriez-vous par hasard qui est ce Würmli dont Wong vient de prononcer le nom ?
– Absolument pas.
– Moi je sais qui c’est ! dit Aldo. Allons-nous-en, maintenant, mais croyez bien que je regrette de ne pas pouvoir rendre quelques honneurs à ce fidèle serviteur qu’était Wong. C’est affreux de devoir le laisser là.
– Oui, dit Adalbert, mais c’est plus prudent !
Peu après huit heures du matin, Vidal-Pellicorne et Morosini quittaient Zurich par la route en direction du lac de Constance. Ulrich était parti vers une destination inconnue avec, en poche, le beau collier de Giulia Farnèse complété d’un certificat de vente que lui avait signé Aldo pour lui éviter tout problème ultérieur. Les bagages avaient été faits rapidement puis, tandis qu’Aldo écrivait une lettre pour Lisa afin de lui expliquer qu’ils partaient à la recherche des voleurs et sans doute aussi des meurtriers de Dianora, Adalbert procédait à la mise en condition de son petit bolide en vue d’une longue distance. Il avait calculé, en effet, qu’en se relayant au volant, lui et Aldo arriveraient peut-être à Varsovie avant Sigismond.

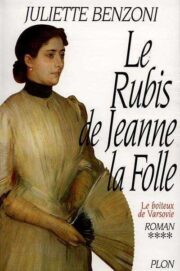
"Le rubis de Jeanne la Folle" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le rubis de Jeanne la Folle". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le rubis de Jeanne la Folle" друзьям в соцсетях.