– Si vous nous disiez maintenant ce qui s’est passé ? suggéra Vidal-Pellicorne.
– Il n’était pas loin de onze heures et on était à fumer notre pipe, Karl le jardinier et moi, tandis que ma femme rangeait la vaisselle quand on a entendu crier les chiens… Notez que j’ai pas dit aboyer ! C’était un cri affreux et on s’est précipités dehors Karl et moi, mais c’est tout juste si on a eu le temps de se reconnaître : en un rien de temps on était assommés et ligotés sur des chaises dans notre salle. C’est là qu’on a repris conscience et ma femme, ligotée et bâillonnée elle aussi, était près de nous. Par les fenêtres on voyait des gens qui s’agitaient avec des torches. On apercevait aussi la silhouette de Pane Baron derrière le vitrage de son cabinet au premier étage. Le vacarme était assourdissant parce que les bandits avaient ramassé un tronc d’arbre dans la forêt et s’en servaient comme d’un bélier en gueulant comme des ânes…
– Et vous, Wong, où étiez-vous ? Auprès de votre maître ?
Le blessé qui semblait somnoler ouvrit les yeux et, à la grande surprise de ceux qui le regardaient, ils étaient pleins de larmes.
– Non. Le maître m’avait envoyé après le déjeuner à Budweis avec la voiture. Je suis allé déposer un paquet à la banque et faire quelques emplettes, mais je ne devais revenir que tard dans la soirée et ne pas aller jusqu’à la maison. Les ordres du maître étaient que je range la voiture dans le couvent en ruine qui se trouve à trois cents mètres d’ici et que j’attende. C’est là que, pour la première fois, je lui ai désobéi…
– Désobéir, vous ? s’étonna Morosini.
– Oui. Il n’est jamais bon de suivre ses impulsions. J’étais arrivé à l’endroit indiqué quand, tout d’un coup, j’ai entendu un bruit assourdissant et j’ai vu une grande flamme monter vers le ciel. Alors je me suis précipité vers la maison, en laissant la voiture à sa place. Quand je suis arrivé, le château brûlait et des hommes s’agitaient autour mais il n’y avait ni Adolf ni Karl. Les étrangers m’ont aperçu. L’un d’eux a crié : « C’est le Chinois ! » Alors ils se sont jetés sur moi et m’ont traîné chez Adolf où j’ai vu tout le monde ligoté et bâillonné. Ils étaient fous de rage et ils voulaient à tout prix que je leur dise où était le Maître parce qu’ils ne parvenaient pas à croire qu’il ait pu faire sauter lui-même sa maison avec lui à l’intérieur.
– C’est le baron qui a… commença Adalbert stupéfait.
– Oui, c’est lui ! reprit Adolf les larmes aux yeux. Il avait dû tout préparer pour les recevoir. Les malfaisants s’apprêtaient à attaquer la porte au bélier quand tout a sauté. Il en est resté deux sur le carreau et les autres sont devenus enragés…
– Et vous êtes sûrs que le baron était dans la maison quand tout a sauté ?
– Je l’avais aperçu dans son bureau derrière la fenêtre éclairée, dit Adolf. Au moment de l’explosion, la lumière brillait toujours et, de toute façon, il n’aurait pas pu sortir. Il n’y a qu’une seule issue, celle qui passe sur les douves. Oh, il n’y a pas de doute : notre bon seigneur est bien mort. N’oubliez pas sa mauvaise jambe ! En admettant qu’il le veuille, il lui était impossible de sortir par une fenêtre. D’ailleurs, les autres faisaient bonne garde…
– Mais si les choses se sont passées comme ça, pourquoi donc les bandits ont-ils essayé de faire dire à Wong où il se trouvait ?
– Parce qu’ils n’arrivaient pas à y croire ! Surtout le beau jeune homme. Alors ils l’ont brûlé avec des cigarettes, ils lui ont tapé dessus avec un drôle de gant…
– Un coup-de-poing américain, précisa Wong. J’ai eu des côtes cassées, mais je crois qu’ils ont fini par admettre la vérité. Et puis l’explosion et les flammes ont attiré les gens d’alentour : il n’y en a pas beaucoup mais ils sont tout de même venus, alors le beau jeune homme a dit qu’il fallait filer en emportant les deux cadavres. Et c’est ce qu’ils ont fait, mais avant de partir, ce misérable m’a tiré dessus. Heureusement, il était très nerveux et il m’a raté. Ensuite, nous avons été délivrés et Adolf a fait venir un médecin de Krumau…
– Et la voiture ? demanda soudain Morosini. Avez-vous envoyé quelqu’un la chercher ?
– Bien sûr, dit Adolf. Karl qui sait conduire ces engins y est allé mais il a eu beau chercher, il n’a rien trouvé.
– Les bandits l’ont prise, peut-être ?
– Ils étaient bien trop pressés de filer. Et puis croyez-moi, il aurait fallu savoir où elle était…
Laissant Adalbert poser encore quelques questions de détail, Morosini s’éloigna pour aller contempler les ruines. Se pouvait-il que le corps de Simon repose sous cet amas de décombres ? 11 avait peine à y croire : de toute évidence, Aronov avait préparé la réception qu’il réservait à ses ennemis. Il avait même pris soin d’éloigner Wong et la voiture dont il comptait sans doute se servir. Connaissait-il donc un moyen de quitter, avant de le détruire à jamais, ce refuge désormais connu ? Un souterrain, peut-être ?
– Gageons que tu penses la même chose que moi ? dit Adalbert qui le rejoignait à cet instant. Difficile de croire que Simon se soit immolé, abandonnant sa mission sacrée, pour le simple plaisir d’échapper à la bande Solmanski… car je suppose que le « beau jeune homme brun » n’est autre que l’ineffable Sigismond ? D’abord, pour quelle raison aurait-il demandé à Wong de rester avec la voiture dans la ferme en ruine ? Il avait dans l’idée de l’y rejoindre…
– Mais comment est-il sorti ? Je pensais à un souterrain…
– C’est à ça qu’on pense toujours quand il s’agit d’un vieux château, mais d’après Adolf il n’y en a pas. Cela dit, j’ai une bizarre impression…
– L’impression que Wong a lui aussi des doutes touchant la mort de son patron mais que pour rien au monde il n’en parlerait devant Adolf, quelles que soient la fidélité et l’amitié que celui-ci voue à Simon. Il n’y a à cela qu’une solution : quand nous partirons d’ici, il faut emmener le Coréen avec nous.
– Où ça ?
– Chez moi, à Venise, et d’abord à l’hôpital San Zaccaria où il sera bien soigné. De toute façon, que Simon soit mort ou vivant, on ne peut pas laisser son fidèle serviteur derrière nous. S’il est mort je prendrai Wong à mon service, et s’il est vivant quelque chose me dit qu’il est peut-être le seul à pouvoir nous conduire vers lui.
– Pas une mauvaise idée ! Essayons de retrouver ce satané rubis et allons revoir les flots bleus de l’Adriatique. Tant que la pierre ne sera pas en ta possession, je ne te quitte plus !
CHAPITRE 8 LE RÉPROUVÉ
Le Herr Doktor Erbach ne ressemblait en rien aux bibliothécaires que Morosini – et même Vidal-Pellicorne – avaient déjà rencontrés. À la limite, on pouvait même trouver surprenant qu’il eût conquis tous les grades ou presque de l’université de Vienne, tant son aspect évoquait celui d’un maître de ballet ou d’un abbé de cour du XVIIIe siècle : cheveux blancs et follets voltigeant sur le col de velours d’une redingote juponnante portée sur des pantalons à sous-pieds, chemise à jabot et manchettes de mousseline, le tout parsemé d’une fine poussière de tabac, des lunettes cerclées de fer calées sur le petit bout d’un nez légèrement retroussé, l’œil pétillant et le sourire affable, l’homme des livres semblait toujours sur le point de s’envoler ou de battre un entrechat en s’appuyant sur la canne autour de laquelle il virevoltait plus qu’il ne marchait.
Accueillir un égyptologue doublé d’un prince-antiquaire ne parut pas le surprendre outre mesure. Il s’en acquitta avec une parfaite bonne grâce et une sorte d’empressement qui fit penser à
Morosini que le Dr Erbach devait s’ennuyer ferme dans cet immense château que les quelques domestiques aperçus ne parvenaient pas à peupler.
– Vous avez de la chance de me trouver ici, expliqua-t-il en rejoignant ses visiteurs dans le ravissant salon chinois où ils avaient été introduits. J’assume, en effet, les bibliothèques des autres châteaux Schwarzenberg : Hluboka où la famille réside le plus souvent, celle-ci et Trebon qui est de peu d’importance. Je suis venu à Krumau pour y classer l’énorme correspondance du prince Felix lorsqu’il était ambassadeur à Paris en 1810, au moment du mariage de Napoléon Ier avec notre archiduchesse Marie-Louise. Une bien tragique histoire ! ajouta-t-il en soupirant sans songer un seul instant à offrir un siège à ses visiteurs. Vous qui êtes français, Monsieur – et il se tourna vers Adalbert – vous savez sans doute quel drame a vécu la famille à cette horrible époque ? … Comment, lors du bal donné à l’ambassade, rue du Mont-Blanc, en l’honneur des nouveaux époux, la salle de bal improvisée dans les jardins prit feu, déchaînant une horrible panique et comment notre malheureuse princesse Pauline, la plus exquise des ambassadrices, périt dans les flammes en recherchant sa fille… Quelle chose abominable !
Il avait dévidé tout cela sans respirer mais, après « abominable », il s’accorda un profond soupir qu’Aldo saisit au vol :
– Nous nous intéressons aussi à l’Histoire ainsi que vous le devinez, dit-il, mais notre propos n’est pas de vous interroger sur le glorieux parcours des princes Schwarzenberg, si haut en couleurs soit-il…
– Ça, vous pouvez le dire ! La princessePauline est même entrée dans la légende. On prétend qu’à l’instant même où elle expirait, son fantôme apparut ici, à Krumau, à la nourrice qui veillais sur son plus jeune enfant. Mais je vous tiens debout ! Je vous en prie, Messieurs, prenez place !
Il désignait deux élégants cabriolets Louis XV tendus de satin bleu et blanc, se carrait dans un troisième, et reprenait :
– Où en étions-nous ? Ah oui, la malheureuse princesse Pauline ! Vous pourrez, si vous le désirez, admirer son portrait en robe de bal dans les grands appartements où bien des souverains…

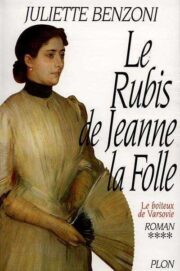
"Le rubis de Jeanne la Folle" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le rubis de Jeanne la Folle". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le rubis de Jeanne la Folle" друзьям в соцсетях.