Juliette Benzoni
La jeune mariée
Prologue
Paris, 5 août 1914…
La grosse locomotive noire, au coup de sifflet, commence à tirer ses wagons bondés, pleins de cris, de promesses, de chansons et de fleurs…
Depuis trois mois, à l’appel du président de la République, Raymond Poincaré et de René Viviani, son président du Conseil, des millions d’hommes quittent leurs champs – en pleine récolte ! –, leurs usines, leurs ateliers, leurs boutiques et leurs bureaux pour s’entasser dans des centaines de trains qui les emportent vers les frontières. Ils ne remarquent même pas que ce sont souvent des trains de marchandises vaguement aménagés ou simplement garnis de paille : ce sont leurs voitures et ils en ont pris possession en écrivant sur les parois extérieures et en grandes lettres blanches leurs défis et leurs espoirs. « À Berlin ! » ou « On les aura ! »… Sans imaginer un seul instant que de l’autre côté du Rhin, des wagons sur lesquels on a écrit « Nach Paris ! » ou « Gott mit uns ! » viennent à leur rencontre avec les mêmes certitudes.
Le convoi qui s’éloigne en ce moment de la gare de l’Est est composé de voitures de troisième classe où se sont entassés des hommes venus de tous les horizons que l’uniforme nivelle. Dolmans noirs et pantalons garance, ils se ressemblent tous. Et pour l’instant cela les amuse, ces « réservistes » habillés de gros drap qui sent un peu la naphtaline. Cela les rajeunit et ils se sentent pleins de courage et de résolution. D’ailleurs, tout le monde sait bien que « ça ne durera pas ! »…
Dans un coin-fenêtre, un homme est assis bras croisés, le képi enfoncé sur les yeux. Il est le seul à porter son uniforme avec aisance. Peut-être parce que depuis des années il vit sous un costume pas tellement différent. Il s’appelle Pierre Bault et, hier encore, il était « conducteur » de sleepings à bord des grands trains de luxe qui sillonnaient la France : le Méditerranée-Express d’abord, puis le Calais-Méditerranée.
Il a plus de quarante ans et il aurait pu rester dans les Chemins de Fer, s’y « planquer », comme on dit, mais il a voulu partir avec les autres, comme les autres. Par patriotisme d’abord mais aussi par un désenchantement dont ce wagon minable est le symbole. Ici, pas de teck blond, pas d’acajou ni de moquettes épaisses, pas de velours frappé mais des banquettes de bois blanc dont le vernis s’écaille. Son monde, à lui, était fait d’hommes élégants et surtout de femmes parées de ces riens qui les font inimitables, et ce monde vient de s’endormir peut-être pour longtemps ! – emportant avec lui les fourrures rares, les tissus soyeux, les plumes précieuses et les parfums sortis des sublimes laboratoires de MM. Guerlain, Piver, Coty et autres. Jusqu’à l’odeur du tabac qui a changé ! Le Havane ou le Lattaquié ont fait place au « gros cul » dont on bourre sa pipe ou que l’on roule entre ses doigts…
C’est sans importance, au fond, car ils sont bien sympathiques ces hommes qui entourent Pierre Bault ! Chaleureux et gais comme s’ils roulaient en « train de plaisir » et non vers un destin incertain qui, pour certains sera tragique. Mais, la mort, ils n’y pensent même pas peut-être parce que c’était si beau, tout à l’heure, dans la cour de la gare, cette foule de parents, d’amis et même d’inconnus qui les pressait, les chérissait et leur criait son amour avec son espérance. Beaucoup de femmes, bien sûr ! Elles étaient vêtues de robes claires, distribuaient des baisers et des fleurs, ces fleurs à présent mourantes à une boutonnière ou au canon des fusils.
Pierre les a trouvées belles avec leurs yeux brillants de larmes retenues et leurs sourires tendres. L’une d’elles lui a même donné une rose, à lui que personne n’accompagnait, et elle l’a embrassé… Il aurait voulu les tenir toutes et leur dire que même les vieilles ou laides elles lui semblaient aussi belles que ces créatures de rêve qui, depuis une douzaine d’années, peuplaient sa vie quotidienne sans qu’aucune lui ait jamais dit : « Je t’aime. » Elles passaient seulement et lui, durant quelques heures, veillait à leur confort, à leurs caprices, à leur sommeil. Parfois même à leur vie.
Il y en a eu trois, surtout, qu’il n’oubliera jamais parce qu’elles leur ont donné, à lui et à son train bien-aimé, l’occasion de jouer le rôle du Destin dans des vies où ils n’avaient pas grand-chose à faire. À première vue tout au moins. Autour d’elles il y avait des hommes mais particulièrement un que Pierre admire et qu’il aime bien parce qu’il n’est pas comme les autres et parce qu’il a, sans le vouloir, pu agir sur ces existences féminines.
Trois femmes également charmantes, également attachantes jusque dans leurs différences, qui se sont succédé chacune à une année d’intervalle : une petite marquise de seize ans, tout juste mariée, une belle Américaine sûre d’elle-même et de ses pouvoirs, et une exquise princesse mandchoue dont la fragilité de jade blanc cachait une âme forgée aux feux de l’enfer…
Le silence, petit à petit, s’est installé dans le compartiment. Les hommes rêvent, ou dorment, à moins qu’ils ne fassent les deux à la fois. Pierre Bault ferme les yeux lui aussi et se laisse bercer par la cadence familière des bogies. Il sait bien qu’il ne dormira pas car, à son poste au bout du long couloir d’acajou, il ne s’est jamais assoupi. Simplement, il va laisser venir à lui ses souvenirs et surtout ces trois femmes qui lui sont restées chères.
La première s’appelait Mélanie…
Première partie
MÉLANIE
1902-1903
Chapitre premier
SUR UN ARBRE PERCHÉE…
L'orage qui éclata en fin d’après-midi, conséquence logique d’une longue canicule, fit quelques dégâts, à Dinard. La villa « Morgane » et son jardin s’en tiraient avec un pin abattu, des massifs d’hortensias ravagés par la grêle, l’une des verrières de la serre endommagée et les allées sablées changées en longs fragments de grève creusés de rigoles. Au crépuscule, il fit presque froid et le vent apaisé du soir changea en fontaine la moindre branche d’arbre.
Ayant reçu presque tout le contenu d’un magnolia, Mélanie s’ébroua. À peine arrivée à mi-chemin de son mur, elle était déjà mouillée. Encore heureux qu’en s’échappant par la cuisine elle eût trouvé le grand châle noir que Rosa mettait pour aller au marché quand il y avait du vent ! Il l’enveloppait tout entière, couvrant presque sa chemise de nuit, seul vêtement qu’elle eût à sa disposition à cette heure tardive.
En la couchant, chaque soir, Fräulein faisait emporter par la femme de chambre les habits que son élève venait de quitter pour les ranger dans la penderie ou les déposer « au sale ». Elle ne laissait même pas à Mélanie une robe de chambre et une paire de pantoufles qu’elle considérait comme des « douilletteries » incompatibles avec une ferme éducation, telle qu’on la concevait tout au moins dans son Allemagne natale. On apportait tout cela lorsque Mélanie se levait, car elle n’était pas censée sortir de ses draps avant l’heure prescrite quels que puissent être les besoins nocturnes de sa vessie. En cas d’extrême urgence, le nécessaire se trouvait dans la table de chevet.
C’est donc en vertu de ces règles de vie dignes d’un soldat du Grand Frédéric que l’unique héritière des Desprez-Martel en était réduite à galoper pieds nus dans l’herbe mouillée, ce qui, d’ailleurs, ne la tourmentait guère : à quinze ans et en été on n’a pas le pied délicat. Et puis Mélanie eût fait bien d’autres sacrifices pour le plaisir de voir le bal qui allait se dérouler chez sa voisine.
Arrivée au bout de la grande pelouse, elle se retourna pour vérifier qu’il ne se passait rien d’imprévu mais la villa blanche, abritée comme sous un parapluie par ses toits d’ardoise, montrait paupières closes : aucune lumière ne filtrait de ses volets. Normal car il était déjà tard, mais un bal ne commençait jamais avant dix heures du soir et il n’y avait guère qu’une demi-heure que les tziganes se faisaient entendre.
Une demi-heure qui, pour Mélanie, s’était déroulée dans l’angoisse : elle ne retrouvait plus la clef de la cuisine que son ami Conan, le fils du jardinier et l’ennemi juré de Fräulein, lui avait fait faire en cachette. Elle crut d’abord l’avoir oubliée dans la poche de sa robe de piqué blanc qui devait être dans la buanderie, et il lui fallut dix bonnes minutes d’une agitation lui brouillant la mémoire pour se souvenir de l’endroit où elle l’avait cachée : au milieu de ses crayons de couleur.
Rassurée sur ses arrières, l’adolescente reprit sa course. Les échos d’une valse lui parvenaient, tendres, enveloppants, séduisants au possible. On commençait à entendre aussi la voix vigoureuse du valet chargé d’annoncer les invités cependant que l’ombre épaisse des arbres s’étoilait de lumières. Enfin Mélanie, avec un soupir de soulagement, atteignit le mur et surtout le grand cèdre dont les branches formaient au-delà de la clôture une avancée suffisante pour offrir une vue non seulement du parc illuminé dont la tempête n’était pas venue à bout mais aussi des salons largement éclairés. Bien sûr, escalader pieds nus un arbre trempé n’est pas une entreprise agréable, mais elle se trouvait largement compensée par le ravissant spectacle d’une fête chez celle que l’on appelait « la Reine de Dinard ».
Une reine à laquelle personne ne songeait à contester son titre, bien qu’en cet été 1902 la côte d’Émeraude attirât tout ce que l’Europe – et surtout le Royaume-Uni ! – comptait de grands noms et de grandes fortunes. Mrs. Hugues-Hallets était non la plus noble, ni la plus belle ni surtout la plus jeune mais une sorte de vivant miracle, un personnage hors du temps à qui son extrême richesse et ses fabuleuses relations permettaient tous les enchantements.

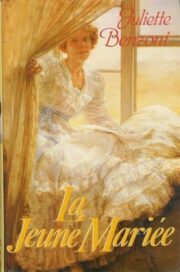
"La jeune mariée" отзывы
Отзывы читателей о книге "La jeune mariée". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La jeune mariée" друзьям в соцсетях.