— Je n’en suis pas possesseur mais simple locataire. Il est bon, pour les affaires de la banque dont je préside le conseil d’administration, que mon logis n’en soit point trop éloigné. C’est du moins ce qu’ont pensé le Premier ministre, M. de Polignac… et aussi Sa Majesté le Roi Charles X. J’ajoute que le marquis de Lauzargues est parfaitement au courant de cet état de choses.
— Il ne m’en a rien dit. Il semblerait que l’on m’ait tenue fort éloignée des affaires de mon père…
— Croyez-vous vraiment que ce soit le fait d’une jolie femme ?… Pardonnez-moi, je ne vous ai pas encore priée de vous asseoir mais je ne vous cache pas que votre vue me bouleverse. Vous ressemblez tellement à votre mère ! J’étais son… très respectueux admirateur et je crois qu’elle voulait bien voir en moi un ami.
Il avançait un siège qu’elle refusa du geste.
— Je vous remercie. Je n’ai pas l’intention de m’attarder puisque aussi bien je ne suis plus ici chez moi.
— Ne dites pas cela ! Cette maison est toujours vôtre, je vous l’assure, et si vous aviez bien voulu me prévenir de votre venue…
— A quel titre l’aurais-je fait puisque j’ignorais votre présence ? Au surplus, l’heure me paraît mal choisie pour ce genre de discussion. Vous recevez, ce soir, je crois ?…
— J’ai, en effet, quelques amis à dîner et d’autres vont venir pour la soirée, mais il n’y a là rien qui doive vous contrarier. Vous devez avoir un très grand besoin de repos et je vais donner des ordres pour que l’on vous prépare l’appartement le plus éloigné possible. Grâce à Dieu cette maison est assez grande pour que…
— Je vous en prie, prince, coupa Hortense, vous êtes en train de vous méprendre. Je comptais habiter chez moi mais je ne logerai chez vous à aucun prix. Vous occupez la maison, soit ! Il me reste Berny et si vous voulez bien m’y faire conduire, vous aurez rempli amplement votre devoir de gentilhomme envers une voyageuse isolée.
— Vous voulez… aller à Berny, cette nuit ?
— Ce n’est pas si loin. Et vous comprendrez que j’aie envie de me retrouver vraiment chez moi.
San Severno baissa la tête et, les mains nouées derrière le dos, entreprit d’arpenter lentement le grand tapis fleuri. Il semblait extrêmement contrarié et mordillait sa lèvre inférieure.
— Madame, fit-il au bout d’un instant, il semble que vous ne sachiez vraiment rien de ce qui concerne les biens de votre père. Je m’étonne d’ailleurs que M. le marquis de Lauzargues vous ait laissée dans une telle ignorance. Mais peut-être… ne l’avez-vous pas vu depuis fort longtemps ?
— Est-ce que trois semaines vous paraissent un laps de temps extravagant ? fit Hortense qui, envahie d’un pressentiment, avait peine à empêcher sa voix de trembler.
— Certes pas. Je suis d’autant plus surpris. L’affaire s’est traitée voici plus de six mois et avec le plein accord de votre beau-père agissant en votre nom.
Cette fois Hortense cria presque
— Quelle affaire ?
— Mais… la vente du château de Berny, voyons !… Mon Dieu vous n’allez pas vous évanouir au moins ?…
Le choc, en effet, avait été si rude qu’Hortense, les jambes fauchées, cherchait l’asile et l’appui d’un fauteuil tandis que des larmes lui montaient aux yeux. Vendu, son cher Berny !… la douce maison claire au bord de l’étang qu’elle teintait d’opale, le château de l’enfance, des beaux jours d’été, celui de l’automne aussi quand le tumulte des chevaux, des chiens et des piqueurs faisait vivre l’épais manteau de forêt qui le retranchait du monde ! Berny et ses fenêtres translucides ouvrant sur des jardins de rêve, Berny et ses serres construites jadis pour la mère d’Hortense ! Berny et ses eaux vives !
Le regard de la jeune femme accrocha soudain le cornet de cristal mauve qu’elle désigna d’une main tremblante.
— Si Berny est vendu, d’où tenez-vous ces roses ? C’est une espèce rare que mon père avait fait venir de Perse et que ses jardiniers avaient longuement travaillée pour la joie de ma mère.
La colère vibrait dans sa voix, balayant la douleur. Celle du prince fut un poème de lénifiante douceur.
— Sachant ma dilection pour elles, le nouveau propriétaire… je devrais dire la nouvelle propriétaire puisqu’il s’agit d’une dame, m’en fait porter quelquefois… Chère, chère comtesse ! je conçois votre chagrin mais vous devez comprendre : Berny est une demeure quasi royale. Il faut pour l’entretenir une grande fortune.
— Cette fortune a-t-elle donc cessé d’exister ? Tant que mon père a vécu, il n’a eu aucune peine à faire vivre ses demeures.
— Je sais, je sais… mais les choses ont changé. La banque, certes, est toujours florissante mais les affaires, du fait de la politique, ont subi de graves dommages. Il y a eu la dette de guerre laissée par la défaite…
— Que me parlez-vous de cela ? Je n’ignore pas que mon père en a, de son vivant, payé une grande partie en accord avec la banque Laffitte et quelques autres.
— Il en restait encore. Puis il y a eu le milliard des Émigrés, la guerre avec l’Espagne, enfin le manque de confiance qui règne actuellement dans l’épargne. Garder Berny eût été une folie que la banque Granier ne peut plus supporter. Je vous l’ai dit, une telle demeure exige une grande fortune… et lady Linton est fort riche.
— Lady Linton ? Vous avez vendu la maison de mon père à une Anglaise ? Mais je rêve !
— Nous avons vendu à qui était prêt à payer, madame ! Les Anglais ne sont plus nos ennemis, bien au contraire. Le rapprochement se fait sur tous les plans et j’irais même jusqu’à dire que l’Angleterre est des plus à la mode en France. Quant à lady Élisabeth… c’est l’une des femmes les plus aimables et les plus accueillantes qui soit. Après tout, votre idée de vous rendre à Berny n’est peut-être pas si mauvaise ? Je suis certain qu’elle vous accueillerait avec une joie…
— Je vous en prie, monsieur, brisons là ! Toutefois, avant de me retirer je désire encore apprendre de vous un ou deux détails…
— Mais je vous en prie.
— Vous m’avez dit que M. de Lauzargues avait été tenu informé de cette… tractation ?
— Je vous en donne ma parole. Le marquis d’ailleurs a reçu, pour vous-même et votre fils, une somme correspondant à la moitié du prix de vente, le reste demeurant à la banque pour y être réinvesti au nom de votre fils, bien entendu.
Soulevée par une colère dont elle n’était plus maîtresse, Hortense repoussa brutalement, en se levant, le fauteuil qui l’avait accueillie.
— Mais enfin, monsieur, cette fortune est la mienne et je m’étonne que personne, à la banque, ne daigne s’en souvenir. Je connais trop mon père pour imaginer un seul instant qu’il ait négligé de prendre des dispositions propres à m’assurer l’indépendance financière. Qu’a-t-on fait de ces dispositions ?
— Elles ont été, il me semble, scrupuleusement respectées. La banque a versé pour vous, jusqu’à votre mariage, une pension au marquis de Lauzargues. Ensuite, elle a versé votre dot qui était de cent mille livres, enfin les dividendes – sans compter la part de Berny – sont versés régulièrement…
— A M. de Lauzargues ? Et pourquoi pas à moi ? Je suis veuve, monsieur.
— Certes et nous avons tous ressenti ce deuil qui vous a frappée mais…
— Je ne vous en demande pas tant ! Je veux entrer en possession de ce qui m’appartient et auquel le marquis de Lauzargues n’a aucun droit. Je suis jeune, sans doute, mais ni passive ni imbécile, et le code Napoléon n’a jamais indiqué qu’une femme, une mère surtout, dût être dépouillée de ses biens au profit d’étrangers. Demain, j’irai à la banque.
— Calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous ! Cette maison est pleine de monde. On pourrait vous entendre…
— Voilà qui m’est égal. Que l’on m’entende donc ! On ne m’entendra jamais assez !
— Mais que voulez-vous faire enfin ?
Elle tourna la tête vers lui avec un sourire plein de lassitude :
— Prendre un peu de repos d’abord. Je crois que j’en ai le plus grand besoin.
— C’est évident, voyons ! Je vous en prie, laissez-moi vous offrir l’hospitalité… en toute amitié.
— Je vous remercie, mais je ne peux accepter.
— Pourquoi ? Cette maison est la vôtre après tout.
— Après tout, en effet ! Et puis, êtes-vous marié, prince ?
— Non, hélas. Mon épouse a quitté ce monde voici bientôt quinze ans et je n’ai pas eu le cœur de la remplacer.
— Je vous en félicite mais en ce cas vous comprendrez que je ne saurais demeurer sous le même toit qu’un homme seul. Dans ma situation, je dois veiller à ma réputation.
— Croyez-vous qu’un quelconque hôtel lui sera plus favorable ? repartit San Severo vexé visiblement de cette leçon de bienséance.
— Aussi n’irai-je pas à l’hôtel. Si vous voulez bien me faire appeler une voiture, j’ai l’intention de me rendre au couvent des Dames du Sacré-Cœur où j’ai été élevée. Je suis certaine que la Révérende Mère Madeleine-Sophie Barat m’accueillera. Nous nous reverrons demain, à la banque, où je me rendrai dans la journée.
— Rien ne presse. Prenez un peu de repos !
— Monsieur, je n’ai pas les moyens de prendre de repos. J’entends réclamer aux guichets de mon père au moins une part de ce qui m’est dû.
— N’est-ce que cela ? Alors soyez sans crainte. Dès demain, je donnerai ordre qu’on vous porte, rue de Varenne… c’est bien rue de Varenne ?… une certaine somme pour vos premiers frais. Nous aurons, par la suite, le temps de voir avec vous comment nous pouvons vous satisfaire tout en respectant les intérêts de chacun.
— Maintenant, je vous en prie, veuillez me faire appeler une voiture.
Il n’en est pas question. Je vais dire que l’on attelle. Vous refusez mon hospitalité mais vous accepterez au moins ma voiture, j’espère ?

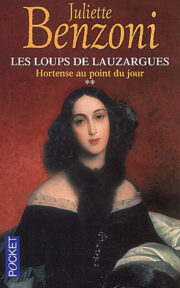
"Hortense au point du jour" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hortense au point du jour". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hortense au point du jour" друзьям в соцсетях.