— Comment crois-tu que c’est arrivé ? Dis-moi.
— C’est à peu près la même histoire. Elle allait à pied chez ta grand-mère ce matin-là, dans son manteau rouge. Elle ne devait pas se sentir très bien, pas bien du tout même. Elle devait encore avoir la nausée, peut-être avait-elle vomi avant. Elle avait sans doute la tête qui tournait et la démarche mal assurée. Sa nuque était probablement raide. Mais elle a voulu affronter ta grand-mère, malgré tout, pensant sans doute que c’étaient les derniers soubresauts de sa migraine. Elle ne se souciait pas de sa santé. Elle ne pensait qu’à June. À June et à ta grand-mère.
Je me cache le visage dans les mains. Imaginer ma mère souffrante remontant vers l’avenue Georges-Mandel, avec son corps qu’elle avait du mal à traîner, partant braver Blanche comme un courageux petit soldat, est insupportable.
— Continue.
— L’histoire se déroule à peu près comme la tienne. Gaspard ouvre la porte, il remarque qu’elle a mauvaise mine, qu’elle est essoufflée. Elle n’a qu’un but, affronter ta grand-mère. Blanche aussi a sans doute remarqué quelque chose, la pâleur alarmante du visage de Clarisse, sa façon de parler, son manque d’équilibre. La conversation est la même. Blanche sort les photos, le rapport du détective, et Clarisse campe sur sa décision. Elle ne cessera pas de voir June, elle aime June. Et soudain, l’accident. En un éclair. Une douleur intense. Comme un coup de pistolet dans son crâne. Clarisse vacille, porte les mains à ses tempes et s’écroule. Sur le coin de la table de verre peut-être. Mais, de toute façon, elle est déjà morte. Ta grand-mère ne peut rien faire. Le médecin non plus. Quand il arrive, il comprend. Il sait qu’il a commis une erreur en ne l’envoyant pas à l’hôpital… Il a dû porter ce poids toute sa vie.
À présent, je comprends la réticence de Laurence Dardel à me donner ce dossier. Elle savait qu’un œil expert décèlerait rapidement la faute de son père.
Angèle vient s’asseoir sur mes genoux, ce qui n’est pas facile vu la longueur de ses jambes.
— Est-ce que ça t’éclaire un peu ? me demande-t-elle tendrement.
Je l’enlace en posant mon menton au creux de son cou.
— Oui, je crois. Ce qui fait mal, c’est de ne pas savoir.
Elle me caresse les cheveux d’une main apaisante.
— Quand je suis rentrée de l’école ce jour-là, le jour où mon père s’est tiré une balle dans la tête, il n’y avait aucun mot. Il n’avait rien laissé. Ça nous a rendues dingues, ma mère et moi. Juste avant sa mort, il y a quelques années, elle m’a redit comme c’était terrible de n’avoir jamais su pourquoi il s’était suicidé, même après toutes ces années. Il n’avait pas de maîtresse, pas de problèmes financiers. Pas de soucis de santé. Rien.
Je la serre contre moi en pensant à la jeune fille de treize ans qui a découvert son père mort. Sans un mot. Sans explication. Je frissonne.
— On n’a jamais su pourquoi. Il a fallu vivre avec ça. J’ai appris à le faire. Ça n’a pas été facile, mais j’ai surmonté ma douleur.
Et je comprends, à ses mots, que c’est précisément ce que je vais devoir apprendre désormais.
— C’est l’heure, dit Angèle d’un air enjoué.
Nous prenons un café après avoir déjeuné dehors, sur le patio, devant la cuisine. Le soleil est exceptionnellement chaud. Le jardin revient peu à peu à la vie. Le printemps n’est pas loin, il caresse déjà mes narines, mes pauvres narines polluées de Parisien. C’est un parfum d’herbe, d’humidité, de fraîcheur, un parfum piquant. Délicieux.
Je la regarde, surpris.
— L’heure de quoi ?
— L’heure de partir.
— Où ?
Elle sourit.
— Tu verras. Enfile quelque chose de chaud. Le vent réserve parfois des surprises.
— Qu’est-ce que tu manigances ?
— Tu aimerais bien savoir, hein ?
Au début, j’étais mal à l’aise à l’arrière de la Harley. Je n’avais pas l’habitude des motos, je ne savais jamais de quel côté me pencher et, en bon garçon de la ville, j’étais convaincu que les deux-roues étaient trop dangereux pour que je leur accorde la moindre confiance. Angèle faisait le trajet en Harley tous les jours de Clisson à l’hôpital du Loroux, qu’il pleuve ou qu’il vente. Elle détestait les voitures, les embouteillages.
Elle avait acheté sa première Harley à vingt ans. Celle-ci était sa quatrième.
Une jolie femme sur une Harley vintage, ça ne passe pas inaperçu, j’ai pu m’en rendre compte. Le ronronnement caractéristique du moteur attire l’attention, comme la créature tout en courbes et en cuir noir juchée sur l’engin. Rouler à l’arrière est bien plus agréable que je ne l’imaginais. Je suis rivé à elle dans une position explicite, mes cuisses l’enserrent, mon sexe est collé à son cul divin, mon ventre et ma poitrine épousent les courbes de ses hanches et de son dos.
— Allez, le Parisien, on n’a pas toute la journée ! crie-t-elle en me jetant un casque.
— On nous attend ?
— Tu parles si on nous attend ! dit-elle pleine d’enthousiasme, en regardant sa montre. Et si tu ne te bouges pas, on sera en retard.
Nous filons le long de mauvaises routes de campagne bordées de champs pendant environ une heure. Le temps me parait court lové contre Angèle, grisé par les vibrations de la Harley et le soleil qui me caresse le dos.
Ce n’est qu’en voyant les panneaux annonçant le passage du Gois que je comprends où nous sommes. Je n’avais jamais réalisé à quel point Clisson est près de Noirmoutier. Le paysage me semble si différent à cette saison, des nuances brun et beige, pas de vert. Le sable aussi est plus foncé, plus terreux, mais il n’en est pas moins beau. Les premières balises semblent me saluer et les mouettes qui volent et crient au-dessus de ma tête ont l’air de se souvenir de moi. La grève s’étire au loin, ligne brune parsemée de gris, touchée par l’éclat de la mer bleu marine qui scintille sous le soleil, jonchée de coquillages et d’algues, de déchets divers, de bouchons de pêche et de bois flotté.
Il n’y a plus une voiture sur le passage. C’est l’heure de la marée haute, les premières vagues commencent à recouvrir la chaussée. L’île paraît déserte, contrairement à l’été, quand des foules denses se pressent pour observer la mer dévorer la terre. Angèle ne ralentit pas, elle accélère. Je lui tape sur l’épaule pour attirer son attention, mais elle m’ignore superbement, concentrée sur la Harley. Les rares personnes qui sont là nous montrent du doigt, l’air stupéfait, tandis que nous filons comme l’éclair. C’est comme si je les entendais dire : « Non ! Vous croyez qu’ils vont passer le Gois ? » Je tire sur sa veste, plus fort cette fois. Quelqu’un klaxonne pour nous prévenir, mais il est trop tard, les roues de la Harley font gicler l’eau de mer, en grandes gerbes, de chaque côté de la chaussée. Sait-elle vraiment ce qu’elle fait ? Enfant, j’ai lu trop d’histoires d’accidents sur le Gois pour ne pas penser que ce qu’elle tente est fou. Je m’accroche à elle comme à une bouée, priant pour que la Harley ne dérape pas, ne nous envoie pas la tête la première dans la mer, priant pour que le moteur ne soit pas noyé par une de ces vagues écumeuses qui grossissent de minute en minute. Angèle avale les quatre kilomètres en douceur. Je parierais que ce n’est pas la première fois qu’elle s’amuse à ça.
C’est merveilleux, exaltant. Je me sens en sécurité soudain, absolument en sécurité, plus que je ne me suis senti dans toute ma vie, depuis la main de mon père dans mon dos. Protégé. Mon corps contre le sien, tandis que nous glissons sur l’eau, sur ce qui fut une route. L’île se rapproche, j’aperçois les balises, tels des phares guidant un bateau vers son havre. J’aimerais que ce moment dure toujours, que sa beauté et sa perfection ne me quittent jamais. Nous atteignons la terre sous les applaudissements et les cris des promeneurs qui sont regroupés près de la croix plantée à l’entrée du passage.
Angèle coupe le moteur et retire son casque.
— Je parie que tu as eu une sacrée trouille, me taquine-t-elle avec un grand sourire.
— Non ! me récrié-je en posant mon casque sur le sol pour pouvoir l’embrasser sauvagement, toujours sous une nouvelle salve d’applaudissements. Je n’ai pas eu peur, j’ai confiance en toi.
— Tu peux. La première fois que j’ai fait ça, j’avais quinze ans. C’était avec la Ducati d’un ami.
— Tu pilotais des Ducati à quinze ans ?
— Tu serais surpris de ce que je faisais à cet âge-là.
— Pas envie de savoir, dis-je avec désinvolture. Et comment on retourne chez toi maintenant ?
— On prendra le pont. Moins romantique, mais bon.
— Carrément moins romantique. Et puis, je ne serais pas contre, me retrouver coincé sur une balise avec toi. On ne s’ennuierait certainement pas…
Le gigantesque arc du pont est visible de là où nous sommes, bien qu’il se trouve à cinq kilomètres. La route a complètement disparu et la mer, immense et scintillante, a repris ses droits.
— Je venais ici avec ma mère. Elle adorait le Gois.
— Et moi, avec mon père, dit-elle. Nous avons passé quelques étés ici, nous aussi, quand j’étais enfant. Mais pas au bois de la Chaise, c’était trop chic pour nous, monsieur ! Nous allions à la plage de la Guérinière. Mon père était de la Roche-sur-Yon. Il connaissait l’endroit comme sa poche.
— Alors peut-être nous sommes-nous croisés ici, au Gois, quand nous étions petits ?
— Peut-être.
Nous nous asseyons sur la butte herbeuse près de la croix, épaule contre épaule. Nous partageons une cigarette. Nous sommes tout près de l’endroit où je me suis assis avec Mélanie, le jour de l’accident. Je pense à elle, enfermée dans son ignorance, par sa propre volonté. Je pense à tout ce que j’ai appris, qu’elle ne saura jamais, sauf si elle me questionne. Je prends la main d’Angèle et l’embrasse. Je pense à tous ces « si » qui m’ont conduit jusqu’à cette main, jusqu’à ce baiser. Si je n’avais pas organisé ce week-end à Noirmoutier pour les quarante ans de Mélanie. Si Mélanie n’avait pas eu ce flash-back. S’il n’y avait pas eu l’accident. Si Gaspard n’avait pas vendu la mèche. S’il n’avait pas conservé cette facture. Et tant d’autres « si ». Si le docteur Dardel avait envoyé ma mère à l’hôpital le 7 février, jour de sa migraine, aurait-elle été sauvée ? Aurait-elle quitté mon père pour vivre avec June ? À Paris ? À New York ?

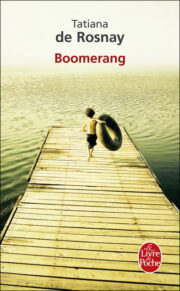
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.