J’arrête là. C’est la fin de l’histoire.
Angèle me retourne gentiment pour que je puisse voir son visage. Elle pose ses mains sur mes joues et reste ainsi, à me regarder, longtemps.
— Est-ce comme ça que ça s’est passé, Antoine ? me demande-t-elle d’une voix douce.
— J’y ai tellement réfléchi. Je crois que c’est ce qui s’approche le plus de la vérité.
Elle se dirige vers la cheminée, appuie son front contre la pierre et se tourne vers moi.
— As-tu réussi à aborder le sujet avec ton père ?
Mon père. Par où commencer ? Comment lui décrire notre dernière conversation, il y a quelques jours ? Ce soir-là, en sortant du bureau, je sentais que je devais lui parler, malgré l’avis de Mélanie, malgré ses efforts pour m’en dissuader, pour des raisons qui la regardent. J’avais besoin de braver le silence. Maintenant. Fini, le temps des devinettes. Que savait-il exactement de la mort de Clarisse ? Que lui avait-on raconté ? Connaissait-il l’existence de June Ashby ?
Quand je suis arrivé, Régine et lui dînaient devant la télévision. Ils regardaient les informations. Un sujet sur les prochaines élections américaines. Sur ce candidat grand et mince, à peine plus âgé que moi, que les gens appelaient le « Kennedy noir ». Mon père ne disait rien, il semblait fatigué. Il avait peu d’appétit et une montagne de cachets à avaler. Régine a chuchoté qu’il rentrait à l’hôpital dans une semaine, pour quelque temps.
— Il traverse une mauvaise passe, a-t-elle ajouté en secouant la tête d’un air découragé.
Le repas terminé, Régine s’est isolée dans une autre pièce pour téléphoner à une amie. Alors j’ai annoncé à mon père, en espérant qu’il daigne décoller les yeux de la télé, que je désirais lui parler. Il a eu vaguement l’air d’accepter de m’écouter. Mais quand ses yeux se sont enfin tournés vers moi, ils étaient si abattus que je n’ai pu décrocher un mot. Il avait le regard d’un homme qui sait qu’il va mourir et ne supporte plus de rester sur terre. Un regard exprimant à la fois la plus pure tristesse et une soumission tranquille. J’étais bouleversé. Disparu, le père autoritaire, le censeur arrogant. J’avais face à moi un vieil homme malade, à l’haleine fétide, sur le point de crever et qui n’avait plus envie d’écouter ni moi ni personne.
C’était trop tard. Trop tard pour lui dire qu’il comptait pour moi, trop tard pour lui avouer que j’étais au courant de son cancer, que je savais qu’il était mourant, trop tard pour lui poser des questions sur June et Clarisse, me risquer sur ce terrain glissant avec lui. Il a lentement cligné des yeux, sans expression particulière, il attendait que je parle, et, comme je n’ai rien dit, finalement, il a haussé les épaules et tourné la tête vers le poste de télévision sans insister. C’était comme si le rideau était retombé sur la scène. Le spectacle était terminé. Allez, Antoine, c’est ton père, fais un effort, prends-lui la main, fais en sorte qu’il sache que tu es là, que tu penses à lui, même si ça te coûte, fais un effort, dis-lui que tu penses à lui, dis-lui avant qu’il ne soit trop tard, regarde-le, il va mourir, il lui reste peu de temps. Tu ne peux plus attendre.
Je me suis souvenu que, quand il était jeune, il arborait un sourire éclatant sur son visage sévère, ses cheveux étaient noirs et épais, rien à voir avec les trois pauvres mèches qui lui restaient aujourd’hui. Il nous prenait dans ses bras et nous embrassait tendrement. Il promenait Mélanie sur ses épaules au bois de Boulogne, il posait une main protectrice dans mon dos, il m’aidait à avancer et je me sentais le garçon le plus fort du monde. Les tendres baisers avaient disparu à la mort de ma mère. Il était alors devenu exigeant, inflexible. Toujours critique, prompt à juger. Je voulais lui demander pourquoi la vie l’avait rendu si amer, si hostile. Était-ce à cause de la mort de Clarisse ? De la perte de la seule personne qui l’ait jamais rendu heureux ? Parce qu’il savait qu’elle était infidèle ? Parce qu’elle avait aimé quelqu’un d’autre ? Une femme ? Était-ce cela, cette humiliation ultime, qui avait brisé le cœur de mon père, brisé jusqu’à son âme ?
Mais je ne lui ai posé aucune de ces questions. Aucune. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte d’entrée. Il n’a pas bougé. La télévision braillait. Comme Régine dans la pièce d’à côté.
— Au revoir, papa.
Encore une fois, il a vaguement grommelé, sans tourner la tête. Je suis parti en refermant la porte derrière moi. Dans l’escalier, je n’ai pas pu retenir mes larmes. Des larmes amères de remords et de douleur qui, en coulant, me rongeaient la peau comme de l’acide.
— Non, je n’ai pas pu parler à mon père. Impossible.
— Ne t’en veux pas, Antoine. Ne te rends pas les choses encore plus douloureuses.
L’envie de dormir me saisit brusquement, comme si on jetait une épaisse couverture sur ma tête. Angèle me met au lit et je m’émerveille de la douceur de ses gestes, de ses mains attentives et respectueuses qui affrontent la mort tous les jours. Je sombre dans un sommeil agité. J’ai l’impression de m’enfoncer dans une mer trouble et sans fond. Je fais des rêves étranges. Ma mère à genoux dans son manteau rouge face au train. Mon père avec son sourire heureux d’autrefois, escaladant un sommet dangereux, raide et enneigé, le visage brûlé par le soleil. Mélanie dans une longue robe noire, flottant à la surface d’une piscine, noire elle aussi, les bras ouverts, des lunettes de soleil sur le nez. Et moi, tentant de me frayer un passage dans une forêt touffue, pieds nus dans un sol boueux et grouillant d’insectes.
Quand je me réveille, il fait jour et, en un instant d’affolement, je ne sais pas où je suis. Puis tout me revient. Je suis chez Angèle. Dans cette maison remarquablement rénovée du XIXe siècle, qui était, autrefois, une petite école primaire. Près de la rivière, au centre de Clisson, dans ce pittoresque village historique proche de Nantes dont je n’avais jamais entendu parler avant de la rencontrer. Du lierre grimpe sur la façade de pierre, deux grandes cheminées dépassent du toit de tuiles. Et l’ancienne cour de récréation est devenue, à l’abri de ses murs, un jardin enchanteur. Je suis allongé dans le lit confortable d’Angèle. Mais elle n’est pas près de moi. Sa place est froide. Je me lève et descends. Je suis accueilli par une odeur appétissante de café et de tartines grillées. Une lumière pâle et citronnée entre par les fenêtres. Dehors, le jardin est recouvert d’une fine pellicule de givre, on dirait le glaçage d’un gâteau. De là où je me tiens, je ne vois que le sommet des ruines du château fort de Clisson.
Angèle est assise à table. Un genou replié sur sa chaise, elle est plongée dans la lecture d’un document. Son ordinateur est ouvert près d’elle. En m’approchant, je vois qu’elle étudie le dossier médical de ma mère. Elle lève un œil. Ses yeux sont cernés. Elle n’a pas dû beaucoup dormir.
— Que fais-tu ?
— Je t’attendais. Je ne voulais pas te réveiller.
Elle se lève, me prépare une tasse de café. Elle est déjà habillée. Dans sa tenue habituelle. Jean et col roulé noirs, bottes.
— On dirait que tu n’as pas beaucoup dormi.
— J’ai parcouru le dossier médical de ta mère.
Son ton trahit une révélation à venir.
— Et alors ? Tu as remarqué quelque chose ?
— Oui, dit-elle. Assieds-toi, Antoine.
Je m’installe à côté d’elle. Il fait chaud dans la cuisine ensoleillée. Après ma nuit agitée de mauvais rêves, je ne suis pas sûr d’être prêt à affronter une nouvelle épreuve. Je rassemble mes forces.
— Et qu’est-ce que tu as vu dans ce dossier ?
— Tu sais que je ne suis pas médecin, mais je travaille dans un hôpital et je vois des morts tous les jours. Je lis leurs dossiers, je parle aux docteurs. J’ai bien étudié le dossier de ta mère pendant que tu dormais. J’ai pris des notes. Et j’ai fait des recherches sur Internet. J’ai aussi envoyé des mails à des amis médecins.
— Et ? insisté-je, soudain incapable d’avaler mon café.
— Ta mère avait commencé à avoir des migraines deux ans avant sa mort. Pas très fréquentes, mais fortes. Tu t’en souviens ?
— Une ou deux fois peut-être… Elle avait dû rester allongée dans le noir et le docteur Dardel était venu l’examiner.
— Quelques jours avant sa mort, elle a eu une crise et elle a vu le docteur. Regarde, c’est là.
Elle me tend le document photocopié où je reconnais l’écriture tordue du docteur Dardel. J’ai déjà vu ce document, il était dans ses dernières notes avant la mort de Clarisse. 7 février 1974. Migraine. Nausée, vomissements, douleurs oculaires. Vision dédoublée.
— Oui, j’ai déjà lu ces notes. Ça veut dire quoi ?
— Que sais-tu des anévrismes, Antoine ?
— C’est comme une petite bulle, une petite cloque qui se forme à la surface d’une artère cérébrale. La paroi d’un anévrisme est plus fine que celle d’une artère. Le danger survient quand cette membrane se rompt.
— C’est pas mal.
Elle se sert à nouveau du café.
— Pourquoi tu me demandes ça ?
— Parce que je crois que ta mère est en effet morte d’une rupture d’anévrisme.
Je la fixe, interdit. Puis je finis par balbutier :
— Alors, elle ne se serait pas battue avec Blanche ?
— Je te dis juste ce que je crois. C’est tout. C’est toi qui as le dernier mot dans cette histoire. C’est ta vérité.
— Tu crois que j’exagère, que je me fais des idées ? Que je suis parano ?
— Non, bien sûr que non.
Elle pose sa main sur mon épaule.
— Ne t’emballe pas. Ta grand-mère était une vieille bique homophobe, cela ne fait aucun doute. Mais écoute quand même ce que j’ai à te dire, d’accord ? Le 7 février 1974, le docteur Dardel examine ta mère avenue Kléber. Elle a une violente migraine. Elle est au lit, dans le noir. Il lui prescrit le médicament qu’elle prend habituellement et le lendemain, la crise est passée. Enfin, c’est ce qu’il pense. C’est ce qu’elle pense aussi. Mais un anévrisme cérébral peut enfler, lentement et sûrement, et peut-être était-il là depuis un moment, sans que personne ne s’en doute. Quand un anévrisme enfle, avant d’exploser et de saigner, il fait pression sur le cerveau ou sur le nerf optique, les muscles du visage ou du cou. Migraine, nausées, vomissements, douleurs oculaires, vision dédoublée. Si le docteur Dardel avait été un peu plus jeune et un peu plus dans le coup, avec ce genre de symptômes, il aurait envoyé ta mère à l’hôpital immédiatement. Mes deux amis médecins me l’ont confirmé par mail. Peut-être le docteur Dardel était-il débordé ce jour-là, peut-être était-il préoccupé par d’autres cas urgents, peut-être a-t-il sous-estimé la situation. Toujours est-il que l’anévrisme a grossi et que le 12 février, c’est-à-dire cinq jours plus tard, il s’est rompu.

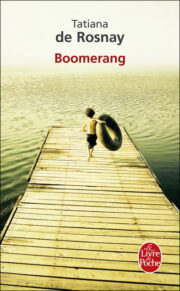
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.