— Je ne sais pas, vous, mais je n’arrête pas de penser à ce qui vient d’arriver, murmure-t-elle. Je me sens presque responsable, comme si j’avais tué cette malheureuse personne de mes mains.
— Mais non !
— C’est plus fort que moi. Je sens comme un nœud, là. – Elle frissonne. – Je pense aussi au conducteur du train… vous imaginez ? Et avec ces TGV, je suppose qu’il est impossible de freiner à temps. Et puis, la famille de cette personne… Je vous ai entendu dire qu’il s’agissait d’une femme… Je me demande si l’on a déjà pu l’identifier ? Peut-être que personne ne sait encore. Ceux qui l’aimaient ignorent encore que leur mère, leur sœur, leur fille, leur femme, que sais-je, est morte. Je trouve cette idée insupportable. – Elle sanglote, tout doucement. – J’ai hâte de descendre de ce fichu train. Je voudrais que ce ne soit jamais arrivé.
Cynthia lui prend la main. Moi, je n’ose pas. Je ne veux pas que cette charmante créature puisse penser que je profite de la situation.
— Nous ressentons tous la même chose, la réconforte Cynthia. Ce qui est arrivé ce soir est atroce. Horrible. Comment ne pas être bouleversé ?
— Et ce type… Ce type qui n’arrêtait pas de se plaindre qu’il allait être en retard, sanglote-t-elle. Et il n’était pas le seul. J’en ai entendu d’autres dire la même chose.
Moi aussi, je suis hanté par le bruit du choc. Je ne lui dis pas, parce que sa prodigieuse beauté est plus puissante que le hideux pouvoir de la mort. Ce soir, je sens à quel point la mort me submerge. Jamais dans ma vie elle ne m’a semblé plus présente. Elle est là, tout autour de moi, comme le bourdonnement incessant d’un papillon de nuit. Mon appartement qui donne sur un cimetière. Pauline. Les carcasses répandues sur la route. Le manteau rouge de ma mère sur le sol du petit salon. Blanche. Le cancer de mon père. Les belles mains d’Angèle s’affairant sur des cadavres. Et cette femme sans visage, désespérée, attendant le passage du train sous la pluie.
Je suis heureux, si heureux, soulagé d’être un homme, de n’être qu’un homme qui, face à la mort, rêve de tripoter les seins de cette magnifique inconnue, plutôt que de fondre en larmes.
Je ne me lasse jamais de la chambre d’Angèle, son style exotique, le plafond safran, les murs d’un beau rouge cannelle. C’est un tel contraste avec la morgue où elle travaille. La porte, les montants des fenêtres et le plancher sont peints en bleu nuit. Des saris de soie brodés, orange et jaune, tiennent lieu de rideaux et de petites lanternes filigranées marocaines répandent sur le lit aux draps de lin fauve une lumière de bougie vacillante. Ce soir, des pétales de rose sont éparpillés sur les oreillers.
— Ce que j’aime chez toi, Antoine Rey, dit-elle en enlevant ma ceinture (et moi la sienne), c’est que sous ton côté romantique et bien élevé, tes jeans bien repassés et tes chemises amidonnées, tes pulls de gentleman anglais, tu n’es qu’un obsédé sexuel.
— N’est-ce pas le cas de tous les hommes ? dis-je, en me débattant avec ses bottes de motard.
— La plupart des hommes sont comme ça, mais certains plus que d’autres.
— Il y avait une fille dans le train…
— Hmm ?
Elle déboutonne ma chemise. Ses bottes tombent enfin sur le sol.
— Incroyablement séduisante.
Elle sourit en faisant glisser son jean noir.
— Tu sais que je ne suis pas jalouse.
— Oh oui, je le sais. Mais grâce à cette fille, j’ai supporté les trois interminables heures d’attente pendant lesquelles ils grattaient ce qui restait de cette pauvre femme sur les roues du TGV.
— Et de quelle façon, si je ne suis pas trop indiscrète ?
— En lisant de la poésie victorienne.
— Tu parles.
Elle rit, de ce rire de gorge si sexy que j’aime tant. Je l’attrape, la serre contre moi et l’embrasse avidement. Les pétales de rose se mélangent à ses cheveux, me tombent dans la bouche, y laissant un goût doux-amer. Je n’arrive pas à me rassasier d’elle. Je lui fais l’amour comme si c’était la dernière fois, fou de désir, fou d’envie de lui dire que je l’aime. Mais ma bouche reste muette sous nos gémissements et nos halètements.
— Tu sais quoi ? Tu devrais prendre le TGV plus souvent, murmure-t-elle, étourdie, dans le fouillis des draps où nous sommes retombés.
— Et moi, j’ai de la peine pour tous les morts que tu rafistoles. Dire qu’ils ne sauront jamais quelle bombe tu es.
Plus tard, beaucoup plus tard, après nous être douchés, après avoir grignoté des tartines de pain Poilâne avec du fromage et quelques verres de bordeaux, après avoir fumé quelques cigarettes, nous avons rejoint le canapé du salon où Angèle s’est confortablement allongée. Là, elle a fini par me demander :
— J’aimerais que tu me racontes. L’histoire de June et Clarisse.
Je sors le dossier médical, les photographies, les lettres, le rapport du détective et le DVD de mon sac. Elle m’observe, un verre à la main.
— Je ne sais pas par où commencer, dis-je, désemparé.
— Imagine que tu me racontes une histoire. Imagine que je ne sais rien, que nous ne nous connaissons pas et que tu m’expliques tout depuis le début. Comme une vraie histoire. Il était une fois…
Je lui pique une Marlboro. Mais je ne l’allume pas, je la garde entre mes doigts. Je me lève et me place devant la vieille cheminée où ne restent plus que quelques braises qui rougeoient dans l’obscurité. Cette pièce aussi me plaît, ses proportions, ses murs recouverts de livres, la vieille table de bois carrée, les volets fermés qui cachent un jardin paisible.
— Il était une fois, pendant l’été 1972, une femme mariée qui se rendait à Noirmoutier avec ses beaux-parents et ses deux enfants. Elle a deux semaines de vacances et son mari la rejoindra tous les week-ends, s’il n’a pas trop de travail. Elle s’appelle Clarisse, elle est charmante, douce, tout le contraire d’une Parisienne sophistiquée…
Je m’interromps. C’est étrange de parler de sa mère à la troisième personne.
— Continue ! me presse Angèle. C’est très bien.
— Clarisse est originaire des Cévennes. Ses parents étaient des gens simples, de la campagne. Mais elle, elle a épousé le fils d’une riche famille parisienne. Son époux est un jeune avocat aux dents longues, François Rey, devenu célèbre après le procès Vallombreux au début des années soixante-dix.
Ma voix s’éraille. Angèle a raison, c’est comme un conte. C’est l’histoire de ma mère. Après une pause, je reprends :
— À l’Hôtel Saint-Pierre, Clarisse fait la connaissance d’une Américaine appelée June, qui est plus âgée qu’elle. Comment se rencontrent-elles ? Peut-être au bar, un soir. Peut-être l’après-midi, sur la plage. Peut-être au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. June possède une galerie d’art à New York. Elle est lesbienne. Est-elle à Noirmoutier avec sa petite amie ? Est-elle venue seule ? Tout ce que nous savons c’est que… Clarisse et June tombent amoureuses, cet été-là. Ce n’est pas juste une… aventure, un amour de vacances… Ce n’est pas qu’une histoire de sexe, c’est une histoire d’amour. Un ouragan d’amour, inattendu, qui les emporte… Un véritable amour… Tel qu’on ne le vit qu’une fois…
— Allume ta cigarette, va, me dit Angèle. Ça t’aidera.
Je l’allume. Je tire une profonde bouffée. Elle a raison. Fumer me fait du bien.
— Évidemment, personne ne doit savoir. Il y a beaucoup à perdre. June et Clarisse se donnent rendez-vous quand elles le peuvent, jusqu’à la fin de 1972 et pendant l’année 1973. Elles ne se voient pas très souvent, car June vit à New York, mais elle vient tous les mois à Paris pour affaires et c’est là qu’elles peuvent se retrouver, à l’hôtel où descend June. Et puis, pendant l’été 1973, elles pensent passer du temps ensemble à Noirmoutier. Mais les choses sont compliquées, même si le mari de Clarisse est souvent absent, car il travaille et voyage beaucoup. Il y a la belle-mère, Blanche, qui, un jour, a une horrible intuition. Elle sait. Et elle décide d’agir.
— Que veux-tu dire ? s’alarme Angèle.
Je ne réponds pas. Je continue mon histoire, en me concentrant, en prenant mon temps.
— Comment Blanche est-elle au courant ? Qu’a-t-elle vu ? Un coup d’œil un peu trop appuyé ? Une tendre caresse sur un bras nu ? Un baiser interdit ? Une silhouette passant, la nuit, d’une chambre à l’autre ? Quoi qu’ait vu Blanche, elle l’a gardé pour elle. Elle ne l’a pas dit à son mari. Ni à son fils. Pourquoi ? Parce qu’elle avait honte. Honte de cette belle-fille portant le nom de Rey, mère de ses petits-enfants, qui avait une aventure, qui plus est avec une femme. Le nom de la famille Rey serait sali pour toujours. C’est inadmissible, plutôt mourir. Elle a tout fait pour la respectabilité de cette famille. Elle ne peut pas supporter que tout s’écroule. Elle n’est pas née pour voir une telle infamie. Pas elle. Pas Blanche Fromet de Passy, mariée à un Rey de Chaillot. Non, c’est tout bonnement impensable. C’est monstrueux. Il faut y mettre fin. Et vite.
Bizarrement, je reste très calme en racontant cette histoire. Je ne regarde pas Angèle, mais je devine que mon récit l’impressionne. Je sais ce que mes paroles provoquent en elle, comment elles l’atteignent, quelle est leur puissance. Je n’ai jamais prononcé ces phrases, dans cet enchaînement précis, et chaque mot qui sort est comme une naissance, quand la fraîcheur de l’air vient frapper le corps nu et fragile de l’être expulsé du ventre de sa mère.
— Blanche a une explication avec Clarisse à Noirmoutier. Cela a lieu à l’hôtel. Clarisse pleure, elle est bouleversée. Il y a une dispute dans la chambre de Blanche, au premier étage. Blanche la met en garde, elle l’intimide, la menace de tout révéler à son mari et à son fils. De lui retirer ses enfants. Clarisse sanglote, oui, oui, bien sûr, elle ne reverra plus jamais June. Elle le promet. Mais c’est impossible. C’est plus fort qu’elle. Elle revoit June, encore et encore, et lui raconte ce qui s’est passé, mais June s’en moque, elle n’a pas peur d’une vieille dame snob. Le jour où June repart pour Paris d’où elle doit s’envoler pour New York, Clarisse glisse un mot d’amour sous la porte de sa chambre. Mais June ne le trouve jamais. Il est intercepté par Blanche. Et c’est là que les problèmes commencent.

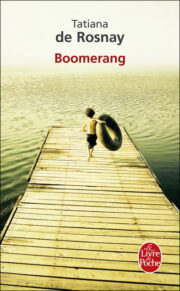
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.