Et, prenant à quatre doigts son ample robe de satin pékiné, elle fit la grande révérence qu'elle exécutait naguère sous les bravos et les bouquets de fleurs, ouvrit son éventail avec un air de tête superbe et quitta la loggia en clamant un autre extrait de son opéra préféré :
Va chercher l'Italie, errant au gré de l'onde. Il saura me venger, ce perfide élément...
Sa voix, cependant, se perdit dans les profondeurs de la vaste demeure et son époux revint à la lettre qu'il était en train d'écrire à l'ambassadeur d'Espagne à Venise, le comte de Las Casas, qui était, parmi d'autres, son correspondant privilégié et son principal bailleur de fonds. Doué d'une plume alerte, volontiers venimeuse, et d'une grande imagination, le comte d'Antraigues, émigré depuis 1790, avait trouvé ce moyen nouveau de survivre - assez largement même - tout en rétribuant les correspondants chargés d'apporter de l'eau à son moulin : une agence de renseignements au service de l'Espagne d'abord, puis d'autres pays étrangers comme l'Angleterre et la Russie.
Depuis sa naissance à Montpellier en 1753, il avait parcouru un chemin bizarre, dû surtout aux contradictions de son caractère. Appartenant à une ancienne famille du Vivarais possédant un château - La Bastide - à trois lieues au nord d'Aubenas, il tenait par sa mère, une Saint-Priest, à la noblesse parlementaire; le père de celle-ci était intendant du Languedoc et ses deux grands-pères présidents de parlements provinciaux.
Fils d'officier, il perdit son père quand il n'avait que douze ans et fut élevé par un chanoine de Troyes - l'un de ses grands-oncles était évêque de la ville -, l'abbé Maydieu, qui lui fit faire d'excellentes études classiques et lui inculqua son goût pour la République romaine inséparable du gouvernement aristocratique du Sénat. Pour le jeune garçon et dès ce moment, les concepts de " république " et de " toute-puissance de l'aristocratie " furent synonymes. Ce sera le rêve de toute sa vie. Quant à la royauté qu'il prétend défendre pendant le même laps de temps, il ne la conçoit qu'en se référant aux anciennes coutumes mérovingiennes, où les leudes élisaient ou déposaient le Roi selon leur bon plaisir. Ce qui ne l'empêche pas d'être fasciné par Versailles et, après cinq ou six ans passés aux armées d'où il démissionna, de demander à être admis aux " honneurs de la Cour ".
Ses titres de noblesse sont alors soumis comme il se doit au généalogiste Chérin, qui les refuse : pas assez anciens pour avoir le droit de monter dans les carrosses du Roi et de vivre dans son entourage immédiat. Dépité - il conservera une rancune tenace à la noblesse de la cour - il voyage, se rend à Ferney chez Voltaire, qu'il ne comprend pas, noue avec Rousseau une amitié orageuse, suivit à Constantinople son oncle Saint-Priest nommé ambassadeur, visite l'Egypte et, à son retour, Vienne et la Pologne. Il en tirera des récits de voyage qui le feront apprécier de la société parisienne à son retour en France. A Paris, il fréquente l'entourage du comte d'Artois, se lie avec les Polignac, Vaudreuil, Sérent et autres habitués de Trianon, grâce auxquels, un beau jour, il peut approcher la reine Marie-Antoinette sur laquelle il fonde de grandes espérances.
En effet, il se sait bel homme, plutôt séduisant et, comme il est assez fat, il se croit irrésistible. Au contraire de ce qu'il espère, il déplaît très vite à Marie-Antoinette : il y a en lui une intense fureur de vivre, une révolte contre toute contrainte, qu'elle soit politique ou religieuse, et un esprit libertin qui choquent la souveraine. Non seulement, elle repousse ses avances mais refuse de le rencontrer davantage. Il ne lui pardonnera jamais et nourrira, dès lors, une haine constante, attentive, patiente comme Marie-Antoinette en suscita souvent, une haine trop semblable à celle du mar- quis de Pontallec pour que les deux hommes ne se rejoignent un jour. Pour lui, le Roi est une brute, la Reine une catin et il cristallisera sur eux son exécration d'un pouvoir royal qui ne soit pas aux ordres de sa noblesse terrienne.
Philosophe à Paris où l'on apprécie ses libelles et pamphlets, il n'en redevient pas moins " féodal " sur ses terres du Vivarais, où il se rend assez souvent auprès d'une mère inquiète de voir évoluer de façon si peu habituelle la tournure d'esprit de son fils. Inquiète surtout de ses relations affichées avec la cantatrice Antoinette de Saint-Huberty qui fait à l'Opéra la pluie et le beau temps.
Élu député aux États généraux, il accueille la Révolution avec la joie de qui pense s'y tailler la part du lion, mais ses contradictions intimes lui feront prendre du champ assez vite. En dépit de son " libéralisme affiché " et de ses " idées éclairées " il a voté contre la suppression des privilèges durant la nuit du 4 août et fait montre d une certaine hostilité envers La Fayette. Il n'a d'ailleurs jamais éprouvé la moindre sympathie pour les combattants de l'Indépendance américaine. Il a fait paraître Mémoires sur les États généraux, qui rencontre un grand succès de librairie : selon l'état d'esprit dans lequel on le lit, chacun peut y trouver pâture à son goût. Fier de ce succès, il propose alors de mettre sa plume - moyennant une pension ! - au service du Roi. Celui-ci, sur le conseil du baron de Breteuil qui se méfie d'Antraigues, décline l'offre. Qu'à cela ne tienne : le comte la mettra au service de Monsieur dont il se rapproche. C'est ainsi qu'en 1790, il se trouve compromis dans l'affaire Favras (un projet d'enlèvement du Roi pour le remplacer par le comte de Provence); devinant que la corde qui avait pendu Favras risquait de s'approcher de son propre cou, il demande " un congé de quelques semaines " à l'Assemblée constituante et quitte la France sous le prétexte de faire soigner son foie par le fameux docteur Tissot de Lausanne. Il s'y installe momentanément et publie contre l'Assemblée nationale un pamphlet qui ne remplit guère sa bourse.
Celle-ci se trouvait même d'une platitude affligeante. Il ne touchait plus, naturellement, les droits seigneuriaux issus du Vivarais qui constituaient la presque totalité de sa fortune et ses droits d'auteur étaient dévorés. Il fallait trouver une solution; Antraigues la trouva en décidant d'épouser la Saint-Huberty à qui ses cachets et ses tournées, en France et dans les pays voisins, avaient rapporté et rapportaient encore une jolie fortune. Il lui écrivit de venir le rejoindre, elle accourut en mai 1790, donna quelques concerts et accepta finalement - avec une extrême jubilation intérieure - de devenir comtesse d'Antraigues, une élévation inespérée pour une fille d'opéra, révolution ou pas, et dont la comtesse mère de Louis-Alexandre pensa mourir de chagrin dans son Vivarais lorsqu'elle en eut connaissance.
Mais, s'il désirait rester en Suisse, Antraigues souhaitait aussi se rapprocher de la cour de Turin où, au début de l'émigration, le comte d'Artois avait trouvé refuge chez son beau-père. Ce prince légèrement farfelu présentait, pour Antraigues, le type idéal du roi tel qu'il le souhaitait : une marionnette entre les mains des grands qui détiendraient la réalité du pouvoir. Le comte était en effet de ceux pour qui la Fronde avait écrit une grande page d'histoire malheureusement avortée. Il alla donc s'installer à Mendrisio, chez l'un de ses amis, le comte Turconi, qui lui offrait Castel San Pietro comme résidence : c'est là que, le 29 décembre 1790, il épousait Antoinette Saint-Huberty. Là aussi qu'il eut la brillante idée de se mettre au service de l'Espagne en tant qu'agent de renseignements touchant tout ce qui concernait les affaires de la France. Ce qui peut paraître un paradoxe étant donné la distance entre son refuge et le pays natal, et le fait qu'il redoutait par-dessus tout d'y remettre les pieds. En ce qui concernait le monde des émigrés, il était facile à Antraigues qui, de 1790 à 1792, voyagea beaucoup entre Mendrisio, Turin, Milan et Venise, de justifier vis-à-vis de Las Casas les sommes d'argent qu'on lui versait. Ce l'était moins pour la France, encore que les journaux - et il y en avait beaucoup à l'époque - circulassent assez facilement, mais ce que voulait le comte, c'était être au cour de la politique, savoir ce qui se passait à l'Assemblée, chez les ministres, chez le Roi bien entendu puisqu'il était encore aux Tuileries, et, dans ce but, il eut l'idée de fonder un réseau de renseignements. Il avait gardé des amis, en France, qui voyaient en lui un grand esprit politique et il sut les convaincre de travailler pour lui. C'était le chevalier des Pommelles, retiré de l'armée et servant de secrétaire à deux députés de la Constituante; Pierre-Jacques Lemaître, d'une famille de négociants rouennais enrichis dans la traite des Noirs, qui avait la conspiration dans le sang, fourrait son nez partout, ce qui lui avait déjà valu quelques séjours en prison; il avait tout de même réussi à acheter la charge de secrétaire des Finances qui lui donnait l'occasion d'écrire de violents pamphlets contre son ministre. Enfin Duverne de Praile qui, lui, avait fait la guerre d'Indépendance américaine et possédait des relations dans tous les milieux politiques. Ces trois hommes avaient appartenu, comme Antraigues lui-même, comme le vicomte de Mirabeau (le frère du tribun), comme le chevalier de Jarjaye, l'abbé Brottier, beaucoup d'autres... et Batz lui-même, au Salon français, un club fondé en 1788, qui dès 1790 réunissait les royalistes les plus hostiles à toute réforme avec des nuances devenant des failles et des antagonismes : d'un côté les fidèles du Roi, de l'autre les tenants des Princes, à commencer par Monsieur.
C'est donc avec ces trois hommes qu'Antraigues lança son réseau. Leurs rapports prenaient la forme d'innocentes lettres commerciales écrites en lignes espacées permettant d'en ajouter une entre elles avec une " encre sympathique ", en l'occurrence du jus de citron qui se révèle en chauffant le papier. Le courrier partait par Troyes et se grossissait parfois de messages en provenance d'un autre affilié, Nicolas Sourdat, ancien lieutenant général de police de Troyes, qui au début avait prisparti ostensiblement pour la Révolution. Grâce à lui, Antraigues n'ignorait rien de ce qui se passait en Champagne ni d'ailleurs ce qui se passait en Provence, grâce encore à un certain Sautayra, député de la Drôme à la Constituante puis à la Législative, dont les apparentes convictions révolutionnaires ne furent jamais suspectées, ce qui par la suite le rendit extrêmement précieux...

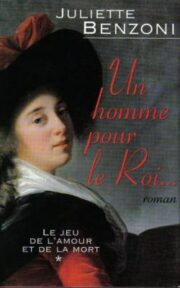
"Un homme pour le Roi" отзывы
Отзывы читателей о книге "Un homme pour le Roi". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Un homme pour le Roi" друзьям в соцсетях.