— Même pas. Je ne vous prends rien puisque vous ne les avez jamais eus et Son Altesse n’en a vraiment plus besoin…
— Et ce papier pour le notaire. Vous ne devez pas le lui remettre ?
— Je l’enverrai par la poste avant de quitter l’Europe ! À présent, mon cher comte, nous nous sommes, je crois, tout dit et comme je n’ai aucune envie que vous me couriez après…
Il relevait son revolver mais il n’eut pas le temps d’appuyer sur la gâchette. Un coup de feu éclata et, avec sur le visage une immense surprise, Fritz von Taffelberg s’écroula tandis que Morosini, suivi d’un Giuseppe tellement bouleversé que ses dents claquaient, faisait son entrée dans la chapelle salué par un hurlement de fureur : le Turc fonçait sur lui comme le rocher d’une avalanche, ses énormes mains en avant.
— Attention ! hurla Manfredi, mais Aldo était sur ses gardes.
Il esquiva comme le matador devant la charge du taureau et Achmet, emporté par son élan, alla s’assommer contre les tôles du fourgon.
C’était une telle force de la nature qu’il fut seulement étourdi mais ce fut suffisant pour que Morosini, Manfredi et Giuseppe se ruent sur lui d’un accord tacite et le réduisent à l’impuissance avec les cordes dont on venait de se servir. On le rentra dans la chapelle, on l’assit contre un pilier et on revint à l’acteur principal qui, lui, ne donnait plus signe de vie. Aldo s’agenouilla, prit son pouls.
— Il… il est mort ? émit Giuseppe d’une voix chevrotante.
— Tout à fait ! Je n’avais pas l’intention de le tuer mais, dans l’urgence, j’ai trop bien tiré peut-être…
— Vous n’allez pas le regretter, j’espère ? s’écria Manfredi. Si vous ne l’aviez abattu, il me tuait. Mon cher prince, je vous dois la vie ! Mais qu’allons-nous faire de lui ? Et du prisonnier ?
— On va prévenir la police, fit Giuseppe.
— Vous êtes fou, mon ami ! Que voulez-vous que nous lui racontions ? dit le comte. Le mieux serait peut-être… d’éliminer aussi cet homme ?
— Ne comptez pas sur moi pour ça, fit Morosini sèchement. Jamais je ne tuerai de sang-froid. Surtout un homme sans défense !
— Retirez-lui ses liens et vous verrez s’il est sans défense ! Si nous n’avions réussi à le maîtriser, il nous assommait tous.
S’éleva alors, derrière eux, une voix de basse taille s’exprimant comme les autres en italien :
— Sûrement pas ! Je voulais seulement vous ôter de mon passage afin de pouvoir fuir avec le fourgon, dit Achmet qui semblait curieusement détendu.
— Fuir où ? demanda Morosini. En Amérique ?
— Non. Je voulais rentrer chez moi, à Istanbul… maintenant que je suis libre !
— Ne l’étiez-vous pas ? Un serviteur n’est pas un esclave, que je sache, et vous étiez entièrement dévoué à Taffelberg.
— Moi, j’étais esclave. Il faut vous dire qu’il y a cinq ans, j’ai commis un crime. Le baron m’a sauvé du bourreau à condition que je devienne son serviteur aveugle et sourd. Dévoué, quoi !…
— Il vous avait fait signer des aveux complets de la faute commise et gardait ce papier par-devers lui ? avança Alberto Manfredi.
Dans ses liens le Turc se redressa et, dédaignant celui qui venait de parler, il planta ses yeux noirs dans ceux de Morosini.
— Non. Pas de papier ! Il avait ma parole et savait que je n’y manquerais jamais. Je suis peut-être un meurtrier mais je suis, avant tout, un homme d’honneur. Cette parole, je vous la donnerai à vous si vous me laissez partir librement vers mon pays. Personne ne saura jamais rien de ce qui s’est passé ici !…
Il y eut un silence. Les trois autres protagonistes de la scène pesaient ce qu’ils venaient d’entendre. Enfin, le comte émit en haussant les épaules :
— C’est un peu mince comme garantie, vous ne trouvez pas ?
— Non, fit Aldo dont le regard ne quittait pas celui du prisonnier. Non, je ne trouve pas. À moi sa parole suffira… ou alors je ne sais plus juger un homme…
— Vous voulez le libérer ? Qui vous dit qu’il ne nous sautera pas dessus aussitôt ? Nous ferions mieux de le livrer à la police.
— Vous rêvez, mon cher comte ! Vous imaginez la police pataugeant dans cette histoire plus que bizarre ? À moins que vous n’ayez vraiment envie de faire connaissance avec les prisons helvétiques ? Elles ne doivent pas être beaucoup plus confortables que les autres et, en outre, si votre femme doit rester en dehors de tout ceci, vous auriez gagné…
Sans attendre la réponse, il se pencha pour libérer Achmet de ses liens et l’aida même à se relever en concluant :
— À moi sa parole suffira et j’en prends la responsabilité…
Debout, le Turc considéra ce prince qui refusait de le traiter en malfaiteur et s’inclina devant lui.
— Merci, seigneur ! Vous avez la parole d’Achmet Chelebi. Vous me rendez la liberté et je ne l’oublierai pas. Mais, avant de partir, je vais vous aider.
Il alla prendre, dans le véhicule, l’une des couvertures que les routes de montagnes avaient rendues nécessaires. Puis, après en avoir vidé soigneusement les poches, il enveloppa soigneusement le cadavre qu’il alla déposer dans la tombe ouverte à la place que le défunt avait réservé à Manfredi, après quoi il combla la fosse avec une partie de la terre et, aidé cette fois par Giuseppe, replaça les dalles que les deux hommes tassèrent de tout leur poids.
— À présent, dit-il, il faut disperser ce qui reste de terre. Avez-vous une brouette ?
Giuseppe se chargea d’aller en chercher une à laquelle il joignit deux balais et, toutes ses craintes définitivement envolées, aida le Turc à nettoyer la chapelle. Quand ils eurent fini, plus rien ne laissait supposer qu’il s’était passé quelque chose en cet endroit tant le travail était bien fait.
— La porte refermée, je jetterai la clef, dit Manfredi. Ainsi il se passera un moment avant que quelqu’un entre ici…
— Vous pouvez partir maintenant, dit Aldo au Turc. Je vous souhaite de longues années dans votre pays. Des années de paix… et d’oubli.
— J’ai déjà tout oublié…
Et il partit vers son destin avec, au fond des yeux, cette flamme qu’allume toujours le sentiment de la liberté retrouvée.
— Les papiers sont en règle, dit Morosini en le regardant démarrer doucement. Avec la valeur du fourgon et ce qu’il emporte, il va pouvoir recommencer une vie dans son propre pays.
— Grâce à vous, mon cher prince, cette dangereuse affaire finit bien, soupira Manfredi. Mais Dieu, que j’ai eu peur !
La nuit était bien avancée quand Giuseppe, redevenu le parfait serviteur, un rien compassé, qu’il était auparavant servit aux deux hommes un merveilleux café accompagné de quelques sandwichs avant de se retirer avec discrétion. Manfredi, alors, alla prendre le sac de velours noir sur la table où il l’avait abandonné, l’ouvrit et en tira, un à un, les joyaux qu’il disposa sur le bois poli. Ses gestes étaient doux, respectueux même, pourtant Morosini nota que ses mains tremblaient de nouveau. Quand ce fut fait, il prit les émeraudes fatidiques et vint les donner à Aldo.
— C’est ce que vous vouliez, n’est-ce pas ? Je crois que vous les avez bien gagnées !
Ce furent alors les mains d’Aldo qui frémirent quand les « sorts sacrés » touchèrent ses paumes mais il les referma dessus avec un inexprimable sentiment de joie et de victoire : il tenait enfin la rançon de Lisa ! Cet instant le payait de ces mois d’angoisse, de peines, de durs travaux, de désespoir même. Il allait retrouver son bonheur !
— Merci, dit-il seulement.
Avec un geste qui balayait toute gratitude, Alberto Manfredi retournait vers la table où étincelaient toujours la tiare, le collier, les bracelets et les bagues. Il les contempla tandis qu’Aldo se resservait du café, passa dessus un doigt précautionneux :
— Qu’en feriez-vous à ma place ? demanda-t-il.
— Ce ne sont pas les banques qui manquent en Suisse, sourit Morosini. Toutes pourvues de coffres inviolables et de toute façon vous en avez sûrement un. C’est là qu’il faut les déposer au plus vite car je ne vois pas quelles explications vous pourriez donner à votre femme si elle les voyait.
— Et si… si vous les emportiez ?
— Moi ? Mais pour quoi faire ? Si vous n’avez pas de coffre, louez-en un !
— Ce n’est pas cela…
Il semblait tout à coup si gêné qu’Aldo se demanda ce qu’il avait derrière la tête. Il allait poser une question quand Manfredi demanda :
— À votre avis, est-ce que je peux en disposer à mon gré ?
Cette fois Morosini commençait à comprendre mais n’en fit rien paraître :
— C’est selon la façon dont on voit les choses. Si l’on s’en tient à la lettre des volontés de la grande-duchesse, vous devez les conserver par-devers vous comme un précieux souvenir de vos amours avant de les ensevelir avec vous, lorsque vous irez dormir auprès d’elle votre dernier sommeil…
— Mais je n’ai pas la moindre intention de me faire enterrer auprès d’elle. Surtout en compagnie de qui vous savez. Et c’est d’ailleurs impossible : nous irons à Vérone, moi et ma femme ! s’écria Manfredi avec impatience.
— Calmez-vous ! Je n’en doute pas, sinon ce que nous venons de faire ne servirait à rien. En outre, l’intention de nuire était patente chez la grande-duchesse quand elle vous a fait ce cadeau à la fois magnifique et empoisonné. Je pense qu’une fois la lettre de décharge partie pour Bregenz avec nos signatures – c’est moi, bien entendu, qui vais remplacer Achmet comme témoin – le notaire la classera. L’oubli et la poussière commenceront leur œuvre…
— Oui, mais, quand je mourrai moi-même, ce notaire ou son successeur pourraient demander une vérification et…
— … et ce serait difficile si les joyaux sont vendus ? C’est pour cela, n’est-ce pas, que vous souhaitez me les confier ?

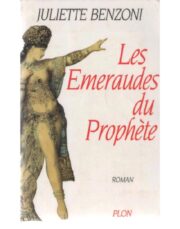
"Les Émeraudes du prophète" отзывы
Отзывы читателей о книге "Les Émeraudes du prophète". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Les Émeraudes du prophète" друзьям в соцсетях.