Le soleil en question brillait joyeusement sur l’indigo scintillant de la Méditerranée, pourtant en regardant s’éloigner le vieux minaret de Jaffa, Aldo ressentit une sorte de déchirure parfaitement désagréable. La lettre de Lisa disait qu’elle n’était plus dans la Ville Sainte et il voulait bien la croire mais il n’en était pas moins persuadé qu’elle était quelque part dans cette terre de Palestine qui s’étirait jusqu’aux déserts derrière les sables et les rochers de cette côte séduisante. Un jour – le plus tôt possible ! – il faudrait bien qu’elle la lui rende… En attendant, c’était bigrement dur de s’éloigner !…
Deuxième partie
LA VOYANTE
CHAPITRE IV
LA MAISON VIDE
La bibliothèque municipale de Dijon se partageait avec l’école de droit, dans la rue du même nom, les bâtiments de l’ancien collège des Godrans où les Jésuites dispensaient jadis la culture solide dont bénéficièrent Bossuet, Buffon, Crébillon, La Monnoye, Piron et quelques autres grands esprits des XVIIe et XVIIIe siècles. Les maîtres avaient disparu, chassés par une République sourcilleuse mais le savoir restait dans les multiples armoires et rayonnages dont étaient garnis les murs de l’ancienne chapelle aux belles voûtes arrondies. C’est là qu’au terme d’un voyage ferroviaire épuisant en dépit du confort raffiné de l’Orient-Express, atterrirent Morosini et Vidal-Pellicorne.
Le maître des lieux était alors un charmant vieux monsieur à barbiche poivre et sel, tiré à quatre épingles dans un veston noir de bon faiseur et qui, avec ses guêtres grises et ses mains soignées, s’accordait au noble décor. Il reçut ses visiteurs avec cette courtoisie, ce grand ton de politesse dont la province semblait avoir gardé le secret après une guerre dévastatrice sur tous les plans et dans ces années folles où il paraissait urgent d’oublier le passé, tous les passés. M. Gerland, lui, savait encore accueillir, avec un solide accent bourguignon, un archéologue connu et une altesse vénitienne experte en joyaux célèbres qui ne l’était pas moins.
Naturellement, l’ouvrage du voyageur bourguignon du XVe siècle faisait partie de ses trésors et, après une courte attente, il vint déposer sur son bureau un superbe in-quarto portant sur sa couverture de velours rouge orné de plaques d’argent les grandes armes du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Morosini leva un sourcil surpris :
— Oh, le manuscrit original ?
— En effet. C’est celui que La Broquière offrit à son maître au retour de son voyage. J’ai pensé que vous seriez heureux de le voir !
— Une pensée bien délicate, monsieur, dit Aldo en posant ses longues mains à la fois fortes et fines sur le précieux volume pour le caresser…
— … mais, enchaîna Adalbert, le vieux français est d’une lecture malaisée pour qui ne sort pas de l’école des Chartes. Vous n’auriez pas un exemplaire plus récent, plus lisible… et moins précieux ?
Un nuage passa sur l’aimable visage si doucement fleuri du conservateur :
— C’est que, justement, nous n’en avons plus. Celui de la bibliothèque nous a été volé il y a six mois environ…
— Par qui ? firent les deux amis d’une même voix.
M. Gerland eut un geste traduisant l’impuissance :
— En réalité, nous l’ignorons. Nous avions recruté à ce moment un jeune bibliothécaire bardé de diplômes et très recommandé par le ministre de l’Instruction publique mais il était de santé fragile et le climat bourguignon est continental, donc un peu plus dur que celui de la région parisienne. Il nous a quittés assez vite…
— Et il est parti avec votre livre ? fit Morosini avec un sourire.
— Nous n’en sommes pas sûrs, cependant il y a de fortes chances. En fait, nous ne nous sommes pas aperçus tout de suite de cette disparition. Au moment où ce jeune homme est parti, il a été porté sur nos livres prêté exceptionnellement à une personnalité de Dijon qui ne peut se déplacer et que nous connaissons bien… et qui ne l’a jamais reçu. Son secrétaire était même fort mécontent de se trouver mêlé sans en avoir la moindre idée à ce que l’on ne peut appeler qu’un vol. D’ailleurs, le ministre de l’Instruction publique ne connaissait même pas ce jeune Armand Duval…
— Et il avait une maîtresse nommée Marguerite Gautier ? s’écria Vidal-Pellicorne en riant franchement. Il ne nous manquait plus que la Dame aux Camélias !
M. Gerland, lui, ne riait pas. Le coup d’œil qu’il lança à cet archéologue hilare était même plutôt sévère.
— J’avais remarqué, moi aussi, mais il disait appartenir à la famille des « bouillons » bien connus et sa mère, qui admirait beaucoup Dumas Fils, avait tenu à lui donner ce prénom romantique. Seulement, ajouta-t-il d’un ton penaud, je crois qu’il s’agissait encore d’un conte et qu’il ne s’appelait pas du tout Armand Duval… En fait, j’ignore son identité réelle.
— Ne vous faites surtout aucun reproche, dit Morosini gentiment, il existe de par le monde nombre de gens fort habiles à changer de personnalité. Cependant… Pourriez-vous nous le décrire… au cas où il nous arriverait de le rencontrer…
Avec beaucoup de bonne volonté, le conservateur brossa un portrait qui, malheureusement, pouvait convenir à pas mal de monde : environ vingt-cinq ou vingt-six ans, blond, les yeux gris, mais il finit par entrer tout de même dans des détails prouvant un honnête sens de l’observation. Ainsi de la taille sur laquelle M. Gerland était formel : un mètre quatre-vingt-trois. En outre le menton volontaire se partageait sur une profonde fossette et les mains aux doigts longs et déliés eussent été belles si, justement vers le bout, ces doigts ne se spatulaient légèrement…
Comme le fit remarquer Adalbert, on n’était pas là pour courir sus à un émule d’Arsène Lupin mais bien pour connaître la suite de certain passage du livre de La Broquière. Il allait falloir interroger le manuscrit :
— Nous recherchons, avoua honnêtement Morosini, deux pierres précieuses dont il est fait mention dans ce livre. J’ai eu en main un exemplaire mais on me l’a enlevé avant que j’aie pu lire la page suivante.
— Sauriez-vous me dire à quelle époque du récit cela se situait ?
— Oui. En 1432, à Damas, La Broquière venait de rencontrer Jacques Cœur…
— Ce sera facile à trouver. Veuillez patienter un instant !
Il quitta son cabinet de travail avec toute la dignité convenant à son personnage et revint quelques minutes plus tard accompagné d’un vieillard ressemblant comme un frère au Moïse de Claus Sluter dont le puits formait l’un des principaux ornements de l’ancienne sépulture des ducs de Bourgogne, la Chartreuse de Champmol sise aux portes de Dijon : l’immense barbe à deux pointes enveloppait tout le terrible faciès au regard impérieux ouvert sur un avenir dont il rendait la profondeur. Les deux visiteurs eurent beaucoup de mal à garder leur sérieux quand on leur présenta M. Lafleur, un nom allant aussi mal que possible à l’impressionnant personnage auquel d’ailleurs M. Gerland parlait avec un respect qui n’eut pas l’air d’améliorer son humeur. Le « grand archiviste paléographe » venait d’être dérangé d’une importante occupation et le faisait sentir. Il attrapa le vénérable manuscrit, chercha la page demandée d’un doigt aussi désinvolte que s’il avait consulté l’annuaire des chemins de fer, relut en traduisant simultanément les phrases déjà connues et continua :
— « Nous eûmes forte impression de ce prince dont nous sûmes le trépas au jour suivant. Il fut vilainement meurtri et navré dans les étuves de son palais après quoi beaucoup de gens furent mis à mort mais sans que l’on eût la certitude que le meurtrier soit parmi eux. Plus tard, une chose merveilleuse est advenue alors que, dans la ville d’Andrinople, nous fut donné l’honneur d’être présenté au sultan Murad, deuxième du nom, à qui venait de naître un troisième fils du nom de Mehmed. Et c’est alors que nous pûmes voir briller sur sa poitrine de part et d’autre d’une grosse perle les smaragdins que portait naguère encore le prince de Damas mais, craignant quelque sombre secret, nous ne cherchâmes pas à en apprendre plus avant.
La suite ne présentait plus d’intérêt pour les visiteurs. Ils remercièrent le savant traducteur qui ne leur accorda, en échange, qu’un grognement dont on ne savait trop s’il était de satisfaction ou d’indifférence avant de se ruer vers la porte en faisant voltiger les basques de sa redingote, puissant et redoutable comme Léviathan en personne. La séparation d’avec l’aimable M. Gerland fut infiniment plus courtoise, après quoi l’on regagna l’hôtel de la Cloche qui était alors l’un des meilleurs de France… Là, tout en dégustant un plat d’escargots fleurant bon l’ail, arrosés d’un joli Chablis, et un somptueux coq au Chambertin accompagné du même, on fit le point de la situation :
— Cela fait peut-être beaucoup de kilomètres pour une mince information, constata Adalbert, mais je ne les regrette pas, car ce que nous venons d’apprendre nous donne une bonne chance de remonter l’Histoire assez rapidement.
— Ce qui veut dire ?
— Que si les émeraudes sont entrées, avec Murad II, dans le trésor des sultans ottomans, il y a une grande chance pour qu’elles y soient encore. Ces gens-là n’ont jamais lâché facilement ce sur quoi ils mettaient la main. Tu connais un peu leur histoire ?
— Pas trop mal à partir de Mohammed II mais guère avant.
— Eh bien, il ne t’en manque pas beaucoup parce que ton Mohammed n’est autre que le gamin Mehmed qui vient de naître à Andrinople au moment où La Broquière s’y trouvait. Il n’était alors que le troisième fils de Murad mais, par la mort de ses deux frères, il est devenu le premier. C’est l’homme qui, à vingt et un ans, conquit Byzance au moyen d’un fantastique coup d’audace : en faisant passer ses galères du Bosphore dans le port de la Corne d’Or en franchissant, de nuit, la colline sur des rondins huilés et enduits de savon. Un tel homme n’a jamais lâché ses proies et nous avons peut-être une chance de retrouver nos pierres dans le trésor du sérail à Istanbul…

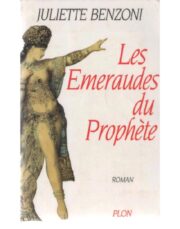
"Les Émeraudes du prophète" отзывы
Отзывы читателей о книге "Les Émeraudes du prophète". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Les Émeraudes du prophète" друзьям в соцсетях.