— Je suis certain que vous n’avez rien à vous reprocher ! À présent il faut vous reposer. Sers, Potentin ! Et prépare des chambres…
— C’est déjà fait… Le petit garçon aussi est fatigué : Béline le couchera dès qu’il aura fini son repas…
Il était tard, ce soir-là, et presque tout le monde était couché à l’exception de Potentin qui aidait Clémence à remettre de l’ordre dans sa cuisine, lorsque Guillaume ouvrit son journal dans l’intention d’y noter, selon son habitude, les menus faits de la journée. Pourtant, s’il tailla une plume et la trempa dans l’encre, il ne se décida pas à la mettre en contact avec le papier. Après être resté un moment un coude sur la table et la main en l’air, il reposa la mince penne blanche, se laissa aller sur le dossier de son fauteuil et ferma les yeux. Comment rendre ce qu’il avait entendu de la bouche du bailli, ce récit singulièrement évocateur mais dangereux au cas où sa maison viendrait à être envahie, fouillée par les gens de Buhot ou de Lecarpentier qui, depuis Cherbourg, mettait le Cotentin en coupe réglée ? Même mentionner l’arrivée du bailli et de son « neveu » risquait de conduire à des conclusions périlleuses. Mieux valait sans doute remettre à plus tard : les conjurés s’étaient donné beaucoup de mal pour brouiller les pistes, allant même jusqu’à faire partir, en même temps que le petit roi, un autre enfant en direction de la Vendée et du camp de M. de Charette. Il fallait que le secret fût gardé peut-être pendant des années encore, les ennemis les plus redoutables de l’enfant n’étant pas les plus évidents ainsi que le prouvait l’étrange histoire de l’évasion, œuvre d’une poignée de fidèles mais orchestrée en sous-main par certains des puissants du jour et singulièrement le plus inattendu : Hébert, le sulfureux rédacteur du Père Duchesne, le torchon révolutionnaire qui ne cessait d’insulter en réclamant du sang.
Qui aurait pu imaginer que ce petit homme de trente-six ans propre, toujours soigneusement habillé, bon époux et bon père – noble d’ailleurs par sa mère ! – aimant la bonne chère et les petits salons, pût jouer un double jeu, affichant tant de haine mais cherchant, surtout depuis la mort de la Reine, à préserver ses acquis ? Intelligent, au surplus, Hébert savait bien que la Terreur ne durerait pas toujours et qu’il serait peut-être bon de se réserver une position de repli. Enlever l’enfant du Temple, le mettre à l’abri, s’avérerait peut-être la meilleure garantie pour ses vieux jours…
En 1791, il avait épousé une ancienne religieuse du couvent de la Conception-Saint-Honoré : Marie-Françoise Goupil, Normande d’Alençon comme lui-même et sans doute fille naturelle d’un des plus valeureux généraux de la Révolution. Alexis Le Veneur, vicomte de Carrouges, paya pour elle jusqu’à son mariage la pension du couvent. Il était un parent du bailli de Saint-Sauveur.
Marie-Françoise Hébert était bonne républicaine mais demeurait secrètement attachée à la religion. Ainsi, s’efforçant de gagner des femmes aux idées nouvelles, l’ancienne religieuse de chœur prenait toujours ses citations dans les Évangiles. Cela lui valut d’intéresser l’un des plus fameux conspirateurs du temps : le baron de Batz, descendant de d’Artagnan, financier retors, âme trouble mais déterminée et vouée au sauvetage de la famille royale. C’est Batz, homme-Protée, toujours entre deux déguisements, qui tenta d’enlever Louis XVI sur le chemin de la guillotine, de soustraire sa famille tout entière au Temple, de fomenter avec le chevalier de Rougeville le fameux Complot des Œillets pour arracher la Reine à la Conciergerie.
Hébert savait bien qui était ce gentilhomme prêt à tout pour la royauté et qui s’efforçait, à coups d’agiotages, de pourrir les chefs révolutionnaires. Marie-Françoise, elle, ne connaissait Batz que sous l’apparence d’un certain abbé d’Alençon, homme doux et sans malice, dans le sein duquel il lui arrivait d’épancher ses scrupules et ses états d’âme. C’est cet homme de bien qui servit de lien entre le journaliste et ceux qui s’étaient juré d’arracher de sa prison le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
L’âme de ceux-ci était une Anglaise fort riche. On l’appelait Mme Atkins. Née Charlotte Walpole, c’était une ancienne actrice du théâtre de Drury Lane qui, de l’avoir approchée plusieurs fois, avait conçu pour la reine Marie-Antoinette un attachement quasi fanatique. Au point de s’être introduite un jour dans le cachot occupé par son idole à la Conciergerie pour lui proposer d’échanger leurs vêtements et de prendre sa place jusque sur l’échafaud. La Reine, bien sûr, avait refusé mais conjuré cette amie si dévouée de sauver au moins la vie de son fils et, surtout, « de ne le remettre jamais à ses oncles qui souhaitaient le voir mort ».
L’extrême liberté dont jouirent à Paris les Anglais et les Américains jusqu’à l’automne 1793 permit à Charlotte Atkins de préparer des plans. Bien qu’elle fût obligée de retourner parfois en Angleterre, elle était liée avec ceux de l’Ouest attachés au même combat : le marquis de Frotté et, surtout, un avocat breton, Yves Cormier, très riche lui aussi par son mariage et qui habitait l’enclos du Temple. Ce furent lui et l’Anglaise qui fournirent l’argent destiné à Hébert et aux préparatifs de l’enlèvement. Très soigneusement monté d’ailleurs !
Depuis juillet 1793, l’enfant-roi, arraché à sa mère, s’était vu confié au cordonnier Simon et à sa femme dans le but d’en faire un « vrai républicain ». Étrange changement d’existence pour un petit garçon de huit ans, élevé à Versailles entre une mère idolâtre et une cour de femmes empressées à lui plaire ! En dépit des soins de la femme Simon, tout de suite séduite et qui s’attacha à lui, le contact d’un homme tel que son nouveau « gouverneur » ne pouvait que le terrifier. On lui apprit des jurons, des injures, des mots dont il ne comprenait pas la signification. On lui fit boire du vin, parfois jusqu’à lui brouiller les idées. Fût-il resté plus longtemps qu’on en eût fait un voyou accompli ! Heureusement, le cordonnier n’eut pas le temps de poursuivre cette éducation dont il était si fier !
Au début de l’année, à la surprise générale, il décida d’abandonner une fonction éminemment lucrative pour reprendre son ancien poste de commissaire de section qui ne lui rapportait rien. Et le 19 janvier, les Simon quittaient leur logis de la Tour pour un petit appartement dans l’enclos du Temple :
— Le déménagement de Marie-Jeanne Simon fut une sorte d’événement, raconta le bailli. En dépit de son asthme et d’un embonpoint excessif elle passa sa journée à monter et descendre pour veiller à l’entassement de ses hardes dans la charrette qui attendait dans la cour enneigée. Elle semblait heureuse de s’en aller en dépit du fait qu’elle laissait là l’enfant qu’elle disait aimer. Sans doute pour le consoler, on avait envoyé la veille un grand cheval de bois et de carton. À l’intérieur, il y avait un garçon endormi qui par la taille, les cheveux et quelques traits ressemblait un peu au prince. C’est celui-ci que l'on montra, toujours endormi, aux commissaires de service, quatre nouveaux comme par hasard, et dont ils donnèrent décharge. Il était alors neuf heures du soir. Il faisait très froid et un épais brouillard régnait quand la charrette des Simon franchit les corps de garde et s’éloigna vers le nouvel appartement où nous attendions… Ils emportaient avec eux un lourd secret et aussi le fameux cheval de bois sous prétexte que le jeune « Capet » en avait peur. Avant l’aube, nous quittions Paris, lui et moi, dans une charrette transportant des tonneaux. Nous allions jusqu’à une maison amie dont vous comprendrez que je préfère taire le nom. D’autres relais avaient été disposés…
— Mais l’enfant que vous laissiez derrière vous ? Il a bien dû parler, se plaindre, protester, que sais-je ?
— C’est possible. Certain même ! Le subterfuge n’a peut-être pas résisté bien longtemps. Je ne pense pas cependant que ce soit la raison de l’arrestation d’Agnès. Depuis quelques semaines, elle habitait chez moi, au Temple, mais trois ou quatre jours avant l’enlèvement, nous avions eu, l’un et l’autre, l’impression d’une sorte de surveillance. C’est pourquoi j’ai voulu l’empêcher d’y retourner cette fameuse nuit mais elle n’a rien voulu écouter : il fallait qu’elle retrouve Gabriel…
— Elle lui était attachée depuis l’enfance ; c’est un sentiment qui peut se comprendre. Mais vous disiez qu’elle partageait votre appartement depuis quelques semaines seulement ? Où s’est-elle donc installée quand elle est partie d’ici ?
— Rue de Lille, chez Mme Atkins à qui je l’ai présentée. Toutes deux s’entendaient fort bien. La ferveur royaliste d’Agnès plaisait à cette noble femme et je ne vous cache pas que l’idée d’amener le Roi ici est née entre deux tasses de thé. Seulement, quand, en septembre dernier, la Convention a pris un décret considérant comme otages les Anglais résidant en France, Charlotte Atkins est passée en Suisse. Votre femme n’a pas voulu la suivre et m’a rejoint… J’espère de tout mon cœur que l’avocat Cormier réussira à la tirer de ce mauvais pas. Je ne vois d’ailleurs pas ce qu’on pourrait lui reprocher de grave : elle s’est contentée de porter des billets, rendre quelques visites…
— Vous trouvez que ce n’est pas grave ? C’est mortel que vous devriez dire, bailli ! Quels sont les crimes de ceux qui meurent chaque jour sous le couteau de la guillotine ?…
Donc, ce soir-là Guillaume, n’écrivit rien. Par contre, il rêva beaucoup. Pas au périlleux honneur qui incombait à sa demeure mais à Agnès. En dépit de ce qui les séparait, de ces embûches où s’était brisée leur entente peut-être trop fragile et surtout de ce désert d’indifférence dont la distance et le temps semblaient reculer les limites, il ne supportait pas l’idée, la sachant en danger, de rester sans réactions. Si elle venait à mourir sans qu’il eût rien tenté pour la sauver, il ne supporterait plus jamais sa propre image…

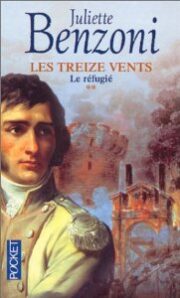
"Le réfugié" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le réfugié". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le réfugié" друзьям в соцсетях.