— Vous pensez au marquis d’Effiat, au chevalier de Lorraine...
— Bien entendu ! J’aurais donné cher quand instrumentait la Chambre ardente, qu’on a fermée un peu vite, pour trouver la preuve qui m’aurait permis de les traîner devant elle sur l’accusation de l’assassinat de la première Madame.
— Même si vous l’aviez trouvée, on ne vous aurait pas laissé faire ! D’abord, ils sont tous les deux très riches et peuvent acheter n’importe qui. Ensuite, en admettant qu’on ait pu les inquiéter, on leur aurait fait passer une frontière ainsi qu’on en a usé avec la comtesse de Soissons. Mais vous pensez qu’ils pourraient être coupables d’un crime aussi incommensurable qu’un régicide ?
— Effiat, on peut en douter, mais je mettrais ma main au feu que le chevalier de Lorraine trempe là-dedans jusqu’au cou. Tu ne trouves pas étrange cette subite entente qui s’est nouée entre lui et la Maintenon ? Entre le vice et la vertu ?
— Est-ce seulement vrai ? répondit Alban, dubitatif.
— Comment si c’est vrai ? As-tu oublié la fureur du Roi au moment du dernier scandale causé par les petits amis de Monsieur et leurs semblables ? Lorraine est loin d’être un imbécile. Il a senti le vent du boulet et s’est dépêché d’aller faire sa cour à la... conseillère. Et crois-moi, quand il le veut, il a énormément de charme. En échange de son aide, il s’engageait à rendre la vie impossible à cette pauvre Madame Palatine. Chaque fois que cette dernière écrit à sa tante Sophie de Hanovre, elle ne cache rien de ce qu’elle pense de la nouvelle favorite et en des termes fort éloignés de ceux de la carte du Tendre. Alors Lorraine et la Maintenon s’associent pour la perdre non seulement dans l’esprit du Roi, mais dans celui de son époux. La belle entente qui régnait entre eux depuis le mariage n’existe plus. Or, la Reine aimait bien Madame qui le lui rendait... et s’il n’y avait pas la Dauphine, la malheureuse serait traitée en pestiférée jusque chez elle.
— Mais enfin, est-ce que l’on détournerait les lettres ?
— On ne les détourne pas mais on les lit... au moins quelques-unes, après quoi on recolle les sceaux et elles reprennent leur chemin comme si de rien n’était.
— C'est infâme !
— Ça l’est ! Soupira La Reynie.
— J’ose espérer que l’on n’ira pas jusqu’à...
— La faire passer de vie à trépas ? Cela m’étonnerait et ce serait dangereux si tôt après la disparition de la Reine dont on commence à jaser. Et puis Madame garde une alliée en la personne de la Dauphine Marie-Christine. Et celle-là est la future reine de France. Non, on n’attentera pas à la vie de Madame. On se contentera de la lui rendre infernale... Dans quelque temps elle pourrait avoir un accident...
La phrase était à peine achevée que Desgrez effectuait une entrée houleuse en brandissant La Gazette :
— Les mauvaises nouvelles continuent ! clama-t-il. Si ça continue, la Cour ne quittera le deuil qu’en de rares exceptions...
— Que se passe-t-il encore ?
Le policier étala le cahier de feuilles sur le bureau de son chef, soulignant d’un doigt le titre principal :
— Voyez plutôt ! Madame la duchesse d’Orléans vient d’avoir, à Fontainebleau, un accident de cheval1 !
— Quoi ? s’écrièrent les deux autres à l’unisson.1
— Eh oui ! Il semble que les sangles de l’animal aient cédé. Mal attachées ou trop usées... et si l’on considère son poids !
— Elle est morte ? demanda La Reynie.
— La Gazette dit que non. On l’a ramenée chez elle extrêmement secouée évidemment et pour l’instant on n’en sait pas plus.
— Arrangez-vous pour en savoir davantage ! ordonna La Reynie. Filez à Fontainebleau et ramenez-moi des nouvelles !
Desgrez parti, Alban ramassa le journal d’une main qui tremblait.
— Monsieur, pria-t-il, et sa voix était curieusement enrouée. Je vous en supplie. Il faut retrouver Charlotte ! S’il lui est arrivé malheur... je n’y survivrai pas un jour de plus !
— Et moi, imbécile, j’aurai un policier de moins ? Bien sûr qu’on va s’y mettre ! Et sans lambiner !
CHAPITRE III
QU’EST DEVENUE CHARLOTTE ?
Gouverneur de la Bastille depuis quarante-cinq ans, M. Baisemaux de Montlezun n’avait rien de ces geôliers féroces chers à l’imagerie populaire. C’était un homme paisible, aimable, tout rond et d’un naturel volontiers casanier, porté à considérer sa redoutable forteresse comme son bien propre et ses prisonniers - auxquels il se serait gardé de vouloir le moindre mal ! - comme des invités qui, au lieu de lui coûter de l’argent, lui en rapportaient. Le Roi, en effet, lui payait une certain somme, dégressive évidemment selon qu’il s’agissait d’un duc, d’un haut personnage ou d’un valet indélicat. Étant lui-même amateur de bonne chère et de bons vins, il veillait à ce que la cuisine de la Bastille fût délectable et se sentait vaguement offensé quand les plus riches de ses pensionnaires faisaient venir leurs repas de chez les traiteurs du quartier. La chère chez lui était aussi abondante que variée et il n’était pas rare qu’il fît profiter les plus misérables du trop-plein des nantis, ajoutant par exemple un pot de bon vin, une aile de poulet, une belle tranche de pâté ou des confitures. Veillant même à ce que ses geôliers ne fissent main basse au passage sur ces aubaines. Il pouvait se montrer alors d’une extrême sévérité. Mais c’était bien rare sous la houlette de ce brave homme qui, s’il n’avait pas fait de sa puissante place forte le meilleur hôtel de France, n’en avait pas fait non plus le plus mauvais[4]. Rien de comparable avec ce qui se passait sous son prédécesseur, le sévère M. du Tremblay, frère du père Joseph, éminence grise du cardinal de Richelieu, ou ce qu’il adviendra sous son successeur, M. de Saint-Mars, attaché surtout au plus mystérieux prisonnier de ce siècle, l’homme au masque.
Depuis plusieurs années déjà, Baisemaux entretenait les meilleures relations avec La Reynie. Même si les recrues n’étaient pas des plus recommandables, le lieutenant général de Police n’en avait pas moins rempli la totalité de la Bastille voisine de l’Arsenal où siégeait alors la Chambre ardente, et les finances de Baisemaux s’en étaient trouvées confortées. Du coup, s’était nouée entre eux une forme d’amitié sur laquelle comptait La Reynie pour le renseigner.
Il le trouva dans la grande cour de la forteresse. C’était jour de grand ménage : on nettoyait les escaliers des huit tours, les deux cours, la grande et celle du puits, on briquait les canons sur le couronnement et cela créait une agitation peu propice à la conversation, sans compter les odeurs que cette opération soulevait.
— Je suis venu, lui dit-il après l’avoir salué, vous demander un verre de votre vin de Tonnerre... et un petit renseignement !
— Tout ce vous voudrez, mon cher ami, mais allons plutôt chez moi. Nous y serons plus à l’aise.
Le gouverneur habitait une maison, ni vaste ni fastueuse, hors des murs noirs de la prison, nichée dans les bâtiments où se logeait la garnison - généralement composée de vieux soldats plus ou moins invalides - jouxtant les magasins et ce qui était nécessaire à la vie d’une forteresse. Elle se situait dans la cour du Gouvernement, se composait d’une petite salle, d’une chambre, et de quelques dépendances, mais bénéficiait d'une terrasse plantée d’arbres dont la vue était franchement plus récréative que l’intérieur lugubre de la prison d’État. Le cadre était modeste comparé à l’agréable demeure que se construiraient les gouverneurs du siècle suivant, mais Baisemaux était célibataire, de mœurs paisibles, et s’en contentait. C’était simple : il aimait son métier et du moment que sa table et sa cave fussent convenablement approvisionnées, il ne demandait rien de plus au Créateur. L’automne s’annonçant humide et froid, un feu revigorant flambait dans la vieille cheminée devant laquelle on s’installa pour goûter le fameux vin qu’accompagnaient des craquelins au fromage.
On parla du temps qu’il faisait, on commenta les dernières nouvelles de la Cour rapportées par La Gazette, puis La Reynie, jugeant que le préalable avait assez duré, entra dans le vif du sujet :
— Dites-moi donc, mon cher Baisemaux, si vous avez en ce moment beaucoup de femmes dans vos logis ?
— Non. Depuis que les sentences de la Chambre ardente ont disséminé mes sorcières dans des forteresses lointaines, je n’en ai plus que deux ou trois. Pourquoi, il y en aurait une qui vous intéresserait ?
— Oui. Une jeune dame, la comtesse de Saint-Forgeat. Elle aurait eu le malheur de déplaire à Sa Majesté le Roi... On vous l’aurait amenée le soir même de la mort de la Reine, le 30 juillet dernier.[5]
— Je n’ai pas ce nom-là. Vous pensez ! Une noble dame, je m’en souviendrais. Ce triste soir, j’ai effectivement reçu une prisonnière envoyée par M. de Louvois. Elle était très jeune, très en colère... ce qui ne l’empêchait pas d’être très mignonne. Au point que je me suis demandé comment une aussi jolie fille avait pu déplaire au Roi si amateur de belles personnes !
— On ne vous l’aurait pas déclarée sous le nom de Fontenac ?
— Eh si ! Tout justement ! La voyant si jeune, je lui avais donné une bonne chambre au second étage de la tour de La Bazinière et j’ai veillé à ce qu’elle ne manquât de rien.
— Et vous avez bien fait. Voyez-vous, je ne suis pas certain que Sa Majesté ne regrette pas un peu de s’être fâchée et je pense qu’elle ne restera pas chez vous longtemps.
— Ah ça c’est sûr ! Elle est déjà partie...
— Partie ? On lui a rendu sa liberté ? Cela m’étonne. Je l’aurais su !

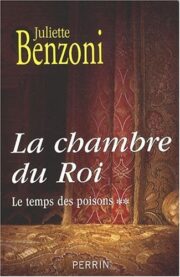
"La chambre du Roi" отзывы
Отзывы читателей о книге "La chambre du Roi". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La chambre du Roi" друзьям в соцсетях.