— Et l’idée qu’on me traîne dans le même lit qu’Étienne, vous pouvez la supporter celle-là ? Vous pouviez au moins me raconter cela au lieu de me laisser me morfondre loin de vous, sans nouvelles de vous. Est-ce que vous ne saviez pas que j’étais prête à fuir, avec vous n’importe où, au fond de n’importe quelle forêt, dans n’importe quelle tanière de loups ?… Mais loin d’ici, loin de cet homme qui n’en veut qu’à ma fortune…
Il essaya encore de la détacher de lui mais ne réussit qu’à la rapprocher…
— Vous ne supporteriez pas ce genre de vie. Vous êtes une vraie demoiselle, fine et douce, faite pour la soie, le velours, les dentelles, pour la vie protégée d’une belle demeure. Et moi je ne supporterais pas de voir la misère vous détruire, vous abîmer… Vous êtes si belle ! Tout à l’heure, dans la chapelle je vous regardais…
— Ce n’est pas vrai ! Vous n’y étiez pas. Je l’aurais senti. Je vous cherchais tellement…
— Pourtant j’y étais. Au-dessus de l’autel, dans le clocher d’où je pouvais tout voir. Mais je ne voyais que vous. Vous étiez belle comme ces portraits d’anges que l’on voit dans certaines églises.
— Taisez-vous ! Mais taisez-vous donc ! Vous ne savez rien de moi, vous n’avez rien compris ! Je vous aime, Jean, je n’aime que vous. Je n’ai besoin que de vous ! Et pas de satin et pas de vie douce et pas de belle demeure ! Vous, rien que vous ! Oh Jean, pourquoi m’avez-vous abandonnée ?
Il avait cessé de lutter contre elle et elle en avait profité pour se glisser entre ses bras, la tête nichée contre son épaule, lui imposant le parfum de ses cheveux que, d’une main timide, hésitante, il se mit à caresser doucement.
— Je ne vous ai pas abandonnée, Hortense. Au contraire, je suis revenu pour veiller sur vous. Mais il faut comprendre qu’on ne peut toujours réaliser ses rêves… Je ne suis qu’un pauvre hère…
— Vous êtes l’homme que j’aime !
— Je ne suis qu’un sauvage…
— Vous êtes l’homme que j’aime !
— Qu’un homme sans avenir… et même sans passé puisque je n’ai pas de père.
— Vous êtes l’homme que j’aime… Jean, Jean, n’avez-vous donc pas compris que nous sommes, de tout temps, destinés l’un à l’autre ? Ma mère m’a dit, un jour, que chacun d’entre nous a, quelque part dans le monde, un être qui lui correspond, qui le complète et qui lui est destiné. Pour moi, vous êtes celui-là. Et je crois bien que je l’ai senti dès notre première rencontre, dans les bois, au milieu des loups. Vous vous souvenez ?
— Oui. Nous étions seuls, alors, au milieu d’eux. Comme ce soir. Regardez !
Un cercle de loups les entourait, en effet. Oreilles droites et yeux luisants, ils ressemblaient, autour du rocher où Luern, assumant son rôle de chef était assis, au conseil muet de quelque prince.
— C’est vrai, dit Hortense. Tout est presque comme cette première nuit. Moins le froid, pourtant, et la neige… et la peur que j’avais.
— Et le fait que vous êtes à présent l’épouse d’Étienne de Lauzargues…
— Non ! Je ne suis pas son épouse… et ne le serai jamais.
— Comment cela ? Il est vrai qu’il est étrange de vous rencontrer ici, alors que cette nuit est celle de vos noces. Que fait donc cet imbécile ?
Hortense perçut, avec joie, la note de colère et de jalousie qui vibrait dans la voix de Jean.
— Il dort ! Il dort après avoir trop bu de vin ! Jean… cette nuit est la nôtre. C’est vous dont je veux être la femme ! C’est à vous que je veux appartenir.
Elle s’était dressée sur la pointe des pieds pour atteindre ses lèvres et, c’était tout contre elles que sa bouche chuchotait les mots brûlants.
— On a voulu que je sois une dame de Lauzargues mais vous en êtes un vous aussi. Faites de moi votre épouse, Jean… Je veux être à vous, je veux être à vous de tout mon corps comme je le suis déjà de toute mon âme…
Au prix d’un effort surhumain, il réussit cette fois à l’arracher de lui, à la rejeter. Elle perdit l’équilibre et tomba dans l’herbe douce.
— Rentrez chez vous Hortense ! Ne me tentez pas ! Ne déchaînez pas le démon qui est en moi et qui vous appelle !… Ne me tentez pas ! Vous n’avez pas le droit.
— J’ai tous les droits puisque j’ai ceux de l’amour. Et je veux vous tenter jusqu’à ce que vous cédiez…
D’un mouvement plein de grâce elle se relevait, dénouait le ruban qui retenait le léger peignoir de batiste et de dentelles. Il glissa sur l’herbe, s’y étala comme la corolle d’une rose blanche. La voix de la jeune fille se fit infiniment douce et caressante :
— Et vous allez céder, Jean de la Nuit… A moins de vous enfuir, vous allez venir à moi…
Un autre ruban que l’on dénoue, un autre nuage qui glisse et s’abat… Le cœur arrêté, Jean vit devant lui une mince statue de chair que la lumière des étoiles gainait d’argent. Une statue qui tendait les bras et qui venait à lui lentement, sortant de la mer d’herbes neuves comme Vénus hors des flots. Il essaya de fermer les yeux, de rejeter l’image tentatrice mais il était déjà au-delà de toute raison…
Il étendit les mains et, soudain, sentit contre ses paumes la rondeur d’une épaule. Le corps d’Hortense semblait fait de satin frais. Il était comme la source offerte aux lèvres d’un homme mourant de soif… Et Jean ne résista plus. Se laissant tomber à genoux, il cacha son visage contre un ventre doux qu’il sentait frémir et y imprima son premier baiser… Puis il entraîna la jeune fille dans l’herbe… Le visage de Jean cachait les étoiles mais Hortense n’avait plus besoin des étoiles. Quand, un instant, il la libéra pour arracher ses propres vêtements, elle ferma les yeux pour mieux savourer l’attente délicieuse qui l’inondait… Puis il revint et elle l’eut tout entier contre elle, sur elle, avec ce poids de chair dense, de muscles durs et cependant si doux qui l’écrasait divinement…
Autour d’eux, les loups regardaient, les yeux mi-clos, silencieux et immobiles. Mais quand l’air de la nuit emporta le cri léger d’Hortense à l’instant où son corps s’ouvrit à l’amour, Luern sur sa pierre poussa un long hurlement qui ressemblait à un cri de victoire.
CHAPITRE X
LA MENACE
Quelques semaines plus tard, Hortense, l’orgueil au fond des yeux, annonçait à son beau-père qu’elle attendait un enfant. C’était le temps de la fenaison, celui aussi où sur la planèze, on arrachait les énormes racines tordues des gentianes jaunes qui constituaient une part non négligeable de la richesse du pays. C’est dire qu’une vie un peu artificielle animait le château, la ferme et le village, drainant ceux des hameaux isolés et de la montagne qui venaient pour aider.
Foulques de Lauzargues fit réunir tout ce monde entre le château et la chapelle, comme il les avait réunis au soir des noces. Puis, du seuil, il proclama qu’un Lauzargues allait dans quelques mois venir au monde pour continuer la dynastie. La joie illuminait son visage dur car, à cet instant, il était roi… On but à l’héritier – car le marquis n’imaginait pas un seul instant que Hortense pût lui donner autre chose qu’un petit-fils – et les jeunes époux durent se plier à une longue cérémonie de félicitations.
Hortense le fit de bonne grâce. Elle était habitée par trop de joie, trop d’amour pour qu’il en allât autrement. Mais, tandis que tous l’entouraient, Étienne montrait le visage gris et figé d’un mourant. Il semblait crucifié à la porte de ce château où se pressaient les travailleurs de la terre avec leurs visages épanouis et leurs félicitations un peu rudes. Mais Hortense ne voyait rien, n’entendait rien. Depuis leur mariage, elle n’avait pas échangé vingt paroles avec son époux car, dès le lendemain, il avait quitté la chambre bleue pour regagner son ancienne chambre au second étage du château. Il n’en sortait pratiquement pas, en dépit des colères que piquait le marquis indigné, des objurgations de Godivelle et des quelques mots que Hortense avait tenté de dire pour l’amener à changer d’attitude.
— Vivez à votre guise et laissez-moi vivre à la mienne ! s’était-il contenté de lui répondre.
Depuis, elle l’avait traité en quantité négligeable, heureuse d’ailleurs d’un état de fait qui lui donnait une liberté inattendue, surtout quand le marquis se rendait, pour une nuit, à Saint-Flour, à Chaudes-Aigues ou simplement à Combert… Ces nuits-là, elle quittait discrètement le château et courait rejoindre Jean dans la grotte au bord de la rivière.
Là, nichés au creux de la montagne dans ce qu’ils appelaient leur terrier, ils vivaient des heures dont chacune valait une existence, dévorant leur passion avec l’insatiable voracité de ces amants privilégiés qui se savent les deux moitiés d’une perfection totale. Les joies qu’ils tiraient de leurs deux corps leur semblaient toujours nouvelles, toujours plus merveilleuses. Parfois quand le plaisir les rejetait, épuisés et haletants, ils se laissaient glisser, enlacés, dans l’eau écumeuse du torrent pour éviter que l’anéantissement bienheureux du sommeil ne les fit surprendre par le jour. Ils s’y ébattaient comme des enfants, jouissant autant de la fraîcheur de la rivière que de la vue de leurs corps brillants d’eau. Puis Jean reprenait Hortense dans ses bras pour la reporter sur le lit d’herbes de la grotte et s’agenouillait pour la sécher sous ses baisers. Le désir alors revenait et ils n’en faisaient l’amour qu’avec plus d’ardeur.
Quand Hortense regagnait sa chambre, avant l’aube, elle s’abattait sur son lit pour y dormir d’un sommeil de bête harassée. Plus jamais elle ne trouvait la force de s’agenouiller pour une prière que Dieu, d’ailleurs, n’aurait pas entendue. La jeune femme avait trop d’honnêteté profonde pour tricher avec le Seigneur. Elle se savait adultère, donc réprouvée, mais son péché lui était trop cher pour qu’elle acceptât l’hypocrisie d’un acte de contrition. Jamais plus elle n’avait écrit à Madeleine-Sophie Barat, jamais plus elle n’avait ouvert son journal de jeune fille car cette jeune fille-là était morte. La femme que les baisers de Jean avaient fait naître n’avait plus besoin du Ciel, pas plus que n’en a besoin la femelle d’un fauve. Le dieu d’Hortense, à présent, c’était Jean. Il suffisait qu’il posât sa grande main sur son cou pour qu’elle se sentît défaillir et aucun paradis ne pouvait se comparer à celui où elle planait au moment où il la possédait…

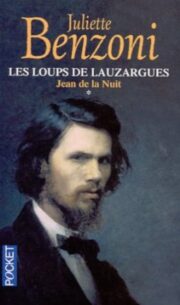
"Jean de la nuit" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jean de la nuit". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jean de la nuit" друзьям в соцсетях.