— Je croyais que vous vouliez donner un bal chez vous ? fit Hortense acerbe.
— Le bal aura lieu… mais dans notre ancienne demeure. Le château ne pourrait jamais être en état dans deux mois…
Le visage du marquis rayonnait d’orgueil, à présent. Il anticipait visiblement les fastes dont il entendait éblouir la capitale cantalienne. Après des décennies d’obscurité volontaire, presque de misère, les Lauzargues allaient reparaître, superbement, sur la scène du monde…
Un instant, Hortense le contempla, amusée et apitoyée tout à la fois par cet éclat soudain d’un homme miraculeusement touché par la fortune. Puis sa voix calme et claire tomba sur cet enthousiasme comme le couperet du bourreau, le tranchant net :
— Si vous tenez à ce mariage, mon oncle, vous m’éviterez ce genre de cérémonie.
— Que voulez-vous dire ?
— Que j’accepte d’épouser Étienne puisque apparemment il n’y a pas moyen de faire autrement mais je ne veux pas me donner en spectacle à Saint-Flour. Pour être plus claire, je mets deux conditions à mon consentement.
Le marquis eut un haut-le-corps.
— Des conditions ? Je ne vois vraiment pas comment vous pourriez en poser. Ou bien vous acceptez ou bien vous refusez. Mais je ne vois pas…
— Oh, vous allez voir ! Si vous voulez que je devienne comtesse de Lauzargues, ce sera dans la chapelle du château, en présence de tous les gens du château et du village comme cela s’est toujours fait dans nos familles. Je veux être mariée dans la chapelle de Saint-Christophe parce que ce sera une grande joie pour les gens du pays de retrouver le chemin d’un sanctuaire qu’ils regrettent… et parce qu’au moins, il y aura ce jour-là beaucoup de gens heureux à défaut de moi. Quant à ma seconde condition…
— Quelle folie ! coupa le marquis. Je vous ai déjà dit l’état déplorable de ce bâtiment et…
— Cela m’est égal. Ne resterait-il qu’un pan de mur derrière l’autel que je m’en contenterais. D’ailleurs, à la Saint-Jean, l’été est là. Il fait chaud… Et s’il y a des travaux à faire j’écrirai à Paris pour avoir les fonds. Comprenez-moi bien, mon oncle ! Ma mère s’est mariée loin de chez elle. Si vous voulez que je considère vraiment Lauzargues comme ma maison, je veux m’y marier !…
Raidi dans une colère qu’il n’osait pas exprimer tant le désir d’Hortense semblait naturel, le marquis ressemblait à une statue de la réprobation. Désireuse de détendre un peu l’atmosphère, Hortense se permit un sourire :
— Mademoiselle de Combert m’a appris qu’il était d’usage, lors d’un mariage, de planter un genévrier devant la maison de la mariée. Il me paraît difficile d’en planter un devant la cathédrale de Saint-Flour…
Mais le marquis refusait de sourire :
— J’aimerais entendre à présent votre seconde condition…
— Elle découle un peu de la première. Depuis que je suis ici, j’ai beaucoup entendu vanter les mérites de l’abbé Queyrol…
— Ce petit prêtre de rien du tout ? Ce gamin ?…
— Vous ne m’entendez pas. Je parle de votre ancien chapelain, le vieil abbé Queyrol…
Cette fois, la colère flamba dans les yeux glacés du maître de Lauzargues. Une colère à laquelle – Hortense l’aurait juré – se mêlait quelque chose qui ressemblait à de la peur… Mais Il se contenta de répondre sèchement.
— Vous demandez l’impossible. L’abbé Queyrol est beaucoup trop âgé. On ne saurait le déplacer…
— Je souhaiterais tout de même qu’on le lui demande. S’il refuse… nous verrons !
— Et si moi, je refuse vos conditions ? Si je dis, ici, que vous serez mariée comme je l’ai décidé ? Si j’affirme…
— N’affirmez rien, mon oncle ! Vous n’aimeriez pas, je crois, m’entendre répondre « non » quand on me demandera si je veux épouser mon cousin, la voix résonne sous les voûtes d’une cathédrale…
— Vous n’oseriez pas !
— Ne me mettez pas au défi, mon oncle ! Je m’appelle aussi Napoléone…
Le retour de Mlle de Combert mit fin à une scène qui peut-être se fût éternisée. Sa présence gracieuse et souriante fit tomber chez Hortense l’excitation du combat. Mais le marquis demeurait figé sur place, raidi en face de l’insolente qui avait osé le défier. Les veines de ses tempes battaient et il était facile de deviner qu’il s’imposait une tension extrême pour ne pas éclater en invectives. Enfin son regard se détourna de la jeune fille pour se poser, avec une sorte de lassitude, sur celui de Dauphine.
— Eh bien ? fit celle-ci. Vous êtes-vous mis d’accord ?
— Il le faut bien ! lança-t-il avec humeur. Nous planterons donc à Lauzargues le genévrier des épousailles le jour de la Saint-Jean d’été… Jusque-là, ma cousine, vous me rendrez service en gardant Hortense chez vous. Au surplus, il ne serait pas convenable qu’elle habitât sous le même toit que son fiancé…
Et, sans ajouter une parole, il sortit du salon presque en courant…
CHAPITRE IX
LA NUIT DES ÉPOUSAILLES
Le premier dimanche de mai, on célébrait à Combert les fiançailles d’Hortense Granier de Berny et d’Étienne de Lauzargues par un temps gris et froid, ce genre de temps que les jardiniers appelaient l’hiver de l’aubépine car il n’était pas rare que la floraison de cet arbuste coïncidât avec un retour de la froidure. Cela permit à Godivelle, qui avait reçu du marquis l’ordre de venir prêter à Clémence le secours de ses talents culinaires, de ronchonner que c’était bien fait parce que le joli mois de mai, voué tout entier à la virginité de Marie, mère de Dieu, n’était pas un bon mois pour les accordailles :
« Noces de mai, noces mortelles ! » prédisait-elle d’une voix de pythie. Ou encore : « Gardez-vous bien d’allumer au mois de mai les flambeaux de l’hyménée, ils se changeraient en torches funèbres… »
Comme elle semblait avoir à sa disposition toute une provision de dictons aussi réjouissants, Mlle de Combert lui fit remarquer un peu sèchement qu’il s’agissait seulement de fiançailles et que les « noces » étaient pour la fin du mois de juin. Mais Godivelle tenait à son idée. Elle prétendait que c’était la même chose puisque l’anneau de fiançailles devait être béni par un prêtre et qu’il n’était plus guère possible de renier par la suite l’accord que l’on avait ainsi scellé.
Hortense savait cela et se désespérait. Quinze jours seulement s’étaient écoulés depuis son affrontement avec le marquis et l’état de son pied ne lui avait pas permis de quitter la maison. Tout ce qu’elle pouvait faire, c’était clopiner jusqu’au jardin, étayée d’un côté par Dauphine et de l’autre par Clémence. Au jardin où, pourtant, François ne cessait de s’activer : pinçant les arbres fruitiers, plantant les choux, les salades, les poireaux et les pommes de terre, semant les légumes à repiquer. Mais, en dépit de l’ardent désir qu’elle en avait, Hortense ne parvenait jamais à échanger avec lui d’autres paroles que des considérations banales sur le temps qu’il faisait ou les espoirs de récolte que donnait le jardin. Que dire d’autre entre deux gardiennes ? Restait le langage des yeux et ceux de la jeune fille imploraient, suppliaient le fermier de lui donner des nouvelles de Jean quand elle était certaine qu’on ne la regardait pas. Mais à ce langage-là François ne pouvait répondre non plus.
Où était Jean, que faisait Jean ? Pourquoi ne donnait-il pas signe de vie ? En recevant son court billet, Hortense avait bien cru pourtant tenir l’arme qui obligerait le marquis à retarder le mariage, peut-être sine die. Mais il s’était résigné apparemment à faire rouvrir la chapelle Saint-Christophe, où l’on effectuait des travaux selon Pierrounet, venu deux fois apporter une lettre de son maître pour Mlle de Combert. Avait-il aussi fait la paix avec l’abbé Queyrol ? Lors de son second passage, le neveu de Godivelle avait appris à Hortense que M. Garland, investi apparemment de la dignité d’ambassadeur extraordinaire, se disposait à partir pour Chaudes-Aigues afin d’y rencontrer le vieux prêtre au nom de son maître. Ce qui avait déclenché une immédiate remarque chez la jeune fille :
— Pourquoi mon oncle n’y va-t-il pas lui-même ?
Question à laquelle le pauvre Pierrounet était bien incapable de répondre. Aussi Mlle de Combert s’était-elle chargée de la réponse :
— Mon cousin se défie de son caractère emporté, ainsi d’ailleurs que de celui de l’abbé… qui n’est pas commode lui non plus. En outre, au temps où il habitait Lauzargues, l’abbé, homme de science et de savoir, entretenait d’excellentes relations avec le précepteur d’Étienne dont il appréciait la culture. Ils ont le même amour de l’histoire locale et des vieilles pierres. Encore que leurs buts eussent été différents. L’abbé s’intéressait surtout aux vestiges chrétiens des anciens âges…
— Et Monsieur Garland aux anciens Lauzargues ?
— Pas seulement. Il n’en parle pas, bien sûr, mais je le soupçonne depuis longtemps de chercher le légendaire trésor de son homonyme, le chef de bandes Bernard de Garlan…
— S’il y avait un trésor à Lauzargues, je suis certaine que mon oncle aurait su le trouver !
— C’est aussi mon avis. D’autant que Bernard de Garlan a occupé d’autres places fortes, mais je parierais mon plus beau jupon contre une poignée de noisettes que notre Garland y croit, lui, et dur comme fer ! Quoi qu’il en soit, mon cousin Foulques ne se montre pas si maladroit en expédiant son savant. Celui-ci va tâter le terrain, le préparer et, s’il semble favorable, le marquis en personne se rendra à Chaudes-Aigues…
— Je vois. Mais vous qui savez tant de choses, ma cousine, me direz-vous enfin ce qui s’est passé entre mon oncle et son chapelain au moment de la mort de ma tante ? Quel a été le sujet de leur querelle et pourquoi cette grande colère du marquis ?

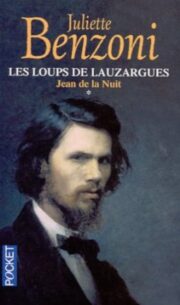
"Jean de la nuit" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jean de la nuit". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jean de la nuit" друзьям в соцсетях.