— Bouquets du Diable ! grognait le marquis, on ne peut y toucher sans se piquer les doigts !
— Ils ne sont pas faits pour que l’on y touche mais pour être regardés. Quant au Diable, je vous rappelle qu’il brûle mais ne pique pas. Ici et en hiver, il ne faut pas se montrer trop difficile… à moins de posséder une serre. Avez-vous des serres, chez vous, Hortense ?
— Oui. Au château de Berny, mon père avait fait construire une grande serre pour faire plaisir à ma mère. Elle adorait les fleurs et n’en avait jamais assez. Surtout des roses !
— Je la comprends. Au fond, on vous a joué un très mauvais tour en vous arrachant à de si agréables demeures pour vous précipiter au fond de ce château, vénérable sans doute mais meublé de courants d’air plus que de bois précieux.
— Le couvent des Dames du Sacré-Cœur d’où je viens n’était guère plus confortable, en dépit du fait qu’il occupe l’un des plus beaux hôtels de Paris.
— Guère plus… Mais plus tout de même ! Je gage que votre bon oncle ne vous a même pas demandé si vous vous trouviez bien installée ? Vous ne changerez jamais, mon cher Foulques. Hors de votre Lauzargues point de salut ! Il est et sera toujours pour vous préférable même à un palais royal.
— C’est « ma » maison. Et pour moi cela dit tout ! Quant à ma nièce, j’ai pensé qu’elle saurait s’accommoder d’une demeure dont sa mère s’est accommodée si longtemps…
— … mais dont elle ne se serait certainement plus accommodée si Dieu avait permis qu’elle y revînt… pour notre joie !
Une chaude vague de reconnaissance envahit Hortense à cet instant. Elle sentit qu’une partie de son cœur était attirée vers cette femme aimable, humaine et compréhensive qui allait au-devant de ses regrets et s’en faisait la championne. Elle chercha une phrase capable d’exprimer ce qu’elle ressentait sans offenser le marquis mais ne la trouva pas. Mlle de Combert s’aperçut de son trouble et se leva aussitôt :
— Laissons ces messieurs, petite, et allons bavarder un moment dans ma chambre. Je me sens un peu lasse.
Soir après soir, Hortense prenait place sur une chaise basse au coin du feu, en face de Mlle de Combert qui, enveloppée d’un peignoir de belle soie ouatinée, l’interrogeait interminablement sur sa vie passée, ses parents, leurs habitudes, les fêtes qu’ils donnaient, leurs relations et même les toilettes, les bijoux de Victoire.
La jeune fille se prêtait au jeu avec une sorte de délectation. C’était agréable de revivre un peu, pour cette auditrice attentive, les jours ensoleillés d’autrefois et, surtout, de pouvoir parler sans contrainte de ceux qu’elle avait perdus. Elle se sentait alors plus proche d’eux, moins orpheline. Un soir même, elle osa poser une question qui la tourmentait inconsciemment et qui, à évoquer les derniers temps du baron et de la baronne Granier de Berny, se fit soudain présente.
— Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mon oncle abhorre mon père, n’est-ce pas ?
— Cela ne fait malheureusement aucun doute, ma pauvre enfant.
— Je l’ai compris. Et je le comprendrais mieux encore si c’était à cause de la mort de ma mère. Pourtant il me semble que ce n’est pas cela qu’il lui reproche le plus mais bien d’avoir été ce qu’il était : un roturier enrichi qui a osé épouser une Lauzargues ?…
— Vous n’avez pas tort, dit rêveusement Dauphine après un instant de silence. Voyez-vous, votre mère est morte pour lui à l’instant même où elle a choisi votre père. On ne tue pas une morte…
— On me dit qu’il l’aimait beaucoup pourtant. Quand on aime on ne chasse pas si facilement un être de son cœur.
— Sans doute, mais il l’aimait… trop ! De ce fait il l’aimait mal.
— Peut-on aimer trop, aimer mal ?…
— Il suffit d’aimer pour soi-même… et non pour l’autre. Mais vous êtes trop jeune encore pour comprendre tout cela, conclut Mlle de Gombert en retrouvant son ton enjoué habituel.
Un autre soir, Hortense demanda, en riant, pourquoi son amie ne veillait jamais dans la grande salle en compagnie du marquis, ce qui eût été naturel. La même scène, en effet, se reproduisait chaque soir : le souper achevé, Dauphine se levait, s’excusait avec grâce et quittait la salle suivie d’Hortense et du regard amusé de son cousin mais sans qu’il élevât jamais la moindre objection.
— Il sait bien, expliqua-t-elle à Hortense, que je ne peux souffrir ce Garland dont il est entiché. Je sais bien que c’est un puits de science et qu’il apporte une vraie passion à reconstituer l’histoire des Lauzargues. Je sais que, grâce à lui, ce pauvre Étienne aura, au moins, appris quelque chose dans sa vie et que c’est une vraie chance, surtout pour un homme aussi désargenté que mon cousin, mais je ne l’aime pas et il n’y a aucune raison pour que cela change dans l’avenir. Il a une tête à faire peur aux corbeaux !
— Mais, c’est vrai ! Un bibliothécaire cela se paie, un précepteur aussi. Comment fait mon oncle ?
— Il ne paie ni l’un ni l’autre. Le bonheur d’habiter Lauzargues et de manger la cuisine de Godivelle lui paraît un salaire tout à fait suffisant.
— Et M. Garland est d’accord ?
— Tout à fait et il l’a toujours été. Garland est un héritage du vieux marquis. Il y a plus de vingt ans, dans les débuts du siècle – ne me demandez pas l’année, je n’ai aucune mémoire des dates –, il l’a trouvé au cours d’une battue aux loups vers Auriac à moitié mort de faim et de froid. Je crois qu’il n’a jamais très bien su d’où il venait mais son nom l’a amusé… et aussi sa bosse.
— Sa… bosse ? Était-il si cruel ?
— Pas plus cruel qu’un autre, mais ce nom de Garland ne vous dit-il rien ?
— Rien du tout. Le devrait-il ?
— Décidément, soupira Mlle de Gombert, notre jolie Victoire ne vous a pas raconté grand-chose des histoires de sa famille. Quant à Godivelle, le temps a dû lui manquer sinon vous seriez déjà au fait. Eh bien, ma chère, sachez qu’au temps où les Anglais tenaient une partie de l’Auvergne durant la guerre de Cent Ans, Lauzargues était tombé par la trop grande jeunesse de son seigneur aux mains d’un routier boiteux, bossu, et méchant comme tout l’Enfer qui s’en était emparé par la trahison d’un valet. Ce bandit a gardé le château pendant quatre ou cinq ans, le temps pour le jeune Foulques de l’époque de se faire des muscles et une épée solide. Il s’était juré de tuer le misérable qui avait assassiné sa mère et l’avait obligé lui-même à fuir. Mais il n’a pas eu ce plaisir : un beau jour Bernard de Garlan a disparu sans que personne pût dire où il était passé…
— Bernard de Garlan ? C’était son nom ?
— Eh oui ! Celui-ci s’appelle Eugène et orthographie son nom avec un d mais le défunt marquis a trouvé la similitude amusante. Et plus amusante encore l’idée de ramener un Garlan au château…
— Alors que l’autre avait laissé de tels souvenirs ? Ne craignait-il pas de réveiller…
— Quoi ? Un vieux fantôme ? Le bonhomme, en tout cas, est bien inoffensif. Quant au marquis… c’était un vieillard sceptique, grand liseur de M. de Voltaire et ne croyant ni à Dieu ni au Diable.
— J’ai bien peur que mon oncle ne soit comme lui, soupira Hortense. Il ne veut pas entendre parler d’entrer dans une église.
— Oh, je sais ! Ne croyez pourtant pas qu’il soit athée mais au moment de la mort tragique de votre tante il s’est querellé gravement avec l’abbé Queyrol, l’ancien curé du village qui desservait aussi le château. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Avec un homme aussi orgueilleux, la moindre chose déchaîne la tempête. De là son abstention… et la chapelle condamnée. Mais, ajouta-t-elle en retrouvant le sourire qu’elle avait perdu un instant, je ne désespère pas de l’amener un jour ou l’autre à composition. Je le connais depuis si longtemps !
— Ah, j’en serais si heureuse ! s’écria Hortense, sincère. En attendant, je voudrais tant pouvoir aller entendre la messe demain.
— C’est vrai. Vous êtes toute fraîche émoulue de votre couvent et la messe est encore la grande affaire pour vous. Elle a moins d’importance dans nos montagnes, tout au moins l’hiver quand la neige rend les chemins de l’église difficiles. Mais puisque j’ai là mon traîneau, nous irons l’entendre ensemble…
Une impulsion de joie jeta Hortense à son cou et les deux femmes s’embrassèrent chaleureusement.
— Vrai, dit Dauphine, amusée par l’impétuosité d’Hortense, c’est chose aisée que vous faire plaisir ! A présent, allez dormir. Je vais donner ordre que l’on attelle pour neuf heures…
La porte de la chambre de Mlle de Gombert ouvrait près de l’escalier. En sortant, le sourire aux lèvres, Hortense heurta presque Godivelle qui, un plateau garni dans les mains, descendait du second étage :
— Est-ce que mon cousin ne va pas bien ? demanda Hortense, désignant les assiettes à peine entamées. Godivelle haussa les épaules :
— Il ne va pas plus mal. Mais c’est le diable pour le faire manger. Comment voulez-vous qu’il reprenne des forces s’il refuse de se nourrir.
— Il doit s’ennuyer là-haut ! Est-ce que je ne pourrais pas le voir ?
— Non, pas encore. Il ne veut voir personne… Mais vous me semblez bien gaie, vous, ce soir ?
— C’est parce que Mlle de Gombert va m’emmener à la messe demain matin. Oh, Godivelle, je crois que vous la connaissez mal. C’est une femme merveilleuse ! Si intelligente, si bonne !…
Les petits yeux noirs de la vieille femme s’arrondirent d’une stupeur d’où l’indignation n’était pas absente. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose mais changea d’avis et la referma brusquement, à la manière d’une truite qui vient de gober une mouche, et se contenta de marquer sa désapprobation par un haussement d’épaules que Hortense jugea beaucoup plus vexant qu’un long discours.

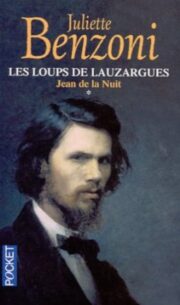
"Jean de la nuit" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jean de la nuit". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jean de la nuit" друзьям в соцсетях.