— On dirait qu’Alyette vous plaît, ma nièce ? dit Lauzargues qui l’observait.
— C’est elle ?
— Bien sûr. Ne vous ai-je pas dit que tout ceci avait été fait pour elle ?
— Et le chevalier est son époux ? Mais il n’a pas l’air si vieux !
— L’était-il vraiment ? Au surplus, les peintres de ce temps devaient savoir, comme ceux de tous les temps, que la générosité du paiement allait de pair avec la satisfaction du client. J’ajoute, pour répondre à la question que vous m’avez posée tout à l’heure, que, selon nos chroniques familiales, Alyette aimait passionnément son époux…
— Les chroniqueurs ne peuvent-ils avoir été aussi complaisants que les peintres ?
— Elle avait trente-cinq ans lorsque Foulques mourut. Pourtant, elle abandonna enfants et château pour enfermer sa douleur dans un couvent. C’est, je crois, une preuve…
L’ameublement de la pièce demeurait fidèle à l’austère grandeur des temps médiévaux : longue table de chêne, bahuts, crédences, bancs à dossier. Enfin, à l’un des bouts de la table, une haute chaire de bois à dais sculpté marquait la place du seigneur des lieux. La vue de ce siège effaça pour Hortense l’impression de grâce apportée par les fresques : il était le signe évident d’une puissance féodale à laquelle, sans doute, Foulques de Lauzargues n’avait pas encore renoncé… Il ressemblait à un avertissement.
— Venez, dit-il, nous avons encore bien des choses à voir.
En fait, le reste du château était moins évocateur. L’étage supérieur où Hortense avait sa chambre en comportait trois autres : celle du marquis dont la porte faisait face à celle de la jeune fille, une autre chambre ouvrant près de l’escalier et dont on lui dit qu’elle était réservée à d’éventuels visiteurs. Une troisième enfin dont la porte antique, de vieux bois noir armé de pentures de fer comme les autres portes, était curieusement renforcée d’une épaisse barre de verrou qu’un gros cadenas empêchait de glisser : une vraie porte de prison…
— Cette chambre était celle de la marquise mon épouse, dit le seigneur des lieux, répondant brièvement à l’interrogation muette d’Hortense. Depuis sa mort accidentelle je ne supporte pas que l’on y entre. Aussi l’ai-je fait barricader pour éviter que l’on n’y accède par inadvertance.
— Godivelle m’en a parlé hier au soir, lança Hortense étourdiment.
Elle fut étonnée du résultat. Instantanément, la belle sérénité quitta le visage du marquis et, contre elle, la jeune fille sentit tressaillir son bras.
— Que vous a-t-elle dit ? demanda-t-il brusquement.
— Peu de chose en vérité : que votre épouse avait été victime d’un accident… mais sans préciser lequel. Que lui est-il donc arrivé ?
Avec une étonnante mobilité, le masque de guerrier nippon se fit douloureux. Foulques de Lauzargues quitta le bras d’Hortense, fit quelques pas dans le couloir en tirant son mouchoir, se moucha, puis revint vers la jeune fille.
— Pardonnez-moi de ne pas répondre à cette question. L’événement fut si cruel que, même après dix années, il m’est encore pénible de l’évoquer. La parole, plus encore que la pensée, est créatrice. Je craindrais trop, en vous relatant ce qui s’est passé ici, de réveiller les cauchemars qui m’ont assailli pendant tant d’années. Plus tard, peut-être…
Sa voix traînait une si lourde tristesse que Hortense eut honte, tout à coup, de son inquisition. De quel droit se permettait-elle de réclamer des explications à cet homme tellement plus âgé qu’elle ? Elle s’y était peut-être crue autorisée par l’atmosphère anormale, fantastique même, qui avait présidé à son arrivée. Il y avait eu sa rencontre avec le maître des loups, arrivant juste après ce voyage affreux dont elle ne voulait pas. Il y avait les préventions qu’elle nourrissait envers sa famille maternelle. Enfin, il y avait surtout l’étrange aventure de ce matin : le garçon qui fuyait, l’ordre incroyable donné au bossu par la bouche d’un père. De là à imaginer que tous les placards du château recelaient un cadavre et que l’âme du marquis était chargée des plus noirs péchés, il n’y avait qu’un pas trop facile à franchir.
— Pardonnez-moi, dit-elle enfin. Je n’ai pas voulu me montrer indiscrète, ni même curieuse, mais il est si étrange d’arriver dans une famille dont on ne connaît rien quand cette famille est la vôtre…
Il eut à nouveau pour elle le séduisant sourire qui l’avait tant frappée tout à l’heure et prit sa main entre les siennes qui étaient chaudes et d’une étonnante douceur.
— Ne vous excusez pas. Tout cela est bien naturel et j’espère sincèrement que, bientôt, vous serez nôtre.
— Je crains que ce ne soit pas très facile…
— Vous pensez que beaucoup de choses s’y opposent ?
— Sans doute, puisque vous n’acceptez même pas mon prénom. Ne parlons pas de mon nom…
— Soyez patiente. Cela passera. Je suis sûr, d’ailleurs, que vous deviendrez une vraie Lauzargues dans un avenir très proche.
La visite du second étage offrit elle aussi sa surprise, en dépit du fait que la disposition des pièces était la même qu’au premier. Hortense vit des portes closes qui étaient celles, voisines, du bibliothécaire-précepteur et de son élève. Celle qui s’ouvrit découvrit une bibliothèque, mais qui ne ressemblait guère à ce que Hortense avait pu voir jusque-là.
Rien de comparable avec celle de son père, haute pièce habillée d’acajou luisant, de tapisseries et de longs rayonnages où s’alignait, sous de précieuses reliures « aux armes », la majeure partie de ce que le monde avait pensé de beau, de grand ou plus simplement d’utile depuis qu’il existait. Les longs plis des rideaux de velours vert – Empire naturellement – rejoignaient l’immense tapis de la Savonnerie pour ouater confortablement la pièce où le banquier aimait à passer la plus grande partie des heures qu’il ne consacrait pas à sa banque. Là, tout n’était qu’ordre et beauté. On ne pouvait en dire autant de la bibliothèque de Lauzargues.
C’était une vaste salle mal tenue – Godivelle n’avait le droit d’y mettre ni les pieds ni le plumeau – qui ressemblait beaucoup plus à l’antre d’un sorcier qu’à un honnête cabinet de lecture. Dans de vastes armoires aux portes ouvertes s’entassaient, sans ordre, incunables précieux et livres en mauvais état perdant plus ou moins leurs feuillets. Des piles de papiers, couverts d’une écriture si fine qu’elle ne devait être lisible que de tout près ou avec une bonne loupe, couvraient la longue table qui tenait le centre, éparpillés autour d’un livre ouvert. Un peu partout, des bocaux contenant des reptiles, des paquets de plantes, des oiseaux empaillés et même, dans un coin, un antique fourneau éteint entouré de fioles de tailles et de couleurs variées et qui servait de support à une grosse cornue vide. On respirait là une odeur bizarre faite de poussière, de plantes séchées et de senteurs chimiques assez indéfinissables mais parmi lesquelles Hortense crut reconnaître le soufre.
Devinant, à l’expression du visage de sa nièce, la question qui allait venir, le marquis prit les devants :
— Monsieur Garland est un homme de sciences. Non seulement il s’intéresse vivement à l’histoire de notre famille qu’il a entrepris d’écrire, m’a-t-il dit, mais il se livre aussi à certaines recherches…
— Alchimiques, je pense ? J’ai vu un jour un tableau représentant un alchimiste dans son cabinet. On jurerait que cela a été peint ici…
— Ne prêtez pas trop d’attention à ce fatras, fit le marquis avec un dédain indulgent. Ce fourneau ne s’allume guère, sauf pour les leçons de mon fils. Monsieur Garland lui donne, je crois, une éducation très complète dans laquelle entre un peu de chimie mais encore plus de sciences naturelles. Il ne cesse de rechercher pour lui des spécimens de la flore et de la faune de nos montagnes dont vous pouvez voir ici des échantillons de toute sorte…
Comme tout à l’heure, le marquis enchaînait les phrases l’une à l’autre en parcourant la vaste pièce sombre. Il ouvrait un herbier qui n’avait pas dû être ouvert depuis longtemps si l’on en croyait la poussière qui l’habillait, montrait une curieuse pierre fossile, mirait près de l’étroite fenêtre un bocal où trempait un lézard vert et, somme toute, se donnait beaucoup de mal pour prouver à sa nièce que le bibliothécaire-précepteur était une sorte de puits de science et un esprit curieux de tout. Pourtant, une fois encore, la jeune fille éprouva l’étrange impression que ce discours sonnait faux. Peut-être à cause justement de la poussière qui recouvrait presque toute la pièce à l’exception de la table, peut-être aussi parce que, sous le livre ouvert écrit en vieux français et en caractères gothiques, un papier laissait voir un bout de dessin qui ressemblait davantage à un plan d’architecte qu’à un croquis de zoologie ou de botanique.
En dépit du feu – assez maigre d’ailleurs – allumé dans la cheminée conique, il faisait froid et humide dans cette salle destinée au travail intellectuel. Hortense s’en rapprocha, resserrant autour d’elle le châle de laine que Godivelle avait jeté sur ses épaules. Elle était très déçue. L’idée d’une bibliothèque existant au château l’avait emplie de joie car elle espérait pouvoir en tirer de quoi lutter contre ce qu’elle croyait bien devoir être un ennui profond. Or, tout ce qu’elle pouvait apercevoir en fait de livres était écrit en latin, en grec même, ou en vieux français. Ceux qui semblaient écrits dans une langue compréhensible offraient des titres aussi exaltants que : Traité de l’alimentation des lézards ou de la morphologie des pierres comparée à celle des animaux.
Comme le marquis achevait sa péroraison sur une sorte de point d’orgue : la contemplation quasi extatique d’une énorme racine de gentiane qui présentait la forme presque parfaite d’une pieuvre, Hortense osa dire ce qu’elle pensait :

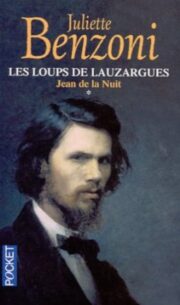
"Jean de la nuit" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jean de la nuit". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jean de la nuit" друзьям в соцсетях.