Un vent léger mais aigre s’était, en effet, levé, balayant les feuilles sur les côtés de la Route Ronde qui, depuis Louis XIV, ceinturait Fontainebleau et une large zone de forêt pour la commodité des voitures de chasse. Dans le ciel gris pâle, à peine teinté de bleu, les nuages couraient à la poursuite d’un vol noir d’hirondelles en route vers les terres du soleil. En regardant les oiseaux fuir, si libres et si rapides, Marianne sentit sa gorge se serrer en évoquant Jason, cet oiseau de mer qu’une cage ignoble retenait en attendant que le poing stupide d’une justice esclave vînt l’écraser sans lui permettre de revoir, même un seul jour, l’immense et pur océan...
L’appel d’une trompe dans les profondeurs de la forêt vint l’arracher à sa triste méditation. Elle savait la chasse depuis trop longtemps pour ne pas reconnaître le départ des chasseurs et, vivement, elle se leva, défroissant d’un geste machinal la jupe de son amazone.
— En selle ! s’écria-t-elle. Ils partent !
— Un instant ! fit Fortunée avec un geste apaisant. Il faut d’abord savoir de quel côté ils se dirigent.
Immobiles, les deux femmes écoutèrent un moment, cherchant à démêler l’écho des aboiements et des sonneries des trompes. Puis Mme Hamelin gratifia son amie d’un sourire triomphant :
— Magnifique ! Nous allons pouvoir leur couper la route. Ils remontent vers la Haute Borne ! En avant ! Je te montre le chemin, ensuite tu iras seule. Je resterai un peu en arrière... puisque Sa Majesté ne veut pas me voir ! En avant !...
D’un même élan les deux jeunes femmes s’enlevèrent en selle puis, excitant leurs montures d’un coup de cravache, partirent au galop à travers la forêt, se guidant sur les appels de trompe. Elles suivirent d’abord un layon qui trouait les fourrés, se courbant sur l’encolure des chevaux pour éviter d’être giflées par les branches basses. Le parcours, semé de rochers, escaladant des buttes pour redescendre dans des fonds tapissés de bruyères et de hautes fougères fanées, était difficile mais toutes deux, surtout Marianne, étaient d’excellentes cava-tières et elles savaient, sans rien perdre de leur vitesse, éviter les obstacles. En temps normal, Marianne eût pris un plaisir violent à cette chevauchée rapide à travers l’une des plus belles forêts d’Europe, mais l’enjeu en était trop grave et trop lourd de conséquences tragiques. Courant ainsi après la vie de Jason Beaufort, elle savait parfaitement qu’elle courait aussi après sa propre vie.
On galopa longtemps. La bête de chasse semblait prendre plaisir à changer ses voies et il s’écoula près d’une heure avant qu’à travers les branches dépouillées n’apparût la tache fulgurante et blanche de la meute lancée ventre à terre. Les chiens donnaient de la voix sans pour autant ralentir leur course. Depuis longtemps, les sonneries des veneurs avaient appris à Marianne que la bête était un sanglier et, dans l’état d’extrême sensibilité où se trouvaient ses nerfs, elle s’en était réjouie n’ayant jamais trouvé le moindre plaisir à traquer le cerf, le daim ou le chevreuil dont la beauté et la grâce l’émouvaient toujours.
La voix de Fortunée qui retenait maintenant son cheval lui parvint dans le vent :
— Va seule, maintenant... Ils sont là.
En effet, Marianne pouvait distinguer le sanglier, énorme et noir boulet hirsute lancé à travers bois, la meute le talonnant de près, puis les chevaux gris de deux piqueurs en vestes rouges qui sonnaient de la trompe à s’arracher la gorge... L’Empereur ne devait pas être loin. D’un cri et d’un coup de talon, elle précipita l’allure de son cheval, fonça à travers une futaie, sauta un gros arbre abattu et un fourré... et arriva comme une bombe droit sur Napoléon lui-même en plein galop.
Pour éviter la collision, les deux montures, avec un bel ensemble, se cabrèrent brutalement mais, tandis que Marianne, parfaitement maîtresse de son cheval, demeurait en selle, l’empereur des Français, pris par surprise, vida les étriers et se retrouva assis dans la mousse.
— Mille tonnerres ! hurla-t-il. Quel est l’imbécile...
Mais déjà Marianne était à terre et tombait à genoux auprès de lui, épouvantée de ce qu’elle avait fait.
— C’est moi, Sire... ce n’est que moi ! Oh ! par pitié, pardonnez-moi ! Je ne voulais pas... mon Dieu, vous n’avez rien ?
Napoléon lui décocha un regard furibond et vivement se releva, arrachant des mains de Marianne son chapeau qui était tombé dans la chute et qu’elle venait de ramasser.
— Je croyais vous avoir exilée, madame ! gronda-t-il d’une voix si froide que la jeune femme sentit un frisson courir le long de son dos. Que faites-vous ici ?
Sans même songer à se relever, elle lui adressa un regard implorant :
— Il fallait que je vous voie, Sire, que je vous parle... à n’importe quel prix !...
— Même au prix de mon dos ! ricana-t-il. (Puis il ajouta avec impatience :) Mais relevez-vous donc ! Nous sommes ridicules ainsi et vous voyez bien que l’on vient...
En effet, trois hommes, que l’Empereur avait dû distancer, arrivaient en trombe. Le premier portait le fastueux uniforme de général des hussards, le second l’habit vert de la vénerie impériale et le troisième, le seul que Marianne connût, était Roustan, le mameluk. En une seconde le général fut à terre.
— Sire, s’enquit-il avec inquiétude, vous est-il arrivé quelque chose ?
Mais ce fut Marianne qui répondit avec un sourire insouciant :
— C’est à moi, général, qu’il est arrivé quelque chose ! Mon cheval s’était emballé et je suis arrivée ici juste au moment où Sa Majesté y arrivait elle-même. Nos bêtes se sont cabrées et la mienne m’a jetée à terre. L’Empereur a eu la bonté de me porter secours... Je l’en remerciais.
A mesure qu’elle débitait son petit mensonge diplomatique, elle voyait se détendre la mâchoire crispée de Napoléon et s’adoucir le reflet glacé de son regard. D’un geste désinvolte, il secouait un pan de sa redingote grise où s’attachait une feuille morte.
— Ce n’est rien ! jeta-t-il. N’en parlons plus et rentrons ! Je suis las de cette chasse, d’ailleurs manquée ! Rappelez vos piqueurs et vos chiens, monsieur d’Hannecourt, nous regagnons le château. Quant à vous, madame, vous nous suivrez : j’ai à vous parler, mais vous entrerez par le jardin Anglais. Roustan vous conduira...
— C’est que, Sire, je ne suis pas seule dans ce bois. Une amie...
L’œil gris-bleu de Napoléon se chargea d’un éclair qui, pour une fois, n’était pas féroce mais dénotait un léger amusement.
— Eh bien ! Récupérez votre amie, madame, et venez ! Il y a des gens dont on ne se débarrasse pas facilement, à ce que l’on dirait ! ajouta-t-il d’un ton railleur qui fit comprendre à Marianne qu’il n’ignorait pas l’identité de l’amie en question.
Vivement, elle s’inclina puis, galamment aidée par le général de Nansouty qui offrit sa main gantée pour qu’elle y posât le bout de sa botte, elle s’enleva en selle avec une aisance qui arracha un sourire discret à l’officier de hussards. Il s’y connaissait trop en cavaliers pour être dupe du mensonge courtisan de Marianne. Si quelqu’un était tombé, ce n’était sûrement pas cette irréprochable amazone... mais, sachant son monde, Nansouty se borna à ce sourire.
Il ne fallut à Marianne que quelques secondes pour retrouver Fortunée, quelques autres pour lui raconter ce qui venait de se passer et la chance inattendue, l’espoir nouveau qui en avaient résulté pour elle.
— S’il te reçoit, c’est le principal ! commenta Mme Hamelin. Tu vas passer, sans doute, un bien mauvais quart d’heure, mais l’important, est d’être entendue. Tu as une chance de gagner la partie.
Sans plus s’attarder, les deux femmes rendirent la main à leurs montures et s’élancèrent dans la direction prise par l’Empereur. A la première croisée des chemins elles trouvèrent Roustan qui les attendait, immobile statue équestre de sultan plantée sous un pin sylvestre. Après leur avoir fait signe de le suivre, il piqua des deux vers le château, non sans effectuer un léger détour destiné à éviter que les deux amazones se trouvassent mêlées aux gens de la cour.
Une demi-heure plus tard, par le jardin Anglais l’étang des Carpes et la cour de la Fontaine, Marianne entrait dans ce palais de Fontainebleau, dont elle avait désespéré de forcer l’entrée, n’ayant croisé que des serviteurs. Au rez-de-chaussée, Roustan, après avoir installé Fortunée dans un petit salon désert, ouvrit devant Marianne la porte d’une grande pièce donnant sur un jardin, s’inclina et, de la main, lui indiqua un fauteuil. Une fois de plus, elle se trouvait dans le cabinet de Napoléon. C’était le quatrième dont elle faisait ainsi connaissance, mais, malgré son décor Louis XVI et ses meubles Empire, la pièce, grâce à l’habituel désordre de papiers, de cartes, d’objets personnels et de portefeuilles en maroquin rouge, lui parut tout de suite familière. Comme aux Tuileries, à Saint-Cloud et à Trianon, il y avait la tabatière ouverte, la plume d’oie jetée n’importe où, la grande carte déployée et le chapeau posé sur une console. Cela la réconforta et, avec l’impression d’être un peu chez elle, tant la puissante personnalité de l’Empereur s’entendait à recréer partout son atmosphère, elle attendit avec plus de confiance ce qui allait venir.
Cela vint avec le cérémonial habituel : pas rapides sur les daller de la galerie, porte claquée, traversée en trombe de la pièce, mains au dos, jusqu’à la grande table de travail, vif coup d’œil pour apprécier la révérence de cour et, finalement, entrée en matière sans nuances.
— Alors, madame ? Quelle raison impérieuse vous a poussée à enfreindre mes ordres et à venir m’importuner jusqu’ici ?
Le ton agressif, volontairement blessant, eût amené, chez une Marianne dans son état normal, une réaction du même ordre. Mais elle comprenait que, si elle voulait sauver Jason, il lui fallait fouler son orgueil aux pieds, se faire petite et humble, surtout en face d’un souverain qui, un moment auparavant, avait mordu la poussière à cause d’elle.

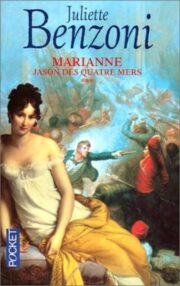
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.