Un peu haletante, Marianne avait suivi, les yeux agrandis, le bizarre récit de son hôtesse.
— Elle était folle, non ? dit-elle enfin.
— Folle d’elle-même, oui, sans doute ! Mais hormis cela, hormis cette passion insensée qu’elle portait à sa propre beauté, elle agissait à peu près normalement. Ainsi la naissance de son fils, don Ugolino, fut marquée par des fêtes sans fin. Un véritable flot d’or et de vin déferla sur les serviteurs et sur les paysans d’alentour. Visiblement, dona Lucinda rayonnait au moins autant d’avoir retrouvé sa silhouette d’antan que d’avoir un héritier d’ailleurs ! Un moment, nous avons tous cru qu’une ère de bonheur s’ouvrait enfin pour la maison. Mais... trois mois après, le prince Sebastiano repartait pour je ne sais quelle terre lointaine où il devait trouver la mort. La construction du petit temple a commencé aussitôt après son départ. Il y avait un peu plus d’un an que Matteo Damiani avait été apporté à la villa...
— Dona Lucinda supportait sa présence ?
— Non seulement elle la supportait, mais, quand son enfant fut né, elle cessa pratiquement de s’en occuper et se mit à marquer une étrange préférence pour le petit bâtard. Elle jouait avec lui comme avec un jeune chiot, s’occupait de la façon dont il était traité, vêtu, mais surtout elle prenait une sorte de plaisir pervers à développer les instincts sauvages de l’enfant qu’elle caressait et tourmentait tour à tour, cherchant à éveiller en lui le goût de la cruauté et du sang. Ce n’était d’ailleurs pas bien difficile ; le terrain était tout préparé. Je peux vous dire qu’à cinq ans, lorsque j’ai quitté la villa, Matteo était déjà une sorte de jeune démon joignant la ruse à la brutalité... D’après ce que j’ai pu apprendre, il n’a, fait que développer ces deux traits de son caractère. Mais, s’il vous plaît, voulez-vous sonner, petite, pour que l’on nous apporte le thé ! Ma gorge est sèche comme un parchemin et, si vous voulez que je parle encore...
— Oui ! Vous m’avez dit tout à l’heure que dona Lucinda était cause de votre départ.
— Je n’aime guère évoquer cette histoire, mais vous occupez désormais sa place. Vous avez le droit de savoir ! Néanmoins... le thé d’abord, s’il vous plaît ?
Ce fut dans un profond silence que les deux femmes prirent le thé chinois qu’un valet discret vint leur servir avec rapidité et sans faire le moindre bruit. Marianne, comme sa compagne, le but avec plaisir parce que, dans cette pièce élégante et douillette, l’odorant breuvage apportait avec lui un peu du parfum du passé. Elle se revoyait, petite fille, puis jeune fille, assise sur un tabouret aux pieds de sa tante Ellis pour sacrifier avec elle à ce rite sacré que, pour rien au monde, lady Selton n’eût négligé. Cette vieille femme en bonnet d’autrefois, ces meubles du siècle passé, jusqu’à l’odeur des roses qui entrait par la fenêtre ouverte, tout rappelait à Marianne les tendres heures de son enfance et elle éprouva, pour la première fois depuis bien des jours, une sensation de détente et d’apaisement comme elle en éprouvait jadis quand, au plus fort d’un chagrin ou d’une colère, tante Ellis venait caresser ses cheveux en lui disant de sa voix bourrue :
— Allons, Marianne ! Tu devrais savoir qu’il n’est rien, en ce monde, dont on ne vienne à bout avec du courage et de la persévérance... principalement soi-même !
L’effet était magique et il était à la fois étrange et réconfortant de le retrouver au fond d’une tasse de thé servie dans une demeure étrangère ! En reposant sur le plateau d’argent la porcelaine fleurie, les yeux de Marianne rencontrèrent ceux de Mrs Crawfurd qui l’observait.
— Qu’est-ce qui vous faire sourire, ma chère ? Je croyais pourtant bien vous raconter de sombres choses !
— Ce n’est pas cela, madame... C’est simplement qu’en prenant le thé, ici, avec vous, j’ai cru un instant me retrouver dans la maison de mon enfance, en
Angleterre ! Mais, je vous en supplie, continuez, s’il vous plaît !
Un moment, le regard sombre de la vieille dame s’attarda sur la jeune femme qui crut y voir apparaître une douceur et une sympathie qu’elle n’y avait encore jamais lues. Mais Eleonora Crawfurd n’en exprima rien et, détournant les yeux vers la fenêtre, elle n’offrit plus à Marianne qu’un profil perdu voilé par le volant de mousseline de son bonnet. Elle reprit alors son récit mais d’une voix si sourde que Marianne, d’abord, eut peine à saisir les premiers mots.
— Il est étrange de constater combien les souvenirs d’un premier amour peuvent demeurer vivaces... et douloureux malgré tant d’années écoulées ! C’est une chose que vous saurez quand, à votre tour, vous vieillirez ! Pour moi, lorsque je pense à Pietro, il me semble que c’était hier que je courais le retrouver, près de la chapelle San Cristoforo, dans le crépuscule mauve et dans l’odeur du foin coupé... Je venais d’avoir quinze ans et je l’aimais. Lui en avait dix-sept. Il était beau et fort... Il habitait le village de Capanori où il vivait seul depuis la mort de son père qui était chaudronnier... Il voulait m’épouser et, chaque soir, nous nous retrouvions... jusqu’à ce soir où il n’est pas venu. Un soir... deux soirs !... personne au village n’a pu me dire où il était allé, mais moi, tout de suite, j’ai eu peur sans bien savoir pourquoi... peut-être parce qu’il ne m’avait jamais rien caché !... La troisième nuit, incapable de trouver le repos, j’ai erré dans le parc, sans autre but que chercher à éteindre mon angoisse. Il faisait une chaleur de four. Même l’eau des bassins était tiède et dans les écuries les chevaux ne bougeaient plus... C’est alors, en passant près de la nymphée, que j’ai entendu chanter... si cela peut s’appeler chanter ! C’était plutôt, rythmée sur un roulement de tambour bas et syncopé, comme une plainte monotone, avec parfois une sorte d’appel. Jamais je n’avais rien entendu de semblable, mais pour oser me promener si près de la maison, et surtout si près de la nymphée qui était interdite aux serviteurs, il fallait que je ne fusse plus dans mon état normal... Quel instinct m’a poussée alors sur le chemin défendu de la clairière et du petit temple ? Je l’ignore toujours. Néanmoins, j’y suis allée, à tâtons et à pas de loup, les mains collées au rocher, m’aplatissant si fort contre lui que j’aurais pu, moi aussi, devenir pierre... Et quand la lumière du temple a frappé mon visage, je me suis reculée, d’instinct, puis, tout doucement, à nouveau, j’ai avancé la tête... alors j’ai vu !
De nouveau le silence. Le cou tendu, Marianne osait à peine respirer de crainte de faire évanouir l’espèce d’enchantement à travers lequel parlait Eleonora. Elle se souvenait trop bien de sa terreur à elle, quand elle avait découvert les ruines et la statue que Matteo Damiani étreignait. Mais elle devinait que l’épreuve subie par cette femme était pire que la sienne et tout doucement elle souffla :
— Vous avez vu...
— Hassan d’abord ! C’était lui qui chantait ainsi. Il était accroupi sur les degrés de marbre, une sorte de petit tambour en forme de calebasse entre les genoux. Ses grandes mains noires, y accompagnaient sa mélopée. La tête levée, il semblait poursuivre dans les étoiles quelque songe morne, mais les torches qui éclairaient l’intérieur du temple faisaient luire comme du bronze sa peau noire et rougissaient le pagne doré et les bijoux barbares qui l’habillaient. Il tournait le dos au temple à travers les colonnes duquel je pouvais voir un lit doré, tendu de velours noir... Un lit sur lequel deux corps se livraient à l’amour... La femme, c’était Lucinda... et l’homme, c’était Pietro !... Mon Pietro !... Je ne sais pas encore, maintenant, comment je ne suis pas morte sur place... Comment j’ai pu trouver la force de m’enfuir !... Mais je sais que, jamais, je n’ai revu Pietro vivant ! Le lendemain, on découvrait son corps, pendu à une branche d’arbre, dans la colline. Et, trois jours plus tard, je partais avec les baladins !...
Cette fois, Marianne laissa s’écouler un long moment sans souffler mot. Elle connaissait si bien le domaine dont elle portait le nom que, ce dramatique récit, elle croyait presque, sinon l’avoir vécu, du moins en avoir vu, de ses yeux, se dérouler les péripéties. Et elle ne s’étonna pas de voir la vieille dame écraser une larme furtive du bout de son doigt. Simplement, quand elle eut l’impression que sa compagne était un peu remise, elle prépara une nouvelle tasse de thé et la lui offrit avant de demander :
— Vous n’y êtes jamais retournée ?
— Si, en 1784, pour voir mourir ma mère qui, elle, n’a jamais quitté le domaine. Elle m’avait pardonné depuis longtemps ma fuite. Au fond, elle avait été heureuse que j’échappe à cette maison maudite où elle avait été le témoin de tant de drames. C’était elle qui avait élevé le prince Ugolino. Elle avait connu aussi l’incendie du temple dans lequel Lucinda avait trouvé une mort atroce autant que volontaire. Pourtant, elle avait espéré, à ce moment-là, en un avenir meilleur puisque le démon familier du domaine avait enfin disparu. Et, un temps, les faits avaient paru lui donner raison. Un an après sa mort, son fils Ugolino épousait la charmante Adriana Malaspina. Il avait dix-neuf ans, elle en avait seize et, depuis longtemps dans la région, l’on n’avait vu couple mieux assorti ni plus amoureux. Pour Adriana qu’il adorait, Ugolino maîtrisait sa violence naturelle et son caractère difficile. Il ressemblait beaucoup à sa mère, hélas, mais, de loup qu’il était, se faisait agneau pour sa jeune femme. Certes, ma mère a cru, vraiment, que le temps des malheurs était révolu...
Lorsque, après un peu plus d’un an de mariage, Adriana s’est trouvée enceinte, Ugolino l’a entourée de tous les soins imaginables, veillant sur elle jours et nuits, poussant l’attention jusqu’à faire emmailloter les sabots des chevaux pour que leur bruit ne troublât point son repos. Et puis l’enfant est né... et le malheur est revenu. Ma mère, au moment de mourir, a voulu décharger un peu son cœur du poids qui l’étouffait et, avant d’être entendue par le prêtre, avant de recevoir les derniers sacrements, elle m’a avoué le double drame du printemps 1782...

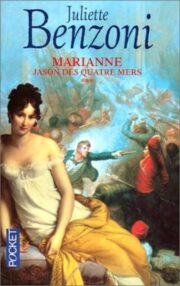
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.