— Antonia !... Antonia !...
Arrachée à son chagrin égoïste, Marianne vit une femme passer près d’elle, les cheveux dénoués sur des lambeaux de mousseline blanche, courant éperdument vers le brasier malgré son ventre déformé par la grossesse, les bras tendus. Avec épouvante, elle reconnut la princesse Schwartzenberg, belle-sœur de l’ambassadeur, et s’élança derrière elle pour l’arrêter.
— Madame ! Madame !... Où allez-vous ? Par pitié...
La jeune femme posa sur elle des yeux trop dilatés par l’épouvante et l’angoisse pour qu’elle pût seulement espérer être vue.
— Ma fille !... balbutia-t-elle... mon Antonia ! Elle est là !
D’une brusque secousse, elle échappa à l’étreinte de Marianne laissant entre ses mains un peu de mousseline fripée et reprit sa course aveugle. Toujours appelant, elle atteignit l’incendie. Il y eut un craquement énorme. Le plancher de la salle de bal, construit au-dessus d’un bassin à sec, venait de s’effondrer ouvrant dans les flammes un gouffre dans lequel Marianne vit disparaître aussitôt la silhouette de la pauvre mère.
Malade d’horreur, l’estomac révulsé, Marianne se plia en deux et vomit. Ses tempes battaient et elle était trempée de sueur. En relevant les yeux, elle vit avec dégoût que les musiciens de l’orchestre, qui s’étaient aussi enfuis dans le parc, se jetaient vers les blessés pour les dépouiller de leurs joyaux. Et, malheureusement, ils n’étaient pas les seuls : la populace qui, grimpée sur les murs de l’ambassade, avait suivi le feu d’artifice avec des grondements de joie, maintenant, se jetait, elle aussi, à la curée. Par bandes, des gens de mauvaise mine glissaient pardessus les murs jusque dans les jardins avec les yeux luisants d’une bande de loups affamés et s’élançaient au pillage sans faire plus de bruit que des serpents.
Le personnel de l’ambassade, malgré ses efforts, était impuissant à lutter contre cette marée sordide, au moins aussi dangereuse que le feu. Quelques hommes tentaient de défendre les femmes attaquées ; malheureusement, ils n’étaient pas assez nombreux pour combattre efficacement les pillards.
« Mais enfin, songea Marianne épouvantée, il devrait y avoir des pompiers, des soldats... L’escorte armée de l’Empereur... »
L’Empereur, hélas, était parti et son escorte avec lui. Combien de temps faudrait-il pour qu’un régiment vînt mettre de l’ordre et faire reculer les bandits ? Une main, soudain, s’abattit sur elle, arracha son diadème et une mèche de cheveux, puis, empoignant son collier d’émeraudes, tira pour en faire céder le fermoir. Terrifiée, Marianne hurla.
— Au secours ! Au vol !...
Une autre main, brutale et malodorante, lui ferma la bouche. D’instinct alors, elle se débattit contre son agresseur, un homme au long visage blême, aux yeux cruels, vêtu d’une blouse sale sentant la sueur. Griffant et mordant, elle parvint à lui glisser des mains et chercha à s’enfuir, les doigts sur son collier, mais il se jeta en avant de tout son poids et la reprit contre lui. Contre son cou, elle sentit la morsure d’une lame d’acier.
— Donne ça ! ordonna l’homme d’une voix éraillée, sinon j’te saigne !
Il appuya légèrement. L’acier entama la chair tendre. Paralysée de terreur, Marianne leva des mains tremblantes jusqu’à sa gorge, détacha le collier qui glissa sur la manche de l’homme, puis elle ôta les scintillantes girandoles de ses oreilles. Le couteau s’éloigna. Marianne crut qu’il allait enfin la lâcher, mais il n’en fit rien. L’homme ricana et se pencha sur elle. Contre son visage, elle sentit une haleine empestée de mauvais vin et hurla de dégoût, mais une bouche humide et froide s’abattit sur la sienne et étouffa le cri sous un baiser qui lui leva le cœur. En même temps, l’homme, qui la serrait contre lui, la poussa brutalement vers un massif d’énormes pivoines qui gardait l’entrée d’un bosquet.
— Viens par là, poulette ! Une belle fille, on n’la laisse pas filer sans y goûter, surtout une d’la haute ! C’est trop rare !
Délivrée de l’odieuse bouche, Marianne tenta de résister et se remit à crier, des cris stridents, nerveux, suraigus, des cris de folle que l’autre ne parvint pas à endiguer. Alors, de toutes ses forces, il la gifla et la jeta à terre. Il se penchait déjà pour la traîner sous les branches quand une forme humaine jaillit de l’ombre du bosquet, tomba sur l’homme et le rejeta à deux pas de Marianne. A la lumière rouge de l’incendie, elle reconnut Tchernytchev. Une balafre saignait sur son front et son uniforme était à moitié brûlé, mais il ne paraissait pas blessé.
— Ecartez-vous ! gronda-t-il. Par saint Vladimir, je vais étriper ce moujik !
Il ne regardait pas Marianne. Dans les lueurs dansantes et sinistres, elle vit ses yeux verts briller d’une joie sauvage, celle du combat prochain. Les mains ouvertes, prêtes à saisir, ramassé sur lui-même, sans arme et parfaitement insoucieux de sa récente blessure, il faisait face au malfaiteur et à son couteau de boucher.
— Il m’a volé mes bijoux, murmura Marianne en portant la main à sa gorge meurtrie où le collier avait laissé une marque saignante quand le bandit avait tiré dessus.
— Rien d’autre ? Il ne vous a pas violée ?
— Il n’a pas eu le temps, mais...
— Allez vous mettre à l’abri. Je reprendrai vos joyaux... Quant à ce misérable, il peut remercier Notre-Dame de Kazan ! Chez moi, je l’aurais fait périr sous le knout pour avoir seulement osé vous toucher.
L’homme éclata de rire et cracha une insulte ignoble puis assura son couteau dans sa patte noire.
— Mais il est armé ! gémit Marianne. Il va vous tuer.
Les yeux rétrécis, au point de n’être plus que de minces fentes obliques, surveillant attentivement son adversaire, le colonel des Cosaques éclata de rire.
— Lui ? Son couteau ne lui sauvera pas la vie. Mes mains savent dresser les chevaux sauvages et tuer les ours ! Dans deux minutes, je l’aurai étranglé, couteau ou pas !
Et, dans une détente de ses jarrets d’acier, Tchernytchev sauta à la gorge du malfaiteur qui, surpris et déséquilibré, s’abattit lourdement sur le sol avant d’avoir eu le temps de frapper. Râlant, à demi étranglé, il se débattit sous la poigne féroce du Russe. Le couteau avait glissé de sa main et Marianne, se courbant vivement, essaya de le saisir. Mais l’homme était fort malgré sa taille maigre. Déjà il s’était repris et, d’un sursaut, il avait libéré son cou. Les deux hommes, roulant l’un sur l’autre, aussi étroitement enlacés que deux serpents furieux, se livrèrent un combat sauvage sur l’herbe humide d’une pelouse.
Le Russe savait se battre au corps à corps et Marianne n’était pas très inquiète pour lui. Elle était certaine qu’il sortirait vainqueur de cette bataille. Mais, soudain, elle remarqua avec effroi deux autres hommes, en blouse eux aussi et en casquettes à pont, qui rampaient silencieusement vers les combattants : des camarades de son agresseur, sans doute, qui arrivaient à la rescousse. Cette fois, la partie ne serait plus égale et, en un éclair, elle comprit que Tchernytchev allait avoir besoin d’aide. Se retournant vivement elle vit qu’une troupe de soldats envahissait le parc en escaladant les murs, portant des civières et du matériel de secours. Rassemblant les lambeaux de sa robe, elle courut vers eux, avisa un groupe d’hommes en uniforme vert qui se penchaient sur les blessés et saisit l’un d’entre eux par le bras.
— Le comte Tchernytchev ! s’écria-t-elle ! Vite ! Il est en danger ! Ils vont le tuer !
Celui dont elle avait pris le bras se retourna, la regarda... Et si puissante était l’atmosphère d’irréalité de cette nuit désastreuse que Marianne fut à peine surprise de reconnaître Napoléon en personne. Noir de suie, son uniforme de colonel des chasseurs plein de trous, il s’apprêtait à emporter une femme blessée qui gémissait doucement sur un banc de pierre. C’était sans doute lui qui, en revenant vers l’ambassade sinistrée, avait ramené les secours qui, maintenant, prenaient possession du parc.
— Qui va le tuer ? dit-il seulement.
— Des hommes... là, dans le bosquet ! Ils m’ont attaquée et le comte est venu à mon secours ! Vite, ils sont trois, armés... et il est seul sans autre défense que ses mains...
— Qui sont ces hommes ?
— Je ne sais pas ! Des bandits ! Ils sont venus par-dessus le mur...
L’Empereur se redressa. Sous les sourcils froncés, ses yeux gris étaient durs comme de la pierre. Il appela :
— Eugène ! Duroc ! Par ici ! Il paraît qu’on assassine maintenant.
Et flanqué du vice-roi d’Italie et du duc de Frioul, l’Empereur des Français vola, de toute la vitesse de ses jambes, au secours de l’attaché russe. Rassurée sur le sort de Tchernytchev, Marianne revint machinalement vers les bassins. Elle ne savait plus bien ni que faire ni où aller. Sans surprise comme sans joie, elle vit enfin arriver les pompiers, ou tout au moins un semblant de pompiers car ils n’étaient que six... et incroyablement ivres par-dessus le marché. Elle entendit les cris de fureur de Savary.
— Vous n’êtes que six ? Où sont les autres ?
— On... on ne sait pas, mon... mon général !
— Et votre chef ? Cet imbécile de Ledoux ? Où est-il ?
— A... à la campagne, mon général.
— Six ! hurla Savary ivre de rage, six sur deux cent quatre-vingt-treize ! Et où sont les pompes ?
— Là... mais on n’a pas d’eau. Les bouches à eau des Grands Boulevards sont fermées à clé et on n’a pas la clé.
— Et elle est où cette clé ?
Le pompier eut un geste évasif qui porta à son comble le courroux du ministre de la Police. Marianne le vit partir comme une flèche, traînant après lui le malheureux qui faisait des efforts désespérés pour conserver son équilibre et ne se doutait certainement pas qu’il allait affronter une seconde plus tard une colère infiniment plus redoutable que celle d’un ministre.

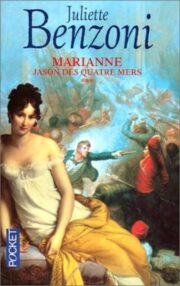
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.