Tandis qu’elle cherchait vainement quelque chose à dire qui ne fût pas stupide ou navrant, elle avait conscience de l’examen minutieux que lui faisait subir le regard de l’Américain et elle en souffrait comme d’une injustice. Depuis si peu de temps à Paris, il n’avait pas encore eu celui d’apprendre son mariage, bien certainement, et sans doute pensait-il que Napoléon entretenait fastueusement sa maîtresse. Ses yeux étincelants allaient des émeraudes à la robe d’or, revenaient aux émeraudes, impitoyables, accusateurs...
Son silence devenait gênant, malgré les crépitements du feu d’artifice. Marianne n’osait même plus lever les yeux sur Jason par crainte qu’il n’y vît des larmes. Pensant avec peine qu’ils n’avaient plus rien à se dire, elle se détourna lentement pour regagner les salons quand il l’arrêta.
— Voulez-vous me permettre, madame... ?
— Oui ? fit-elle, envahie d’un espoir involontaire et se raccrochant d’instinct à ces cinq petits mots qui la retenaient.
— J’aimerais vous présenter ma femme.
— Votre...
La voix de Marianne s’étouffa. Soudain, toute énergie l’abandonna. Elle se sentit faible, perdue, désemparée et chercha machinalement quelque chose pour soutenir son émotion. Ses mains se serrèrent sur l’éventail brusquement replié, si fort que les minces branches d’ivoire craquèrent. Mais, sans voir son trouble, Jason tendait la main, attirait une femme dont Marianne, tout à son émoi, n’avait pas remarqué la présence dans l’ombre de l’Américain. Elle vit surgir de cette ombre, avec autant d’effroi que s’il se fût agi d’un fantôme, une jeune femme petite et mince, vêtue d’une robe de drap d’argent recouverte de dentelle noire. A la mode espagnole, la nouvelle venue portait, dans ses cheveux sombres, un haut peigne recouvert d’une mantille de même dentelle que sa robe et une rose pâle, semblable à celles qui s’épanouissaient au creux de son décolleté. Sous la mantille, Marianne vit un jeune visage sérieux, aux traits bien ciselés, aux lèvres fines mais marquées d’un pli de tristesse étonnant chez une créature de cet âge, de grands yeux sombres, mélancoliques, des sourcils délicatement tracés sur une peau claire. L’ensemble donnait une impression de fragilité physique, mais l’expression du visage décelait l’orgueil et l’obstination.
Etait-elle jolie, cette femme surgie brutalement d’une nuit d’été pour saccager la joie nouvelle de Marianne ? Au prix de sa vie, celle-ci eût été incapable de le dire. Son esprit, son cœur, ses yeux n’étaient plus habités que par une immense déception qui, peu à peu, se faisait douleur. C’était comme la grisaille quotidienne d’un matin de novembre au sortir d’un rêve plein de chaleur, de joie et de lumière et, un instant, Marianne eut la tentation de fermer les yeux, pour se rendormir et retrouver le rêve... Comme du fond de la brume elle entendit Jason s’adresser à l’inconnue et, malgré son désarroi, remarqua qu’il parlait en espagnol.
— Je désire vous faire connaître une ancienne amie. M’y autorisez-vous ?
— Naturellement... si c’est vraiment une amie !
Le ton, vaguement dédaigneux et surtout méfiant, hérissa Marianne. Une brusque colère chassa momentanément la douleur et lui fit du bien en lui rendant la maîtrise d’elle-même. Dans le plus pur castillan, elle demanda avec un sourire moqueur qui rendait dédain pour dédain :
— Pourquoi ne serais-je pas « vraiment » une amie ?
Les beaux sourcils de l’autre se relevèrent légèrement, mais ce fut avec beaucoup de gravité qu’elle répondit :
— Parce qu’il semble que, dans ce pays, l’on n’attache pas, au mot amitié, la même signification profonde que chez nous.
— Chez vous ? Vous êtes espagnole, sans doute ?
Jason, avec l’instinct sensible des gens de mers habiles à flairer les tempêtes, même bénignes, se hâta de répondre en prenant la main de sa femme qu’il glissa sous son bras et garda dans la sienne :
— Pilar est originaire de Floride, dit-il doucement. Son père, don Agostino Hernandez de Quintana, possédait de grandes terres à Fernandina, près de notre frontière. Si la ville est petite, le pays est immense, plus qu’à demi sauvage, et Pilar voit l’Europe pour la première fois.
La jeune femme leva sur lui un regard qui ne s’éclaira pas.
— Et pour la dernière, je l’espère ! Je ne tiens pas à y revenir, pas plus qu’à y rester, car je ne m’y plais pas. Seule l’Espagne m’attirerait, mais il ne peut être question, hélas, de s’y rendre, avec la guerre affreuse qui la ravage ! Maintenant, querido mio, voulez-vous me dire le nom de cette dame ?
« Une sauvagesse ! fulmina intérieurement Marianne, une primitive confite dans la religion et la morgue ! Et une ennemie de l’Empereur, j’en jurerais ! Suis-je donc destinée à ne rencontrer ici, ce soir, que des sauvages ? Après le Mongol, cette fille ! »
Elle était excédée et retenait mal une colère qui faisait trembler chaque fibre de son être. Et comme Jason ouvrait la bouche pour la présenter et, ignorant son mariage, allait sans doute émettre une épouvantable bourde, elle coupa, sèchement :
— Ne vous donnez pas cette peine. Comme vous l’avez dit vous-même, Mrs Beaufort a toutes les excuses pour ne pas connaître son monde. Souffrez donc que je la renseigne moi-même. Je suis la princesse Corrado Sant’Anna, madame, et si j’ai à nouveau l’avantage de vous revoir, ce que j’espère vivement, sachez que j’ai droit au titre d’Altesse Sérénissime !
S’interdisant alors de voir la stupeur envahir le regard bleu de Jason, elle fit une courte révérence et leur tourna carrément le dos pour s’éloigner et chercher Talleyrand. D’ailleurs, au milieu des applaudissements, le feu d’artifice se terminait dans une sorte d’Apocalypse multicolore exaltant les deux aigles impériales, la française et l’autrichienne, unies par la magie de MM. Ruggieri. Mais ce remarquable morceau de pyrotechnie n’obtint de Marianne qu’un regard méprisant.
« Ridicule, pensa-t-elle. Ridicule et pompeux ! Autant que moi quand j’ai jeté mes titres à la tête de cette péronnelle ! Mais c’est uniquement sa faute. J’aurais voulu la voir rentrer sous terre ! Je voudrais, oui... je voudrais la voir morte... Penser qu’elle est sa femme, sa femme ! »
Les deux petites lettres possessives qui reliaient désormais Pilar à Jason causaient à Marianne une irritation douloureuse comme une piqûre d’abeille. La vieille envie de fuir la reprenait. Ce besoin primitif, venu probablement du fond des âges par le truchement de quelque ancêtre nomade, qui s’emparait d’elle chaque fois qu’une souffrance atteignait son cœur, non par lâcheté ou par crainte de faire face, mais par besoin de mieux dissimuler aux regards étrangers sa propre émotion et de trouver dans l’éloignement et la solitude une espèce de calmant.
Machinalement, elle suivit la foule vers la salle de bal où les violons faisaient rage de nouveau en attendant l’annonce du souper, avec l’idée de continuer tout droit jusqu’à sa voiture, jusqu’à la paix de sa maison et de sa chambre. Cette ambassade et tous les gens qui l’emplissaient lui faisaient horreur maintenant. Même la présence de Napoléon, assis sur le trône rouge et or, préparé pour lui et Marie-Louise au fond de la salle, n’y pouvait rien. Elle voulait s’en aller. Mais elle vit soudain un groupe de dames se diriger vers elle avec Dorothée et la comtesse Kielmannsegge, et cette vue lui arracha une exclamation de contrariété. Elle allait devoir papoter, échanger des paroles futiles, des niaiseries quand elle avait tellement besoin de silence pour écouter les étranges cris que poussait son cœur... et essayer d’y comprendre quelque chose. Non, cela, c’était impossible, elle ne pourrait pas le supporter...
Presque simultanément, elle vit, à deux pas d’elle, l’uniforme vert sombre de Tchernytchev qui la regardait et, sans plus réfléchir, se tourna vers lui.
— Vous m’avez demandé une danse, comte ! Celle-ci est à vous si vous le souhaitez.
— C’est une question cruelle, madame ! On ne demande pas au croyant s’il souhaite atteindre la divinité.
Froidement, elle planta son regard vert dans celui du Russe :
— Je ne désire pas que vous me fassiez la cour, mais seulement que nous dansions cette valse, fit-elle nettement.
Cette fois, il ne répondit pas, se contentant de s’incliner avec un sourire qui fit briller ses dents blanches. Au bord de la piste de danse, Marianne laissa tomber son éventail brisé, drapa calmement sa longue traîne dorée sur son bras et livra sa taille au bras de son cavalier. Il s’en empara comme d’une proie, l’emportant presque au milieu des danseurs avec une ardeur qui lui arracha un sourire mélancolique.
Elle n’aimait pas cet homme, mais il la désirait, ne s’en cachait pas et, dans l’état de désarroi où se trouvait Marianne, c’était, à tout prendre, assez réconfortant de rencontrer un être éprouvant quelque émotion, même de cet ordre ! Il dansait à la perfection, avec un sens étonnant de la musique, et Marianne, tourbillonnant dans ses bras, eut l’impression de flotter dans l’air. La valse la délivrait du poids de son propre corps. Pourquoi donc son esprit troublé refusait-il de se laisser libérer lui aussi ?
En dansant à travers la vaste salle, elle aperçut l’Empereur, assis sur son petit trône, l’Impératrice à ses côtés, lui parlant à voix basse, mais son regard ne s’y arrêta pas. Ces deux-là ne l’intéressaient plus. Tchernytchev, déjà, l’emportait plus loin, sa main gantée fermement appuyée au creux de la taille de la jeune femme. Elle vit alors Jason qui dansait avec sa femme. Leurs regards, un instant, s’accrochèrent, mais Marianne, avec irritation, détourna le sien puis, brusquement, poussée par le trop féminin démon de la coquetterie, par ce besoin viscéral que possède toute femme blessée de rendre coup pour coup, douleur pour douleur, elle adressa au Russe un sourire éblouissant.

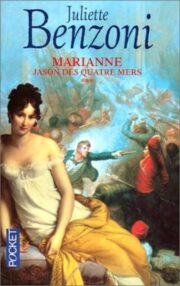
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.