— Et quoi ?
— Combattre, ma chère, c’est la seule manière d’espérer obtenir un jour la victoire.
— Encore faudrait-il posséder des armes.
— Les armes, cela se forge. La première chose importante est d’obtenir une vue claire de ce qui se passe ou s’est passé dans votre banque. Ainsi, demain, j’obtiendrai les noms de ceux qui en composent le conseil d’administration. Nous verrons bien s’il en subsiste quelques-uns parmi ceux qui formaient votre conseil de tutelle. Lequel conseil, bien sûr, a cessé d’exercer ses droits au jour de votre mariage. Ensuite, vous pourriez essayer de voir ce M. Vernet…
— Je vous ai dit que j’ignorais son adresse et cela m’étonnerait qu’on me la donne.
— A vous, non. Mais Livia, ma femme de chambre, est une parfaite comédienne. Nous l’enverrons, sous un déguisement, demander cette adresse. Ne fût-ce qu’au concierge de la banque. Et vous irez le voir discrètement. Je suppose qu’il doit être au courant de bien des choses. Le seul fait qu’on l’ait écarté en est une preuve. Ensuite, il faudra essayer de savoir ce que mon frère avait pu découvrir au juste touchant la mort de vos parents. Le sort que l’on vous fait me laisse supposer qu’il pourrait avoir raison… et qu’il y a eu crime.
Hortense devint soudain très rouge.
— Pardonnez-moi, mon amie, je me suis montrée d’un égoïsme incroyable en ne vous demandant même pas de nouvelles de ce jeune homme qui, pour avoir voulu m’avertir, a été jeté en prison… En vérité, je suis impardonnable.
— Impardonnable ? Mon Dieu non, dit Félicia, dont la voix se chargea tout à coup d’une lourde tristesse. Je serais bien incapable de vous en donner, des nouvelles. Je… Je ne sais toujours pas ce qu’il est devenu. Sans doute est-il toujours prisonnier, mais où ? Voilà ce que j’ignore, ce que je n’arrive pas à savoir. Dieu sait pourtant que, depuis mon arrivée en France, j’ai tout essayé.
— Mais, après son arrestation, il a dû être jugé ?
— Apparemment non. D’ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un agitateur politique, on se garde bien, ici, de le traduire en jugement. On l’enferme simplement. Où et pour combien de temps ? Personne n’en sait rien. Même ses compagnons carbonari n’ont rien pu me dire. Ce secret, c’est la force de la police, de ce qu’on appelle la justice, ici. Mais je ne désespère pas…
Tout en parlant, elle avait pris, sur une petite table de desserte, une boîte de bois des îles qu’elle ouvrit. A sa grande stupeur, Hortense vit qu’elle y prenait un long et mince cigare, en coupait l’une des extrémités puis, avec les gestes sûrs que crée l’habitude, l’allumait à l’une des bougies des chandeliers qui éclairaient la table. Ensuite, elle se laissa aller sur son siège et tira quelques longues bouffées, le regard perdu dans la fumée bleue du cigare dont l’odeur fine prit possession de la pièce…
Elle avait fermé les yeux pour mieux la savourer et, pendant un instant, le silence habita la petite salle à manger intime avec ses tentures jaunes et ses boiseries dorées qui reflétaient la lumière des chandelles. Hortense était tellement stupéfaite que c’était tout juste si elle osait respirer.
Consciente de l’effet produit, Félicia entrouvrit les yeux et sourit :
— Gageons que vous pensez à la tête que ferait la Mère de Gramont, notre directrice du Sacré-Cœur, si elle était à votre place en ce moment. En fait, j’en ai une idée assez claire en voyant la vôtre. Je vous choque horriblement ?
— Horriblement, non… Un peu tout de même. C’est… une habitude d’homme !
— Manger aussi est une habitude d’hommes, et boire. Pourtant toutes les femmes mangent ou boivent… certaines plus que les hommes même. J’en suis venue à penser qu’il n’y avait aucune raison pour qu’une femme ne fume pas. D’ailleurs, je ne suis pas la seule à Paris.
— Les dames fument ici ?
— Les dames non, ou alors en cachette. J’en connais au moins une qui le fait ouvertement : la baronne Aurore Dudevant, une Berrichonne qui est la maîtresse d’un publiciste et qui écrit. Il est vrai qu’elle s’habille parfois en homme et se fait appeler George mais ce n’en est pas moins une créature fascinante, d’une remarquable intelligence. D’après ce que je sais d’elle, je lui crois du talent. Deux ou trois fois, je l’ai rencontrée dans les salons, chez Julie Davillier, chez les Delessert. C’est là qu’elle m’a expliqué les vertus du cigare : il a des pouvoirs miraculeux pour aider à la détente et à la réflexion. Voulez-vous essayer ?
— Dieu non ! fit Hortense en riant. Cela ne me tente pas le moins du monde.
Félicia se leva, posa son cigare dans une coupelle d’onyx, chassa la fumée qui l’environnait puis vint à Hortense et, fraternellement, la prit dans ses bras :
— Ne vous découragez pas mon amie, fit-elle avec une soudaine gravité. Dites-vous que vous n’êtes plus seule dans ce Paris plein de pièges. Je suis à vos côtés pour autant qu’il vous plaira que j’y reste et, à nous deux, je nous crois capables de vaincre n’importe quelle difficulté…
— Vous êtes bonne de me dire cela mais vous avez une vie déjà si compliquée, chère Félicia ! Je crains vraiment de vous la compliquer davantage…
— Chassez ce souci. Vous m’apportez au contraire la compagnie, l’appui… peut-être l’affection.
— N’en doutez pas un seul instant !
— J’en avais, figurez-vous, le plus grand besoin.
La minute d’émotion passa sur les deux jeunes femmes, également belles, également éprouvées par la vie mais qui étaient persuadées de pouvoir, à présent, s’appuyer l’une sur l’autre comme deux arbres un peu fragiles menacés par une tempête mais qui savent qu’en s’étayant l’un l’autre, ils acquerront de la force. Elles s’embrassèrent en se souhaitant une bonne nuit. Puis Félicia alla reprendre son cigare pour l’achever au salon tandis qu’Hortense remontait chez elle.
Enveloppée dans une robe de chambre de laine bleue qu’elle devait à la générosité d’Amicie Brémont, Hortense s’assit devant le petit bureau plat installé près d’une des deux fenêtres de sa chambre et se mit en devoir de faire son courrier. Elle disposa une feuille blanche sur le sous-main de cuir blond, la lissa d’un revers tout en cherchant ses premiers mots puis choisit une plume qu’elle tailla soigneusement et la trempa dans l’encre.
Cette première lettre s’écrivit toute seule. C’était très simple : Hortense l’adressait au docteur Brémont et à sa famille. Elle leur avait promis, en effet, de donner de ses nouvelles dès son arrivée et elle ne voulait pas qu’un retard, si léger fût-il, ne pût les laisser dans l’inquiétude ou, pire encore, leur faire croire que Paris pouvait lui faire oublier leur extrême gentillesse et les bienfaits qu’elle en avait reçus…
Mais, sa lettre achevée, Hortense reposa la plume et adossée au velours de son fauteuil s’accorda quelques instants de réflexion. Car c’était à présent un moment rare, un moment qu’il s’agissait de savourer dans toute sa plénitude : elle allait écrire à Jean de la Nuit, à l’homme qu’elle aimait et dont l’absence lui était aussi cruelle sinon plus que celle de son enfant.
C’était à François Devès, le fermier de Combert, qu’elle pensait adresser sa lettre car elle ne voyait vraiment aucun autre moyen de la faire tenir à Jean sans risquer de la voir tomber entre des mains hostiles…
Elle resta là un long moment, le regard perdu dans les flammes qui léchaient les grosses bûches et dont la chaude lumière se reflétait sur la dorure d’un cadre ou la sombre glace d’un grand miroir ancien. Le feu la ramenait à Lauzargues dans la chambre aux tentures vertes où, dans le petit secrétaire qui avait appartenu à sa mère, elle avait découvert l’ancien amour de Victoire pour un jeune paysan qui s’appelait François, où elle-même avait écrit sur des feuilles de papier jaunies les menus faits de sa vie quotidienne et les premiers émois d’un amour qui n’osait même pas dire son nom. Oui, le feu abolissait le temps, la distance. Il suffisait d’un tout petit effort d’imagination pour se croire encore là-bas…
Bien sûr, il y avait peu de chances d’entendre, dans le lointain, le hurlement d’un loup. Le roulement d’une voiture sur le pavé de la rue acheva de chasser l’illusion mais déjà Hortense recréait au plus chaud de son cœur la puissante silhouette de Jean, son rude visage aux yeux clairs, l’éclair blanc de ses dents quand il riait et la douceur de ses mains quand elles se posaient sur elle. Oh ! retrouver tout cela… cette chaleur… cette passion qu’ils vivaient à deux dans l’accord total de leurs corps et de leurs âmes, cette passion qu’un petit enfant faisait vivre à présent.
— Mon tout-petit… murmura Hortense, bouleversée à la pensée de ce morceau d’elle-même qu’on lui avait à peine laissé le temps d’embrasser avant de l’emporter chez une nourrice dont elle ne savait même pas le nom. Elle le revoyait pourtant bien clairement, son petit Étienne, avec ce visage si semblable à celui de Jean et l’arrogante crête de cheveux noirs qui surmontait son crâne rond de petit Auvergnat solide. Quand le reverrait-elle ? Combien de semaines, de mois s’écouleraient avant que ce grand bonheur lui soit donné, avant que l’enfant puisse enfin connaître les traits de sa mère ? Jean avait promis : « Je te le rendrai… » Mais où, quand, comment ? Déjà fallait-il qu’il le retrouvât et l’Auvergne était vaste, autant que la ruse du marquis de Lauzargues…
Hortense se redressa, reprit sa plume. A présent, le lien distendu par le voyage s’était resserré. Elle pouvait s’adresser à Jean comme si elle l’avait quitté la veille, comme si elle devait le revoir le lendemain. La plume posée sur la blancheur du papier traça d’elle-même :
« Mon amour… »
Il était tard quand, enfin, Hortense cacheta sa lettre à l’intérieur d’une autre lettre, beaucoup plus courte, destinée à François. Mais elle ne sentait plus la fatigue, ni la crainte des jours à venir. Peut-être que, dans quelque temps, Jean trouverait pour eux et l’enfant un asile inviolable dans quelque vallée profonde au cœur d’une forêt immense. Alors Hortense repartirait vers lui, abandonnant sans l’ombre d’un regret ses espoirs de vie confortable, sa fortune aux mains de ceux qui la convoitaient si fort… et même sa réputation…

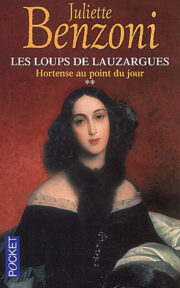
"Hortense au point du jour" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hortense au point du jour". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hortense au point du jour" друзьям в соцсетях.