Tandis qu’Hortense, enfin terrassée par la fatigue, s’endormait dans une aimable chambre tendue de satin vieil or à palmettes blanches, Félicia dans la sienne, plus virile, où l’aigle impériale et le lion de Venise se faisaient face, l’une éployée sur un lutrin, l’autre passant superbement sur le marbre blanc de la cheminée, Félicia resta longtemps les yeux ouverts dans l’obscurité entretenue par les grands rideaux de velours pourpre. Apparemment, sa rêverie lui donnait toutes satisfactions car elle souriait encore lorsque enfin, au petit matin, elle s’endormit alors qu’au-dehors les bruits de la rue commençaient à s’éveiller.
L’hôtel qu’habitait la comtesse Morosini avait appartenu au marquis de La Ferté, commissaire général des Menus-Plaisirs du Roi, mais c’était une maison assez petite et qui n’avait rien d’officiel. Le marquis y avait logé ses propres menus plaisirs sous les espèces juvéniles et moelleuses d’une ravissante demoiselle d’opéra. C’était une sorte de bonbonnière qui allait assez mal d’ailleurs à l’altière beauté de Félicia. Les amours joufflus, enrubannés de bleu tendre qui folâtraient au-dessus des portes, les rinceaux abondamment dorés décorant les frises et les pilastres, certaines peintures du grand salon où des nymphes coquines, fort rebondies du postérieur jouaient à cache-cache avec de galants chèvre-pieds à la barbe follette et à cornes vertes au milieu de buissons de roses, tout cela suggérait les fêtes galantes et les fins soupers.
— Ce décor me donne mal au cœur, expliqua la maîtresse de maison à son invitée, mais mon propriétaire y tient essentiellement. Et comme le prix de location est peu élevé, je m’efforce de ne pas voir ces horreurs.
— Vous êtes peut-être un peu sévère. J’admets que cela ne vous va pas mais ce n’est pas si vilain…
— Il paraît même que c’est assez touchant. C’est du moins ce que prétendent certains de mes « fidèles » que vous verrez ce tantôt. Le vicomte de Vanglenne surtout qui a la larme à l’œil chaque fois qu’il contemple la petite nymphe au voile bleu qui est près de la deuxième fenêtre. On dit qu’elle lui rappelle ses amours défuntes. Des amours qui n’étaient pas sa femme, bien sûr. On n’imagine pas une vicomtesse en semblable appareil…
Si elle n’avait pas touché aux pièces de réception, Félicia s’était rattrapée sur son appartement privé et les chambres du premier étage. Là s’épanouissaient à loisir les sévères splendeurs de l’Empire défunt, les acajous luisants, les sphinx et les victoires de bronze, les tentures semées d’abeilles ou de palmettes. Dans cette maison vouée aux fastes parfumés de l’Ancien Régime, un pareil décor était presque un défi.
— Personne n’y vient, rassura Félicia, uniquement ceux que j’aime ou dont je suis sûre. La coterie qui fréquente chez moi n’a droit qu’au rez-de-chaussée. Vous pourrez y voir, tout à l’heure, une étonnante collection de vieilles perruques mêlées à quelques étrangers qui m’aident à soutenir une réputation un peu excentrique. Mais mon salon est très « bien-pensant »… à la limite de l’ultra.
Hortense supposa qu’elle plaisantait, elle comprit qu’il n’en était rien quand Timour, toujours en habit noir mais le crâne caché sous une perruque blanche de livrée qui en faisait une sorte d’épouvantail, introduisit dans le salon une étonnante collection de vieilles personnes qui, brusquement, ressuscitèrent sous ses yeux tout ce qui avait été l’élégance de Versailles : larges robes tout de même dépouillées des encombrants paniers, joues de pastel, mouches et vastes chapeaux fleuris. Les femmes arboraient de longues anglaises poudrées qui glissaient le long de leur cou fané, des corsets à longue pointe qui leur faisaient une taille de guêpe. Les hommes avaient des habits de velours brodés et des perruques terminées par de courtes queues retenues par un ruban de taffetas noir. Et tout ce monde s’abattit dans les fauteuils et les canapés formant une étrange et archaïque toile de fond sur laquelle tranchèrent les toilettes modernes de quelques jeunes femmes et les habits signés Blin ou Staub qui sanglaient leurs compagnons.
Dans une robe de velours noir appartenant à Félicia, Hortense reçut un accueil flatteur tempéré par le respect que l’on doit à un deuil. Une ou deux douairières crurent lui faire un immense plaisir en lui parlant de « ce cher, cher marquis » que l’on avait eu plaisir à recevoir lors de son dernier passage à Paris et dont on avait applaudi l’accueil qu’il avait reçu de Sa Majesté. On lui posa quelques vagues questions sur sa vie en Auvergne puis comme, décidément, elle n’avait rien à dire de nouveau pour tous ces gens avides de potins, on la laissa finalement dans son coin.
La conversation générale roulait sur le théâtre. Certains des visiteurs étaient allés récemment voir la nouvelle pièce de M. Victor Hugo, cet Hernani qui déchaînait le scandale à chaque représentation. Et naturellement, on n’avait pas du tout aimé. Un marquis dont les bons mots auraient dû faire la joie de Mme de Pompadour prit un air important pour déclarer :
— Cette pièce est une honte. Songez, mesdames, que l’on y voit un grand prince, l’empereur Charles Quint devenu le rival d’un va-nu-pieds et obligé de se cacher dans un placard. C’est insoutenable…
Et tous de renchérir sur l’incroyable dépravation des temps et sur la trop grande bonté, la coupable indulgence du Roi qui laissait s’étaler de telles horreurs sur le pavé de Paris. On parla aussi, pour le louer grandement, du dernier bal du duc de Blacas où n’avaient été conviés que les « purs », ceux qui n’avaient jamais frayé ni avec les révolutionnaires régicides ni avec la racaille impériale affublée par le Corse de titres ridicules :
— On était entre soi… C’était merveilleux…
Abasourdie, Hortense écoutait sans parvenir à comprendre et sans réagir. Son regard, de temps en temps, cherchait Félicia mais celle-ci ne semblait pas entendre ces propos auxquels, bien sûr, elle ne participait pas. Toute à son rôle d’hôtesse, elle allait de l’un à l’autre groupe sans s’arrêter vraiment à aucun. N’entendait-elle rien ? Était-il possible qu’elle, cette fanatique de l’Empire, tolérât sous son toit de tels propos ? Une injure plus forte lancée contre Napoléon par un jeune homme précieux dont le haut col et l’énorme cravate mettaient le menton à la hauteur des corniches faillit néanmoins la jeter dans la mêlée au mépris de tout sens de l’hospitalité, quand une grande jeune femme blonde prit la parole avec un accent d’Europe centrale.
— Ne dites pas trop de mal de Napoléon, baron ! Nous autres Polonais lui sommes restés attachés. Il nous avait donné la liberté. Ce sont de ces choses que l’on n’oublie pas…
— Ma chère princesse, on peut vous comprendre mais il n’en demeure pas moins fort surprenant d’entendre une Sapieha montrer tant… d’indulgence envers l’Usurpateur…
Timour qui circulait à travers le salon armé d’un plateau où s’alignaient les tasses de thé vint le placer si brusquement sous le nez du baron que celui-ci dut faire un saut en arrière. Cela créa une diversion et l’on parla d’autre chose. La princesse s’était d’ailleurs éloignée avec un léger haussement d’épaules.
Quand tous se furent retirés, Hortense ne put retenir plus longtemps ce qui l’étouffait. Elle rejoignit Félicia qui, adossée contre un pilastre, mordillait son mouchoir en regardant disparaître ses derniers visiteurs.
— Vraiment, Félicia, je ne comprends pas… je ne vous comprends pas.
— Vous ne comprenez pas pourquoi je reçois tous ces gens d’un autre âge ? Je dirais qu’ils sont mes voisins et que grâce à eux j’obtiens à bon compte un brevet de bonne conduite vis-à-vis de la police. Même chose pour tous ces thuriféraires des Tuileries. Ils me donnent une excellente façade à l’abri de laquelle je peux cacher mes activités réelles.
— Vos activités ? Vous conspirez donc véritablement ?
— Avec ardeur, ma chère ! Seuls les étrangers que vous avez vus ici, la princesse Sapieha et sa mère, les deux Potocka, sont là pour mon plaisir…
— Et cette femme pas très jolie mais si charmante, la comtesse Kavoli ? N’est-elle pas autrichienne ?
— Si fait. Elle est même fille de ministre, fit tranquillement Félicia. Mais elle aussi peut présenter une certaine utilité. Ne fût-ce que lorsque je me rendrai à Vienne un jour prochain.
— Vous comptez vous rendre à Vienne ?
— Quand le temps en sera venu. Ne vous ai-je pas dit que je formais certains projets touchant au prisonnier de Schönbrunn ? Qui veut la fin veut les moyens. Quant à vous, il est grand temps que vous appreniez chez qui vous habitez. Hier, vous craigniez pour l’amie de Jean, le meneur de loups, mais peut-être allez-vous hésiter à lier pour un temps votre destin à celui d’une rebelle. Je peux me retrouver en prison du jour au lendemain…
— C’est à ce point ?
— Mais oui. Je suis, ma chère, una carbonaro.
Chez les Dames du Sacré-Cœur, Hortense avait appris l’italien, et aussi l’anglais, mais, traduisant littéralement elle crut avoir mal compris :
— Une charbonnière ? Félicia, vous vous moquez ?
— Pas le moins du monde. Il est vrai qu’en Auvergne on ne doit guère avoir l’occasion d’être au fait de la politique étrangère. La Carbonaria est une société secrète, déjà ancienne car elle est, en fait, partie de chez des charbonniers français mais, tombée en désuétude ici, elle a repris une vigueur nouvelle dans le royaume de Naples d’abord puis dans les États pontificaux. Les membres en sont tous de « bons cousins » et chaque groupe s’appelle une « vente ». Cette société est opposée à toute forme d’oppression et je reconnais qu’à l’origine elle a été ressuscitée pour faire obstruction à l’occupation française. Mais, depuis, l’Histoire a marché en Italie. L’Autriche est devenue sa seule, sa véritable ennemie. Quant à la France, la Carbonaria y est revenue en 1818 avec l’intention déclarée de lutter contre les rois Bourbons. Évidemment, ses buts, que je reconnais essentiellement révolutionnaires, diffèrent suivant les groupes. Certains veulent le retour de la République. D’autres, dont je suis, veulent le retour du fils de l’Aigle.

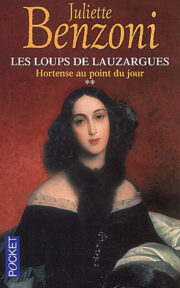
"Hortense au point du jour" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hortense au point du jour". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hortense au point du jour" друзьям в соцсетях.