– On dirait que Guillaume Tell ne fait plus recette ? Après tout pourquoi pas : il y avait déjà pas mal de piquées avant cette foutue guerre, le nombre n’a pas dû en diminuer beaucoup ?
– Cessez de rire, je vous en prie ! Une chose est certaine : vous répondez point par point aux souhaits de Mlle Kledermann. Vous êtes prince et, au Livre d’or de la Sérénissime, votre nom est l’un des plus beaux, tout comme votre palais. Vous jouissez d’une excellente santé – ce qui a sa valeur pour une fille de la saine Helvétie ! – et vous êtes plutôt bien de votre personne...
– Vous êtes bien bon ! Seulement il y a un détail qui n’a pas l’air de vous effleurer : on ne peut pas faire une princesse Morosini d’une Suissesse qui doit être protestante... en admettant que je considère la proposition.
– Kledermann est d’origine autrichienne et catholique. Lisa aussi.
– Vous avez réponse à tout, n’est-ce pas ? Cependant, je me refuse à épouser une parfaite inconnue pour redorer mon blason. Si j’acceptais, je n’oserais plus contempler en face le portrait du doge Francesco. Prenez-moi pour un fou si vous voulez, mais je me suis juré de ne jamais déchoir...
– Serait-ce déchoir qu’épouser une très jolie femme, intelligente et bonne – ces temps derniers elle soignait des blessés dans un hôpital...
Morosini quitta sa cheminée qu’il commençait à trouver trop chaude et vint poser sa grande main ornée d’une sardoine gravée à ses armes sur l’épaule du petit notaire :
– Mon cher ami, je vous sais un gré infini de la peine que vous prenez mais, en toute sincérité, je ne me crois pas encore réduit à ce genre de marchandage. J’aimerais, si je me marie un jour, suivre l’exemple de mes parents, faire un vrai mariage d’amour, dût la fiancée être pauvre comme la fille de Job. Voyez-vous, j’ai peut-être encore un moyen de me tirer d’affaire.
– Le saphir wisigoth de votre mère ? fit Massaria sans sourciller. Ne croyez-vous pas qu’il serait dommage de le vendre ? Elle y tenait tant...
Aldo ne songea même pas à cacher sa surprise :
– Elle vous en a parlé ?
Le sourire du vieil homme se teinta de mélancolie :
– Donna Isabelle a bien voulu me le montrer, certain soir qui fut peut-être le plus doux de ma vie car ce geste de confiance m’assurait qu’elle me tenait pour un fidèle ami. En même temps j’en fus désolé : voyez-vous, votre mère venait de vendre la plupart de ses bijoux pour entretenir le palais et l’idée de se séparer de ce joyau familial la déchirait.
– Elle a vendu ses bijoux ? s’exclama Aldo atterré.
– Oui, et c’est moi qu’en dépit de ma répugnance elle a chargé des transactions, mais le saphir de Receswinthe[i]lui appartient toujours. Quant à vous, il ne vous est donné qu’en dépôt pour revenir à votre fils aîné si Dieu vous donne des enfants. Voilà pourquoi vous devriez examiner un peu plus sérieusement ma proposition.
– Afin de permettre aux petits-enfants d’un banquier suisse de devenir dépositaires d’une pierre royale et plus que millénaire ?
– Pourquoi pas ? Ne faites donc pas la fine bouche ! Vous qui aimez les pierreries, sachez que Kledermann possède une admirable collection de joyaux parmi lesquels une parure d’améthystes ayant appartenu à la Grande Catherine, une émeraude rapportée du Mexique par Cortès et deux « Mazarin[ii]«.
– N’en dites pas plus ! La collection du père pourrait me tenter davantage que la dot de la fille. Vous n’ignorez ma passion des pierres, dont je suis redevable à ce bon M. Buteau ! Je ne tomberai pas dans votre piège. À présent, oublions tout cela et acceptez de déjeuner avec moi !
– Non, je vous remercie. Je suis attendu par le procurateur Alfonsi mais je viendrai volontiers, un soir prochain, goûter aux merveilles de Cecina.
Le notaire se leva, serra la main de Morosini puis, accompagné par lui, gagna la porte de la bibliothèque, et s’y arrêta.
– Promettez-moi de songer à ma proposition ! Elle est, croyez-moi, très sérieuse.
– Je n’en doute pas et vous promets de réfléchir... mais ce sera bien pour vous faire plaisir !
Resté seul, Aldo alluma une cigarette et résista à l’envie de se verser encore un verre. Ce n’était pas un buveur habituel et il s’étonnait de ce besoin soudain. Cela tenait peut-être à ce que, depuis son arrivée, il avait l’impression de se trouver emporté trop vite d’un monde dans un autre. Hier encore, il vivait la vie étriquée d’un prisonnier et, à présent, il retrouvait en même temps sa vie d’autrefois et son ancienne personnalité, seulement l’une lui donnait la sensation d’un vide énorme tandis que l’autre le gênait aux entournures. Il avait tellement souhaité retrouver son cadre familier, ses habitudes peuplées de visages chers ! Et voilà qu’à peine débarqué il devait affronter les misérables soucis de la vie quotidienne ! Au fond, il en voulait un peu à maître Massaria de ne pas lui avoir accordé un plus long délai de grâce, même si la seule amitié avait inspiré sa visite.
Il en venait presque à regretter la chambre glaciale de son burg autrichien où ses rêves au moins lui tenaient chaud tandis que maintenant, rendu aux fastes de sa demeure familiale, il s’y sentait étranger. Quel rapport pouvait exister entre l’amant princier de Dianora Vendramin et le revenant ruiné d’aujourd’hui ?
Car il était bel et bien ruiné, et sans grand remède immédiat. La vente du saphir – en admettant qu’il s’y résigne – lui permettrait peut-être de tenir quelque temps, mais ensuite ? Faudrait-il en venir à vendre aussi le palais et à s’en aller après avoir assuré à Cecina et Zaccaria une pension convenable ? Vers quoi ? L’Amérique, ce refuge des mauvaises fortunes dont il n’aimait pas le style de vie ? La Légion étrangère française où s’était réfugié un de ses cousins ? Il était saturé de guerre. Alors ? L’inconnu, le néant ? ... Il avait une telle envie de vivre ! Restait ce mariage insensé que d’aucuns pourraient juger normal mais qui lui paraissait à lui dégradant, peut-être parce que, avant la grande catastrophe, il avait vu plusieurs de ces unions baroques entre de riches héritières yankees avides de faire broder des couronnes sur leur lingerie et des nobles désargentés incapables de trouver une autre solution. Que la candidate fût helvétique ne changeait rien à la répugnance du prince. S’y ajoutait le fait qu’il y verrait même une mauvaise action : cette jeune fille était en droit d’espérer un peu d’amour. Comment aller vers elle avec l’image de Dianora dans le cœur ?
Agacé de se sentir tenté malgré tout, il jeta sa cigarette dans la cheminée et monta chez sa mère comme il avait coutume de le faire jadis lorsqu’un souci se présentait.
Devant la porte, il hésita encore, se décida enfin, éprouvant un réel soulagement à constater que c’était le soleil qui l’accueillait derrière cette porte et non les ténèbres redoutées. L’une des fenêtres s’ouvrait sur l’air frais du dehors mais un feu clair flambait dans la cheminée. Il y avait des tulipes jaunes dans un cornet de cristal posé sur une commode auprès de sa propre photographie en uniforme d’officier des Guides. La chambre était comme autrefois...
Spacieuse et claire, c’était un chef-d’œuvre de grâce et d’élégance, digne écrin d’une grande dame mais aussi d’une jolie femme. Résolument française avec son gracieux lit à baldaquin rond, ses hautes boiseries claires, ses rideaux et ses tentures de satin brodé qui harmonisaient un ivoire crémeux et un bleu turquoise très doux autour d’un grand portrait de femme qu’Aldo avait toujours aimé. Bien qu’il fût celui d’une duchesse de Montlaure qui, pendant la Révolution, avait payé de sa tête sa fidélité à la reine Marie-Antoinette, il offrait une étonnante ressemblance avec sa mère. Et curieusement, il avait toujours préféré cette toile à celle représentant Isabelle Morosini en robe de bal, peinte par Sargent, qui, dans le salon des Laques, faisait pendant à celle de la grand-tante Felicia due à Winterhalter.
À l’exception du portrait, peu de tableaux occupaient les panneaux d’ivoire rechampis de bleu : une tête d’enfant de Fragonard et un délicieux Guardi, seule évocation de Venise avec quelques verreries anciennes irisées comme des bulles de savon.
Lentement, Aldo s’approcha de la table à coiffer couverte de ces mille riens futiles et charmants si nécessaires à la toilette d’une femme raffinée. Il mania les brosses de vermeil, les flacons de cristal encore à demi pleins, en déboucha un pour retrouver le cher parfum, à la fois frais et sauvage, de jardin après la pluie. Puis, avisant le grand châle de dentelles dont la princesse morte aimait à s’envelopper, il le prit, y enfouit son visage et, se laissant tomber à genoux, il cessa de lutter contre son chagrin et sanglota.
Les larmes lui firent du bien en le vidant de ses incertitudes, en balayant le découragement. Il sut, en reposant le vêtement sur le fauteuil, qu’il n’accepterait pas davantage de laisser une étrangère fouler les tapis de cette chambre que de se séparer du vieux palais familial. Cela signifiait qu’il allait devoir opérer un tri parmi ses souvenirs, établir une échelle de valeurs dont, dès à présent, la conclusion s’imposait d’elle-même : si le joyau pouvait sauver la maison, il fallait s’en séparer. Pas pour n’importe quel acheteur bien sûr : un musée serait peut-être l’acquéreur rêvé mais il paierait moins cher que certains collectionneurs. D’abord, il convenait de récupérer la pierre !
S’étant assuré que la porte était fermée, Morosini s’approcha du chevet du lit et, à l’intérieur d’une des colonnes de bois sculpté soutenant le baldaquin, il chercha le cœur d’une fleur, appuya. La moitié du support peint et doré tourna sur d’invisibles gonds, découvrant la cavité où, dans un petit sac en peau de chamois, la princesse Isabelle gardait le magnifique saphir étoile monté en pendentif. Elle n’avait jamais pu se résigner à le confier à une banque.

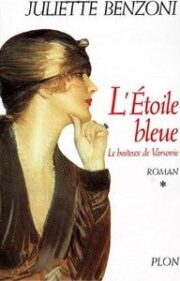
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.