Elle referma sous le suède clair de son gant la trace des lèvres d’Aldo puis, avec un dernier geste d’adieu, monta dans la voiture qu’elle avait demandée pour la conduire à Milan en refusant qu’il l’y accompagne. Et pas une fois elle ne se retourna. Un peu de poussière sous la caisse bleue d’une automobile fut le dernier souvenir que Morosini garda de sa maîtresse. Elle était sortie de sa vie comme on sort d’une maison : en refermant la porte derrière elle sans accepter de donner une adresse, moins encore un rendez-vous.
– Il faut laisser faire le hasard, avait-elle dit. Il arrive quelquefois que le temps revienne...
– C’était la devise de Laurent le Magnifique, répliqua-t-il. Seule une Italienne peut y croire. Pas vous !
Même si Dianora jugeait leur séparation élégante, cette façon de se détacher de lui blessa profondément Aldo, dans son amour comme dans son orgueil masculin. Avant Dianora, il avait connu nombre d’aventures qui, pour lui, ne tiraient jamais à conséquence. Elles s’achevaient toujours de sa propre initiative mais sans brusquerie et en général de façon plutôt consolante pour l’intéressée car il avait une sorte de talent pour transformer ses amours en amitiés.
Rien de semblable cette fois. Il se retrouvait esclave d’un souvenir tellement enivrant qu’il lui collait à la peau et ne lâcha pas prise durant ces quatre années de guerre. Lorsqu’il pensait à Dianora, il éprouvait à la fois du désir et de la fureur, avec une soif de vengeance attisée par le fait que le prudent Danemark, bien que neutre, apportait une aide à l’Allemagne. Il brûlait de la rejoindre tout en étant certain que c’était impossible. Il y avait eu trop de morts, trop de ruines ! Un terrible mur de haine s’élevait désormais entre eux...
L’évocation de son amour ne prit que peu d’instants à Morosini : le temps de quitter les cuisines sous l’œil inquiet de Cecina et de revenir dans le vestibule. Là, il fut repris par la beauté un rien solennelle mais paisible et rassurante de sa maison. L’image de Dianora s’estompa : elle n’avait jamais franchi le seuil du palais.
Du regard et de la main, il caressa les fanaux bronze doré, vestiges de la galère commandée par un Morosini à la bataille de Lépante. Autrefois, les soirs de fête, on les allumait et ils faisaient chatoyer les marbres multicolores du dallage, les ors des longues poutres enluminées d’un plafond que l’on ne pouvait contempler sans rejeter la tête en arrière. Lentement, il monta le large escalier dont tant de mains avaient poli la rampe à balustres pour atteindre à l’étage le portego, la longue galerie-musée dont s’enorgueillissaient nombre de palais vénitiens.
La vocation de celui-ci était maritime. Le long des murs couverts de portraits de facture souvent illustre, des bancs de bois armoriés alternaient avec des consoles de porphyre où se gonflaient, dans leurs cages de verre, les voiles des caravelles, caraques, galères et vaisseaux de la Sérénissime République. Les toiles représentaient des hommes toujours vêtus avec une grande magnificence qui formaient le cortège du portrait le plus imposant, celui d’un doge en cuirasse et manteau de pourpre, le corno d’or en tête, l’orgueil au fond des yeux : Francesco Morosini, le « Péloponnésien » quatre fois général de la Mer contre les Turcs, mort en 1694 à Nauplie alors qu’il exerçait le commandement suprême de la flotte vénitienne.
Bien que deux autres doges eussent illustré la famille – l’un, Marino, de 1249 à 1253 et l’autre, Michele, emporté par la peste en 1382 après seulement quatre mois de règne ! – c’était le plus grand des Morosini, un homme exceptionnel en qui la puissance s’alliait à la sagesse et qui avait écrit l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire de Venise, une page qui fut la dernière... À l’autre bout du portego, face au portrait du doge se dressait le fano, la triple lanterne marquant le titre de général sur le vaisseau de Francesco à la bataille de Nègrepont.
Un moment, Aldo s’attarda devant l’effigie du grand ancêtre. Il avait toujours aimé ce visage pâle et fin encadré de cheveux blancs dont la moustache et la « royale » encadraient la bouche sensible, ainsi que ces profonds yeux noirs, fiers et dominateurs sous le sourcil que fronçait l’impatience. Le peintre avait dû éprouver quelque peine à obtenir une longue immobilité...
Le revenant pensa qu’en face de tant de splendeur il devait faire triste mine dans son vieil uniforme râpé. Le regard grave semblait fouiller le sien pour lui demander compte de ses exploits guerriers, plutôt minces à vrai dire. Alors, poussé par une force venue de loin et comme il l’eût fait devant le Doge vivant, il plia un instant le genou en murmurant :
– Je n’ai pas démérité, Sérénissime Seigneur ! Je suis toujours l’un des vôtres...
Ensuite, il se releva et grimpa en courant jusqu’au second étage, évitant au passage la chambre de sa mère. Le notaire serait bientôt là et ce n’était pas le moment de se laisser envahir par le chagrin...
S’il éprouva du plaisir à retrouver son cadre d’autrefois, il ne s’y attarda guère, pressé par la hâte de se débarrasser de sa défroque de prisonnier. Pourtant, il prit le temps de mettre l’œillet de la petite bouquetière dans un mince vase irisé et de le poser sur sa table de chevet. Puis, se déshabillant à la volée, il courut se plonger avec béatitude dans la baignoire emplie d’une eau parfumée à la lavande et divinement chaude.
Autrefois, il aimait traîner dans son bain en fumant, en lisant son courrier. C’était un lieu magique et propice à la réflexion, mais cette fois, il se contenta de s’y étriller ferme après s’être enduit de savon jusqu’à la pointe des cheveux. Quand il eut fini, l’eau était grise et peu convenable pour y rêver. Il en sortit au plus vite, ôta la bonde de vidange, se sécha, s’inonda de lavande anglaise puis, enveloppé d’une sortie de bain en tissu éponge qui lui parut le summum du confort, il se rasa, alluma une cigarette et regagna sa chambre.
Dans la penderie voisine, Zaccaria s’agitait, sortant de leurs housses de toile des costumes de teintes et de coupes variées qu’il examinait d’un œil critique.
– Tu m’apportes de quoi m’habiller ou tu as fait du feu avec mes vêtements ? cria Morosini.
– J’aurais bien dû ! Rien ne doit plus être à vos mesures. Vous allez avoir l’air d’un clou. Sauf peut-être dans vos tenues de soirée car, grâce à Dieu, les épaules sont toujours là ! Aldo le rejoignit et se mit à rire :
– Je me vois mal recevoir le vieux Massaria en habit et cravate blanche ! Tiens, donne-moi ça !
« Ça », c’était un pantalon de flanelle grise et un blazer bleu marine qu’il portait à Oxford l’année où il y était resté pour perfectionner son anglais. Il choisit ensuite une chemise de tussor blanc et noua, sous le col, une cravate aux couleurs de son ancien collège. Cela fait, il se contempla avec une satisfaction mitigée :
– Je ne suis pas si mal après tout !...
– Vous n’êtes pas difficile ! Ces chemises molles n’ont aucune élégance. Elles sont bonnes pour les étudiants et les ouvriers ! Je vous l’ai dit cent fois. Rien ne vaut... !
– Puisque tu n’aimes pas ma chemise, va donc voir si le notaire arrive ! Son faux col te consolera. Tu les mettras tous les deux dans la bibliothèque.
Prenant une paire de brosses en écaille, Aldo entreprit de discipliner ses épais cheveux noirs où se mêlaient déjà, vers les tempes, quelques fils d’argent pas vraiment déplaisants auprès de sa peau mate plaquée sur une ossature arrogante qui eût convenu à un condottiere. Cependant, il s’examinait sans indulgence : où étaient ses muscles de jadis ? Quant à son visage creusé par les privations – on ne mangeait guère, en Autriche, ces temps derniers ! – il lui donnait plus que ses trente-cinq ans. Seuls ses yeux, d’un bleu d’acier tirant parfois sur le vert dans la colère, toujours insouciants et facilement moqueurs, gardaient leur jeunesse comme ses dents blanches que découvrait à l’occasion un sourire indolent. Qui, pour le moment, ressemblait assez à une grimace :
– Ridicule ! soupira-t-il. Va falloir remeubler tout ça, faire du sport ! Heureusement, la mer n’est pas loin : on ira nager !
S’étant ainsi réconforté, il descendit à la bibliothèque. C’était sa pièce préférée. Il y avait passé de si bons moments avec le cher M. Buteau qui savait évoquer avec le même lyrisme la mort tragique de Marino Faliero, le doge maudit, retracée par le peintre Eugène Delacroix, la longue lutte contre les Turcs, les sonnets de Pétrarque... ou le fumet d’un lièvre à la royale. Devenu homme, Aldo aimait s’y attarder avec le dernier cigare de la soirée en écoutant la fontaine du cortile égrener ses notes fraîches. L’odeur suave des merveilleux havanes flottait peut-être encore entre les murs habillés de chêne et d’anciennes reliures.
Comme le portego, la chambre des livres proclamait la vocation maritime des Morosini. Un grand chartier y renfermait un véritable trésor de cartes anciennes. Il y avait là, outre l’atlas catalan du juif Cresque, des portulans incomplets, sans doute, mais d’autant plus émouvants, tracés par ordre du prince Henri le Navigateur dans cette étonnante Villa do Infante, à Sagres, près du cap Saint-
Vincent, qui était à la fois palais, couvent, arsenal, bibliothèque et même université. On gardait aussi la fameuse carte du Vénitien Andrea Bianco où paraissaient déjà une partie des Caraïbes et un fragment de la Floride, tracés avant même que Christophe Colomb ait largué les voiles de ses caravelles. Sans compter quelques-uns de ces portulans génois, byzantins, majorquins ou vénitiens que leurs possesseurs, en cas de prise, préféraient jeter à la mer afin qu’ils ne tombent pas aux mains de l’ennemi.
Des armoires peintes, aux portes pleines, protégeaient des livres de bord, des traités de navigation anciens. Il y avait aussi des astrolabes dans une vitrine, des sphères armillaires et l’un des premiers compas. Une superbe mappemonde sur piétement de bronze placée devant la fenêtre centrale recevait la lumière du soleil et, sur le dessus des bibliothèques, d’autres sphères reposaient, magnifiques et inutiles. Et puis des longues-vues, des sextants, des boussoles et un étonnant poisson de fer aimanté dont on disait qu’il servait aux Vikings pour traverser ce qu’ils ignoraient être l’océan Atlantique. Le monde, son histoire et les plus fascinantes aventures humaines reposaient là entre les rayonnages chargés de reliures précieuses dont les cuirs nuancés et les « fers » dorés luisaient. Ici, le parfum du passé rejoignait celui des cigares fumés...

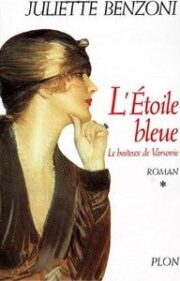
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.