L’infirmière nous conduit jusqu’à la grande chambre aux volets fermés et nous devinons, dans la pénombre, le lit d’hôpital légèrement relevé où se trouve la frêle silhouette de notre grand-mère. Nous prions l’infirmière de bien vouloir nous laisser seuls avec elle. Nous avons besoin de discuter en privé. Elle s’exécute.
Mélanie allume la lampe de chevet pour que nous puissions au moins distinguer le visage de notre grand-mère. Blanche a les yeux fermés et ses paupières se mettent à palpiter quand elle entend la voix de Mélanie. La vieillesse et la fatigue se lisent sur son visage, ainsi que cette évidence : elle ne semble plus tenir à la vie. Ses yeux s’ouvrent lentement et passent du visage de Mélanie au mien. Aucune réaction. Sait-elle encore qui nous sommes ? Mélanie lui prend la main, lui parle. Ses yeux vont de Mélanie à moi, sans un mot. Un épais collier de rides court autour de son cou desséché. Elle va sur ses quatre-vingt-quatorze ans, si mes calculs sont bons.
La chambre n’a pas changé. Les lourds rideaux ivoire, les tapis épais, la bibliothèque, la coiffeuse devant la fenêtre et les nombreux bibelots familiers : un œuf de Fabergé, une tabatière en or, une petite pyramide de marbre et les éternelles photographies qui prennent la poussière dans leurs cadres d’argent – notre père et Solange, enfants, notre grand-père Robert, Mel, Joséphine et moi. Quelques photos aussi de mes enfants quand ils étaient bébés. Aucune d’Astrid. Ni de Régine. Et aucune de notre mère.
— Nous voudrions te parler de Clarisse, dit Mélanie en articulant bien. De notre mère.
Les paupières palpitent puis se ferment. Cela ressemble à un refus.
— Nous voulons savoir ce qui s’est passé le jour où elle est morte, poursuit Mélanie, sans se soucier des paupières closes.
Qui s’ouvrent en frémissant, à présent. Blanche nous regarde en silence un long moment. Je suis persuadé qu’elle n’avouera rien.
— Peux-tu nous raconter ce qui est arrivé ici le 12 février 1974, grand-mère ?
Nous attendons. J’ai envie de dire à Mélanie de laisser tomber, que c’est sans espoir. Mais tout à coup, les yeux de Blanche s’écarquillent et s’animent d’une expression étrange, presque reptilienne, qui me dérange. Je regarde son torse émacié tenter de se relever laborieusement. Les paupières ne cillent pas. Elle nous fixe, méchamment, avec défi. Deux prunelles noires encore allumées sur ce qui semble déjà une tête de mort.
Les minutes passent et je comprends que ma grand-mère ne parlera jamais, qu’elle emportera ce qu’elle sait dans la tombe. Et je la déteste. Je déteste chaque centimètre carré de sa répugnante peau fripée, chaque parcelle de cet être, Blanche Violette Germaine Rey, née Fromet, dans le 16e arrondissement, bien née et riche, promise à l’excellence en tout domaine.
Nous nous dévisageons, ma grand-mère et moi. Mélanie nous observe, avec étonnement. Je veux être sûr que Blanche mesure à quel point je la déteste. Qu’elle prenne cette rage en pleine face, de plein fouet, que sa chemise de nuit immaculée en soit complètement souillée. Mon mépris est tel que j’en tremble de la tête aux pieds. L’envie me démange de saisir un de ces oreillers brodés et de l’écraser contre son visage, pour étouffer l’arrogance de ses yeux perçants.
C’est une bataille farouche et silencieuse entre elle et moi, interminable. J’entends le tic-tac du réveil argenté posé sur la table de nuit, les pas de l’infirmière derrière la porte, le ronronnement de la circulation sur l’avenue bordée d’arbres. J’entends la respiration nerveuse de ma sœur, le sifflement des vieux poumons de Blanche, mon propre cœur qui cogne comme tout à l’heure, dans la chambre de Gaspard.
Ses yeux finissent par se fermer. Très lentement, Blanche sort une main noueuse qui, tel un phasme, rampe sur le drap pour atteindre la sonnette. Un son strident retentit.
L’aide-soignante entre immédiatement.
— Madame Rey est fatiguée à présent.
Nous partons sans dire un mot. Gaspard est invisible. Ignorant l’ascenseur, je décide de prendre l’escalier. En descendant, je pense à ma mère sortant d’ici sur un brancard, dans son manteau rouge. Mon cœur se serre.
Dehors, il fait plus froid que jamais. Nous sommes incapables d’articuler un mot. Je suis détruit et si j’en crois la pâleur de son visage, c’est aussi le cas de Mélanie. J’allume une cigarette. Elle regarde son téléphone. Je propose de la raccompagner chez elle. Du Trocadéro à la Bastille, la circulation est dense, comme tous les samedis soir. Nous demeurons muets.
C’est notre seul moyen de tenir à distance cette chose si monstrueuse qu’est la mort de notre mère.
L’assistante de Parimbert est une femme tout en courbes, répondant au nom de Claudia. Elle cache ses rondeurs excessives sous une large robe noire qui ressemble à une soutane. Elle me parle sur un ton paternaliste et amical que je trouve irritant. Dès le lundi matin, à la première heure, elle me serine avec la date de remise du projet de dôme de l’Esprit. Parimbert l’a accepté, mais il y a eu un léger retard, car l’un des fournisseurs n’a pu livrer à temps les écrans lumineux que j’avais commandés. Ceux-ci changeront constamment de couleur et formeront les parois intérieures du dôme. En temps normal, j’aurais laissé cette femme me harceler sans sourciller. Mais pas aujourd’hui, pas maintenant. Et plus jamais d’ailleurs. Je pense à ses dents tachées de caféine, à la moustache qui ombre sa lèvre supérieure, au patchouli dont elle s’arrose, à ses hurlements de reine de la nuit et mon dégoût, mon impatience et mon irritation explosent. Cela me soulage, et rappelle étrangement le calme qui suit l’orgasme. Dans la pièce voisine, j’entends Lucie s’étrangler.
Je raccroche rageusement. Il est temps pour une petite cigarette dans la cour glaciale. J’enfile mon manteau. Mon portable sonne. C’est Mélanie.
— Blanche est morte, m’annonce-t-elle sans émotion. Ce matin. Solange vient de m’appeler.
L’annonce de la mort de Blanche me laisse de marbre. Je ne l’aimais pas. Je ne la regretterai pas. La haine que j’ai ressentie à son chevet, samedi, est encore vive. Elle reste néanmoins la mère de mon père et c’est à lui que je pense. Je sais que je devrais l’appeler. Et appeler Solange. Mais je ne le fais pas. Je vais fumer un clope dehors, dans le froid. Je pense aux jours qui vont suivre, aux problèmes d’héritage. Solange et mon père n’ont pas fini de se battre. Ça va être moche. Comme il y a quelques années, et Blanche n’était même pas morte. Nous avons été tenus à l’écart et personne ne nous en a parlé, mais il y a eu des conflits entre le frère et la sœur. Solange était persuadée que François était l’enfant préféré, qu’il avait toujours été avantagé. Au bout d’un moment, elle a cessé de voir son frère. Et nous, par la même occasion.
Mélanie me demande si je veux passer voir le corps de Blanche. Je lui réponds que je vais y réfléchir. Je sens une légère distance entre ma sœur et moi, c’est nouveau, ça n’a jamais existé entre nous, en tout cas, je ne l’ai jamais ressentie. Je sais qu’elle n’a pas approuvé mon attitude envers Blanche, samedi. Mélanie veut savoir si j’ai appelé notre père. Je lui promets que je vais le faire. Encore une fois, je sens au ton de sa voix qu’elle me reproche mon attitude. Elle est en route pour l’appartement paternel. Son ton est clair, j’ai intérêt à la rejoindre. Et vite.
Quand j’arrive chez lui, la nuit est déjà tombée. Margaux n’a pas bronché de tout le trajet, son iPod dans les oreilles et les yeux rivés sur son téléphone portable où ses doigts s’activent à envoyer non-stop des SMS. Lucas est assis à l’arrière, captivé par sa Nintendo. J’ai l’impression d’être tout seul dans la voiture. Les enfants d’aujourd’hui sont les enfants les plus silencieux qui aient jamais existé.
C’est Mélanie qui nous ouvre la porte. Son visage est pâle et triste. Ses yeux sont embués de larmes. Aimait-elle Blanche ? La regrette-t-elle ? Nous ne la voyions presque plus, mais c’était notre seule grand-mère, les parents de Clarisse sont morts quand elle était petite. Notre grand-père a disparu quand nous étions adolescents. Blanche était le dernier lien avec notre enfance.
Mon père est déjà couché. Cela m’étonne de lui. Je regarde ma montre. Sept heures et demie. Mélanie me le décrit très fatigué. Y a-t-il encore dans sa voix un ton de reproche ou est-ce que je me fais des idées ? Je lui demande ce qu’il a, mais Régine arrive et elle en profite pour ne pas me répondre. Régine est très apprêtée et a l’air sinistre. Elle nous embrasse distraitement, nous offre des boissons et des gâteaux d’apéritifs. J’explique qu’Arno est encore dans sa pension, mais qu’il sera là pour l’enterrement.
— Ne me parlez pas de l’enterrement, grogne Régine, en se servant un copieux verre de whisky d’une main tremblante. Je ne veux pas m’occuper de ça. Je ne me suis jamais entendue avec Blanche, elle ne m’a jamais aimée, alors je ne vois pas au nom de quoi je devrais m’occuper de ses funérailles.
Joséphine entre, plus gracieuse que jamais. Elle nous embrasse et s’assoit près de sa mère.
— Je viens de parler à Solange, dit Mélanie d’une voix ferme. Elle est prête à s’occuper de l’enterrement. Ne vous souciez de rien, Régine.
— Eh bien, si Solange s’en charge, nous n’avons plus rien à faire. Cela soulagera votre père. Il est bien trop fatigué pour affronter sa sœur. Blanche et Solange ont toujours été désagréables avec moi. Elles avaient cette façon de me regarder des pieds à la tête comme si je n’avais pas le bon profil, sans doute parce que mes parents n’étaient pas aussi riches, continue Régine en se versant un autre whisky qu’elle avale cul sec. Elles m’ont toujours fait sentir que je n’étais pas assez bien pour François, pas assez bien née pour être une Rey. Une horrible bonne femme, cette Blanche, et sa fille est pire encore.

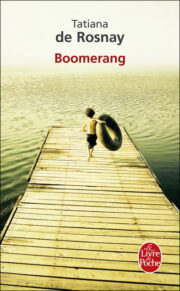
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.