C’est une vision d’enfer. Nous continuons à rouler lentement dans une odeur de décomposition insupportable. Enfin, le panneau qui indique l’autoroute apparaît. Dans la voiture, j’entends des soupirs de soulagement. Nous accélérons vers Paris jusqu’à Malakoff, rue Émile-Zola. Le moteur tourne…
— Pourquoi ne resterais-tu pas dîner ? suggère Astrid.
Je hausse les épaules.
— Pourquoi pas ?
Les enfants sortent à la queue leu leu de la voiture. J’entends les aboiements joyeux de Titus de l’autre côté de la barrière.
— Est-ce que Serge est là ?
— Non, il n’est pas là.
Je ne demande pas où il se trouve. D’ailleurs, cela m’est égal. Je suis juste heureux de son absence. Je n’arrive pas à me faire à l’idée que ce type habite dans ma maison. Oui, c’est toujours ma maison. C’est comme ça que je le sens. Ma maison, ma femme, mon jardin. Mon chien. Mon ancienne vie.
Nous dînons comme au bon vieux temps, dans la cuisine américaine que j’ai conçue avec tant de soin. Titus est fou de joie. Il n’arrête pas de poser sa mâchoire baveuse contre mes genoux, en levant vers moi des yeux incrédules et pleins d’extase. Les enfants restent avec nous un moment puis finissent par aller se coucher. Je me demande où est Serge. Je m’attends à le voir pointer son nez à chaque instant à la porte d’entrée. Astrid ne dit rien de lui. Elle discute des enfants, de la journée passée. Je l’écoute.
Pendant qu’elle continue de me parler, je fais un feu dans la cheminée. Pas de bois dans le foyer, mais beaucoup de cendres. Le stock de bois est celui que j’ai acheté, il y a des années. Serge et Astrid ne sont pas adeptes des tête-à-tête cosy au coin du feu. Je tends mes mains vers les flammes. Astrid vient s’asseoir par terre près de moi et pose sa tête sur mon bras. Je ne fume pas parce que je sais qu’elle déteste ça. Nous regardons le feu. Si quelqu’un, en passant, jetait un coup d’œil par la fenêtre et nous voyait ainsi, il pourrait s’imaginer un couple heureux, uni.
Je lui raconte ce qui est arrivé avec Arno. Je décris le commissariat de police, l’état lamentable de notre fils et comment je me suis montré froid et dur. J’explique aussi la façon dont il a réagi, ajoutant que je n’ai pas encore trouvé le bon moment pour avoir une discussion sérieuse avec lui, mais que je le ferai sans faute. Je lui dis aussi que nous devons trouver un bon avocat. Elle m’écoute, déconcertée.
— Pourquoi ne m’as-tu pas appelée ?
— J’y ai pensé. Mais qu’est-ce que tu aurais pu faire depuis Tokyo ? Tu étais déjà sous le coup de la mort de Pauline.
— Tu as raison.
— Margaux a eu ses règles.
— Oui, je suis au courant, elle me l’a dit. Selon elle, tu t’en es bien tiré pour un papa.
La fierté m’envahit.
— Vraiment ? Elle a dit ça ? Je suis content. Parce que, quand Pauline est morte, je crains de n’avoir pas si bien assuré.
— Dans quel sens ?
— Je n’arrivais pas à trouver les mots justes. J’étais incapable de la réconforter. Alors, je lui ai suggéré qu’on t’appelle. Et ça l’a mise hors d’elle.
Je suis à deux doigts de lui révéler le secret de ma mère, mais je me retiens. Pas maintenant. Maintenant appartient à notre petite famille, à nos enfants, à nos problèmes, à nous. Astrid va chercher du limoncello dans le congélateur et revient avec de minuscules verres en cristal que j’avais achetés il y a des années au marché aux puces de la porte de Vanves. Nous sirotons en silence. Je lui raconte mon rendez-vous avec Parimbert, son projet de dôme de l’Esprit. Je lui décris le bureau Feng Shui, les poissons noirs, le thé vert, les scones au blé complet. Elle rit. Et je ris avec elle.
Nous parlons de Mélanie et de sa convalescence, du travail d’Astrid, de Noël qui approche. Pourquoi ne pas le fêter tous ensemble à Malakoff ? suggère-t-elle. C’était si compliqué l’année dernière. Noël avec elle, le Nouvel An avec moi. Pourquoi ne pas se rassembler cette année ? La mort de Pauline a rendu les choses si tristes et si fragiles.
— Oui, pourquoi pas.
Mais Serge ? Où sera-t-il, lui ? Je garde mes questions pour moi, mais elle a dû lire dans mes pensées.
— Serge a piqué une crise à Tokyo quand tu as appelé.
— Pourquoi ?
— Il n’est pas le père de ces enfants. Il ne sait pas s’y prendre.
— Que veux-tu dire ?
— Il est plus jeune, déconcerté face à eux.
Le feu crépite chaleureusement. On entend Titus qui ronfle. J’attends qu’elle continue.
— Il est parti, il a besoin de réfléchir. Il est chez ses parents à Lyon.
Pourquoi ne suis-je pas soulagé ? Au contraire, je ressens une torpeur circonspecte qui me dérange.
— Ça va ? lui demandé-je gentiment.
Elle tourne son visage vers moi. Je peux y lire la fatigue et la souffrance.
— Pas vraiment, murmure-t-elle.
Cela aurait dû être le signal pour moi. J’attends ce moment depuis si longtemps, celui où je pourrais la reprendre dans mes bras, être là pour elle. Le moment de la reconquérir. De tout reconquérir. J’en ai rêvé tant de fois rue Froidevaux quand je me glissais dans mon lit froid et vide en pensant que j’avais tout perdu. Ce moment que je guettais depuis Naxos, depuis qu’elle m’avait quitté. Ce moment mille fois imaginé.
Mais je me tais, incapable de prononcer les mots qu’elle aimerait entendre. Je me contente de l’observer avec un hochement de tête compatissant. Elle cherche un signe sur mon visage, dans mes yeux. Elle ne le trouve pas et fond en larmes.
Je lui prends la main et l’embrasse tendrement. Elle sanglote en s’essuyant les joues. Puis murmure :
— Tu sais, parfois, j’aimerais revenir en arrière. Tellement fort.
— Qu’est-ce que tu voudrais exactement ?
— Toi, Antoine. J’aimerais retrouver notre vie d’avant. – Son visage se crispe. – Oui, je voudrais que tout soit comme avant.
Elle m’embrasse fiévreusement. Ses baisers sont salés. Tout est là, sa chaleur, son parfum. Je veux pleurer avec elle et l’embrasser, mais je ne peux pas. Je la serre contre moi, finis par l’embrasser, mais la passion n’est plus là. La passion est morte. Elle me caresse, embrasse mon cou, mes lèvres et il me semble que la dernière fois que nous nous sommes enlacés ainsi, c’était hier. Pourtant deux ans sont passés. Le désir monte, comme un souvenir, par fidélité à la mémoire. Puis il s’évanouit. À présent, je la tiens dans mes bras comme je tiendrais ma fille, ma sœur, ou comme j’aurais pu tenir ma mère.
Une pensée inattendue s’insinue lentement en moi : je n’aime plus Astrid. Je me soucie d’elle, sincèrement, elle est la mère de mes enfants, mais je ne l’aime plus. J’éprouve de la tendresse, de l’attention, du respect, mais je ne l’aime plus comme avant. Et elle le sait. Elle le sent. Elle arrête les baisers, les caresses. Elle recule et se couvre le visage d’une main hésitante.
— Je suis désolée, dit-elle en respirant profondément. Je ne sais pas ce qui m’a pris.
Elle se mouche. Un silence s’installe. Je la laisse se remettre en lui tenant la main.
— Lucas m’a dit pour ton amie, la grande brune.
— Angèle.
— Ça dure depuis quand ?
— Depuis l’accident.
— Tu es amoureux ?
Suis-je amoureux d’Angèle ? Bien sûr que je le suis. Mais je ne peux pas le dire à Astrid maintenant.
— Elle me rend heureux.
Astrid sourit. C’est un sourire qui lui demande du courage.
— C’est bien. Super. Je suis contente pour toi.
De nouveau, un silence.
— Écoute, je suis affreusement fatiguée tout à coup. Je crois que je vais aller me coucher. Tu peux sortir Titus une dernière fois avant la nuit ?
Titus attend déjà près de la porte en remuant la queue. Je mets mon manteau et nous sortons dans le froid mordant. Il trottine autour du jardin en se dandinant et lève la patte. Je frotte mes mains l’une contre l’autre, je souffle dessus pour les réchauffer. J’ai hâte de retourner à l’intérieur. Astrid est à l’étage, je monte pour dire au revoir. Côté enfants, seule la chambre de Margaux est encore éclairée. J’hésite à frapper, mais elle a entendu mes pas et sa porte s’ouvre en grinçant.
— Au revoir, papa.
Elle s’avance vers moi comme un petit fantôme, dans sa chemise de nuit blanche, me serre furtivement dans ses bras et recule. Je longe le couloir vers ce qui a été ma chambre. Elle n’a pas changé. Astrid est dans la salle de bains attenante. Je m’assois sur le lit en l’attendant. C’est ici qu’elle m’a annoncé qu’elle voulait divorcer. Qu’elle l’aimait. Qu’elle voulait faire sa vie avec lui, pas avec moi. Je fixais mon alliance en pensant que ça ne pouvait pas être vrai. Je me souviens de ces reproches sur notre mariage, il était devenu aussi pépère et avachi qu’une vieille paire de charentaises… J’avais grimacé à l’image, mais je comprenais parfaitement ce qu’elle voulait dire. Était-ce seulement de ma faute ? Est-ce que le mari est toujours en tort ? Est-ce moi qui ai laissé s’éventer le piquant de notre couple ? Est-ce parce que j’oubliais d’offrir des fleurs ? Parce que j’avais laissé un prince plus jeune et plus charmant l’emporter loin de moi ? Je me suis souvent demandé ce qu’elle lui trouvait, à ce Serge. La jeunesse ? L’ardeur ? Le fait qu’il ne soit pas père ? Au lieu de me battre pour la garder, de me battre comme un beau diable, j’avais reculé. Un vrai dégonflé. Une de mes premières réactions, puérile je le concède, avait été de coucher avec l’assistante d’un collègue. Ça ne m’avait pas soulagé. Pendant notre mariage, j’avais été fidèle. Je ne suis pas doué pour la double vie. J’avais bien eu une brève aventure pendant un voyage d’affaires avec une jeune femme séduisante, juste après la naissance de Lucas. Je m’étais senti merdeux, la culpabilité était trop lourde à porter. L’adultère était une affaire trop compliquée. Avait suivi ce grand désert affectif entre Astrid et moi, juste avant que je ne découvre l’histoire avec Serge. Notre vie sexuelle était presque au point mort et j’avoue que je me préoccupais peu de comprendre ce qui n’allait pas et que je faisais peu d’efforts pour que ça change. Peut-être ne voulais-je pas savoir. Peut-être savais-je déjà, tout au fond de moi, qu’elle aimait et désirait un autre homme.

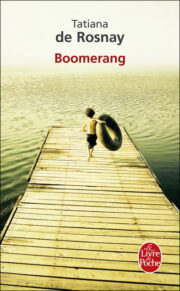
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.